
SPW-Patrimoine
Porte de Trèves, ancienne tour de défense
Bien qu’une occupation du site remonte à la Préhistoire, le nom de Bastogne apparait à l’époque mérovingienne, dans un texte de 634.
L’endroit est alors divisé en deux parties, une première appartenant à l’abbaye Saint-Maximin de Trèves et la seconde où se développe une maison forte, résidence des maires du palais et plus tard, un atelier monétaire sous le règne de Charles le Chauve, devenu empereur d’Occident en 875.
La localité entre par la suite dans les possessions des comtes de Luxembourg. Le 12 juin 1332, le comte Jean l’Aveugle accorde à la ville une charte d’affranchissement. Les domaines bastognards sont unifiés et les habitants sont autorisés à ériger des murailles afin de se protéger des incursions de pillards.
Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, la ville vit à l’intérieur de ses remparts. Doublée de fossés sur tout le pourtour, l’enceinte compte deux portes et une vingtaine de tours. À l’intérieur se trouvent l’église fortifiée dédiée à saint Pierre, une halle, deux couvents d’hommes et une maison de religieuses qui participent à la vie de la localité.
La ville devient au Moyen Âge le chef-lieu d’une prévôté du duché de Luxembourg.
En 1688, les armées de Louis XIV procèdent au démantèlement des remparts de Bastogne.
De ces fortifications, la ville garde toutefois un témoin d’importance. Classée dès 1938, la porte de Trèves est une des entrées de la ville depuis le XIVe siècle.
Plus anciennement dénommée « porte basse » ou « porte du moulin », il s’agit d’une imposante construction défensive érigée en moellons de grès et chaînée d’angle.
De plan carré mesurant 8 m de côté, ouvert d’un passage voûté, elle possédait à l’origine une herse comme le témoigne encore une glissière. La tour est surmontée d’une toiture ardoisée en forme de pyramide tronquée, elle-même sommée d’un toit surbaissé ; cette toiture typique du XVIIe siècle a sans aucun doute remplacé une toiture primitive.
À sa base, la porte de Trèves a un périmètre de 34 m contre 32 au sommet ; le faîte du toit culmine à 17 m de hauteur.
L’ouvrage existe dès 1332, son nom est cité régulièrement depuis le XVe siècle. Il s’agit de la seule porte de ville fortifiée encore debout dans la province du Luxembourg en plus d’être un vestige des plus rares de l’architecture militaire du comté de Luxembourg au Moyen Âge.
Des meurtrières, des archères, des cantonnières, trois mâchicoulis et des bretèches indiquent encore clairement les fonctions militaires de la porte sous l’Ancien Régime.
Avant le démantèlement de 1688, la porte et les reste du système défensif permirent aux habitants de Bastogne de résister aux invasions hollandaises de 1602 et de rester protégés intra muros. La tour fut ensuite reconvertie en prison en 1725 et joua ce rôle jusqu’à la fin du XIXe siècle. Après une importante restauration en 1982, la porte de Trèves a été transformée en musée.
6600 Bastogne

Frédéric MARCHESANI, 2013
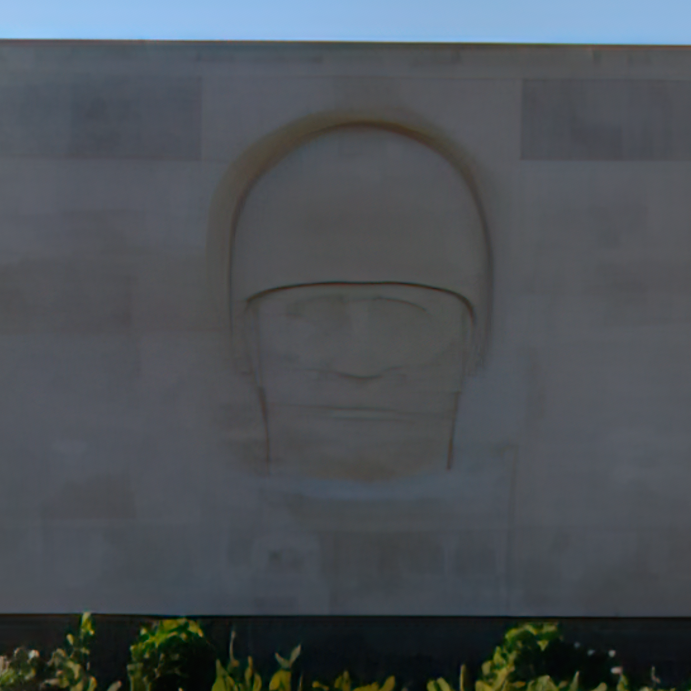
Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam
Mémorial PATTON à Bastogne
Si les forces alliées libèrent les villes wallonnes en septembre 1944, l’Allemagne hitlérienne tente une contre-offensive à hauteur de l’Ardenne à partir du 16 décembre 1944. L’attaque surprise du maréchal von Rundstedt vise les ponts de la Meuse et à séparer les armées anglaises des forces américaines pour reprendre le port d’Anvers.
C’est autour de Bastogne que la bataille décisive se déroule au cours d’un hiver particulièrement terrible. Encerclées par la 5e Panzer Armee, les troupes alliées parviennent à résister et reçoivent finalement l’aide de l’aviation, avant que la division blindée de George Patton entre dans la ville le 26 décembre, créant un couloir de communication entre les défenseurs de Bastogne et les renforts. L’accomplissement de ce fait d’armes était remarquable. Quelques années après la Libération, une série de monuments seront érigés pour honorer les libérateurs. Parmi ceux-ci, le monument Patton (1885-1945) rend hommage au général américain qui commanda notamment la 7e, puis la 3e armée des États-Unis lors de la libération de l’Europe.
George Smith Patton Jr.
Depuis son plus jeune âge, servir l’armée américaine est l’objectif de George Smith Patton Jr. Actif au Mexique contre Pancho Villa, en Europe de l’ouest lors de la Grande Guerre, il est un ardent défenseur d’un accroissement de la puissance matérielle de l’armée US. Ayant débarqué au Maroc en 1942, il mène la campagne de Tunisie, conduit les troupes de la 7e armée en Sicile et arrive le premier à Messine (17 août 1943). Après le débarquement en Normandie, il reçoit le commandement de la 3e armée, mène une guerre éclair jusqu’en Lorraine, se montre décisif dans la bataille des Ardennes et poursuit sa route vers l’Allemagne. Nommé brièvement gouverneur militaire de la Bavière, avant d’être affecté au commandement de la 15e armée, il est victime d’un accident de la route et succombe à ses blessures (21 décembre), un an presque jour pour jour après la libération de Bastogne.
C’est en 1963 qu’a été inauguré le mémorial Patton à Bastogne, en présence du lieutenant John Waters, petit-fils de Patton. Le monument est alors situé dans un espace vert compris entre la rue Merceny et la place de la rue Joseph Renkin. En 2010, le mémorial est déplacé d’une trentaine de mètres ; il fait l’objet d’une rénovation et d’un entretien total avant d’être installé le long de la chaussée d’Arlon, sur un site renommé place Général Patton. Avec l’aide du ministre wallon du Tourisme, et à l’initiative des autorités locales, un nouvel espace est aménagé à partir de 2009 ; il est inauguré le 17 juillet 2010. Un large espace est laissé autour du monument réalisé par Marcel Rau (1886-1966).

Le sculpteur Marcel Rau
Sculpteur et médailliste, formé auprès du sculpteur Paul Dubois à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles, sa ville natale, Rau a également suivi les cours de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Prix de Rome de sculpture en 1909, il séjourne en Italie avant d’installer son atelier à Ixelles. Après la Grande Guerre, il obtient de nombreuses commandes publiques pour des bas-reliefs ou des monuments aux victimes de la guerre, souvent à Bruxelles, mais pas uniquement.
Ainsi est-il l’auteur du Mineur que l’on pouvait voir sur les pièces de 50 centimes de francs belges qui circulèrent après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi contribue-t-il, avec Louis Dupont et Robert Massart, au Mémorial Albert Ier, inauguré sur l’île Monsin le 5 août 1939. Adossée à la tour, la statue du roi a une hauteur de 16 mètres. Moins grand est le masque du général Patton, gravé dans la pierre, et portant un casque étoilé.
Les yeux du commandant scrutent l’horizon, tandis que les traits montrent un homme décidé. Le nom PATTON est simplement gravé dans la pierre, de même que le nom de l’artiste (en bas, à droite). Une autre statue est dédiée au général Patton à l’Académie militaire de West Point, où il s’était formé au début du XXe siècle.
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
http://www.hetstillepand.be/rau.html
http://www.reflexcity.net/bruxelles/personnes-celebres/sculpteurs/sculpteur-marcel-rau (sv. février 2014)
Place Merceny (1963)
Puis place Général Patton
6600 Bastogne

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam
Buste McAULIFFE Anthony
Alors que les forces alliées semblaient avoir libérer définitivement les villes wallonnes en septembre 1944, l’Allemagne hitlérienne tente une contre-offensive à hauteur de l’Ardenne à partir du 16 décembre 44. L’attaque surprise du maréchal von Rundstedt vise les ponts de la Meuse et à séparer les armées anglaises des forces américaines pour reprendre le port d’Anvers.
C’est autour de Bastogne que la bataille décisive se déroule au cours d’un hiver particulièrement terrible. Dans la neige et le brouillard, les soldats alliés paraissent au bord de la rupture. Le 22 décembre, la ville de Bastogne est à ce point encerclée par la 5e Panzer Armée que des émissaires allemands proposent au commandant américain de la 101st Airborne Division « Screaming Eagles » de déposer les armes. Soufflée par le général Kinnard, la réponse du commandant Anthony Mc Auliffe deviendra célèbre : Nuts ! Il n’est pas question de reddition.
Dans les heures qui suivent, les conditions climatiques s’améliorent. Le ravitaillement arrive. Et les troupes qui résistent depuis plusieurs jours reçoivent finalement l’aide de l’aviation avant que la division blindée de George Patton entre dans la ville le 26 décembre, créant un couloir de communication entre les défenseurs de Bastogne et les renforts. La bataille de Bastogne entre dans l’histoire.
Dans les années qui suivent la Libération, une série de monuments sont érigés à Bastogne en l’honneur des libérateurs. Celui de Mc Auliffe est l’un des tout premiers. Il est inauguré en présence du militaire américain. Celui-ci reviendra en 1950 pour l’inauguration du Mardasson. Il est vrai qu’en 1949, sur décision du conseil communal, il avait reçu le titre de « citoyen d’honneur de Bastogne » et qu’en 1947 la grand place locale a été rebaptisée place McAuliffe.
Ces exemples témoignent des échanges étroits établis entre les États-Unis et les diverses autorités belges. Ainsi, voit-on en juillet 1946, l’ambassadeur de Belgique aux États-Unis, le baron Silvercruys, remettre solennellement au président Truman un coffret contenant un peu de terre provenant du champ de bataille de Bastogne. C’est dans ce contexte que la sœur du dit ambassadeur, Suzanne Silvercruys-Stevenson (1898-1973), sculpte un buste en l’honneur de McAuliffe qui va trouver une place de choix, au cœur de Bastogne.
 Inauguré en présence du « héros de Bastogne », le buste va être étroitement associé au char américain Sherman M4, figé sur son socle
Inauguré en présence du « héros de Bastogne », le buste va être étroitement associé au char américain Sherman M4, figé sur son socle
à partir de 1948. Le buste du militaire se trouve alors juste devant le char. Par la suite, le buste est déplacé dans un endroit moins visible, situation que n’apprécie pas le héros américain qui le fait savoir. Le buste est alors ramené à l’angle de la place, dans l’environnement immédiat du Sherman, et y demeurera quels que soient les aménagements successifs de la dite place.
Originaire de Washington, diplômé de West Point en 1918, Anthony McAuliffe (1898-1975) accomplit l’essentiel de sa carrière dans l’armée américaine (1918-1955). L’épisode de Bastogne ne constitue qu’une étape – certes la plus glorieuse – dans son impressionnant parcours. En juin 1944, il a été parachuté sur la Normandie, lors du Débarquement et il a aussi participé à l’opération Market Garden. C’est en l’absence de Maxwell D. Taylor retenu par une réunion aux États-Unis que McAuliffe s’est retrouvé à la tête de la 101e Division pour répondre à l’offensive allemande. « Sa » guerre en Europe ne s’achèvera qu’en mai 1945. De retour aux États-Unis, il occupe plusieurs postes de commandement avant d’être promu général, le 1er mars 1955. Retiré de l’armée en 1956, il poursuit des activités à l’American Cyanamid Corporation.
Quant à Suzanne Silvercruys, elle a connu une destinée marquée par la Première Guerre mondiale. Fille du président de la Cour de Cassation de Bruxelles, elle est adolescente quand éclate la Grande Guerre. Après la mort d’Edith Cavell, elle fuit la Belgique, passant par les Pays-Bas et l’Angleterre avant de se réfugier aux États-Unis. À Philadelphie, elle témoigne une première fois des horreurs et des destructions de la guerre en Europe et ses propos sont repris par de nombreux journaux.
Le gouvernement belge lui demande alors de parcourir son pays d’accueil pour faire connaître le drame qui se joue en Europe et collecter des fonds pour les secours belges. Après la guerre, restée en Amérique, cette Limbourgeoise (elle est née à Maaseik) sort diplômée de la Yale University (Beaux-Arts, en 1928) et de la Temple University (Lettres).
Dans les années 1930, elle participe à des compétitions d’art, consistant à réaliser des sculptures esthétiquement réussies en un minimum de temps. Mais c’est surtout en réalisant le buste de plusieurs personnalités importantes que l’artiste se fait un nom. La sculptrice signe notamment celui de Herbert Hoover (bibliothèque de Louvain), du gouverneur du Canada, d’acteurs (Katryn Hepbrun), de hauts militaires, etc. Mariée à un lieutenant-colonel américain, Edward Ford Stevenson, Suzanne Silvercruys compose aussi des œuvres d’inspiration plus personnelle. En 1968, elle réalise la statue Noccalula qui, avec ses 9 mètres de haut, représente une fille Cherokee avant son saut légendaire au-dessus des chutes d’eau de Gadsden. Écrivain, conférencière, engagée politiquement, celle qui milite en faveur du Parti républicain et est surnommée « Suzanne of Belgium » est considérée comme une artiste américaine.
Sources
- Maison du Tourisme du Pays de Bastogne - Guy Blockmans OPT
- Suzanne SILVERCRUYS, en collaboration avec Marion Clyde MCCARROLL, Suzanne of Belgium ; the story of a modern girl, New York, 1932
- Suzanne Silvercruys, A Primer Of Sculpture, New York, 1942
Place McAuliffe
6600 Bastogne

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam
Monument Pierre de CRAWHEZ
Monument à la mémoire de Pierre de Crawhez, réalisé par inconnu (1927) et aménagé avec Olivier Godart (2006), 1927 et 21 mai 2006.
Quand l’automobile n’en est encore qu’à ses balbutiements, l’idée d’organiser des compétitions titille les plus passionnés et, faut-il le préciser ?, les plus fortunés. À défaut de circuits et d’infrastructures permanents, le tracé de ces courses parcourt les chaussées publiques.
Vainqueur de la toute première épreuve Bruxelles-Spa, disputée en deux étapes, en 1898, à la vitesse de 26 km/h, Pierre de Crawhez est un pilote acharné. En 1900, il organise Spa-Bastogne-Spa, avant de lancer en 1902, le 1er Circuit des Ardennes qui relie Bastogne, Martelange, Habay-la-Neuve, Longlier et Bastogne, en une boucle (d’environ 85 km) sans passage à niveau à parcourir à six reprises, ce qui permet aux spectateurs de voir les autos plusieurs fois. Ce concept est en fait celui de la première course sur circuit au monde (31 juillet 1902). Ayant pris le départ en première position, de Crawhez devra abandonner cette première édition suite à un accident au 3e tour. Sur une Panhard-Levassor, il remportera la deuxième édition, en 1903. Il y aura 6 éditions, l’épreuve s’arrêtant (provisoirement) en 1907.
S’il continue d’entretenir sa passion pour la vitesse (il semble avoir participé à une expédition en Afrique durant l’été 1909), parallèlement, il porte le projet de construire un circuit permanent sur une distance plus courte. Peu avant la Grande Guerre, ce circuit des Ardennes déménage pour prendre place du côté de Spa (ou le frère de P. de Crawhez est bourgmestre) et le circuit relie alors Malmedy, Stavelot et Francorchamps ; les premières courses sur circuit ont lieu en 1920. Pierre de Crawhez est alors le président de « l’Automobile Club de Spa ». Vivant profondément sa passion, il meurt des suites d’un accident en 1925 ; il avait 51 ans.
Pour honorer son souvenir, ses amis décident d’ériger un monument. Il trouve place, en 1927, à l’endroit même où avait été donné le départ du tout premier circuit des Ardennes, à l’entrée de Bastogne. Bien plus tard, ce monument est déplacé par les autorités locales qui l’installent à côté du parking Merceny, en raison de l’élargissement du carrefour des routes d’Arlon et de Wiltz. En 2006, le monument effectue son dernier transfert. Un rond-point ayant été construit au milieu dudit carrefour, le monument reprend presque sa place originelle. Au centre du rond-point, est installée une œuvre d’art dédiée au Circuit des Ardennes, créée en métal par Olivier Godart, et représentant la silhouette de l’œuvre comprend la silhouette d’une voiture de course du début du XXe siècle. Quant au monument de Crawhez, il prend place dans le prolongement de la rue Joseph Renquin, tandis que la silhouette d’une moto est placée à l’arrière. L’inauguration a eu lieu le 21 mai 2006 en présence des autorités locales qui ont soutenu l’initiative de l’Association de commémoration du Circuit des Ardennes et de la section historique du Royal Automobile Club de Belgique.
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
Théo MATHY, Dictionnaire des sports et des sportifs belges, Bruxelles, 1982, p. 65
Au rond-point « Circuit des Ardennes »
6600 Bastogne

Paul Delforge

Bruxelles kik-irpa
Ancien lavoir public de Noville
Ce petit hameau dépendait autrefois de la commune de Noville, avant le rattachement de celle-ci à Bastogne après la fusion des communes dans les années 1970. Ce charmant petit village est riche de trois édifices classés, un cas rare en Wallonie.
Édifice public né dans nos régions au 19e siècle, le lavoir doit répondre à certains besoins. Typiquement rural, il est l’endroit où l’on vient laver son linge exclusivement. Il participe à la vie courante de la communauté paysanne et occupe une place importante au sein du village ; il était le lieu de rendez-vous des lavandières. Beaucoup de ces monuments n’ont malheureusement pas survécu à l’invention des machines électriques et les survivants restent aujourd’hui des témoins d’une époque révolue.
L’ancien lavoir de Rachamps est l’un des très rares exemples wallons ayant fait l’objet d’une mesure de classement au titre de monument historique. Situé au cœur du hameau, en contrebas de l’église, il a été construit en moellons de schiste, pierre typiquement ardennaise, et présente une large ouverture sur sa face sud. L’ensemble date probablement de la première moitié du 19e siècle.
Rachamps
6600 Noville

Classement comme monument le 23 février 1983
Institut du Patrimoine wallon

Bruxelles kik-irpa
Ancien presbytère de Noville
Ce petit hameau dépendait autrefois de la commune de Noville, avant le rattachement de celle-ci à Bastogne après la fusion des communes en 1977.
Ce charmant petit village est riche de trois édifices classés, un cas rare en Wallonie. À de nombreuses reprises, Rachamps a figuré parmi les plus beaux villages fleuris de Wallonie et l’asbl « Bocage ardennais » a planté près de 25 000 arbres pour former des haies vives et ainsi protéger les champs et les pâtures.
Derrière l’église se trouve l’ancien presbytère qui, sous l’Ancien régime, servait également à la perception des impôts par les jésuites de Luxembourg, qui étaient seigneurs du lieu. C’est également à cet endroit que les religieux résidaient. Cette ample construction a été érigée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle comme l’indique l’inscription « IHS 1773 » présente sur une cheminée. À l’intérieur se trouvent également de beaux lambris de chêne et une peinture représentant saint Ignace de Loyola (1491-1556), fondateur de la compagnie de Jésus (ordre des jésuites).
Rachamps
6600 Noville (Bastogne)

Classé comme monument et comme site le 23 janvier 1978
Institut du Patrimoine wallon

bruxelles kik-irpa
Ancien chœur de l'église Saint-Jean-l'Évangéliste de Longvilly
Le hameau de Bourcy dépendait autrefois de l’ancienne commune de Longvilly, avant le rattachement de celle-ci à Bastogne après la fusion des communes en 1977.
L’occupation romaine a été attestée par la présence de villas à cet endroit. Derrière l’église du village, érigée vers 1907-1911 sur les plans de l’architecte Cupper de Bastogne, se trouve un petit bâtiment maintenu contre le flanc oriental de celle-ci.
Ce très bel édifice constitue le dernier vestige de l’ancienne église du village datée du Moyen Âge.
La voûte est recouverte des peintures réalisées en 1530, probablement par Renadin de Wicourt, l’artiste qui peignit également les voûtes de l’église Saint-Pierre de Bastogne. Elles représentent des scènes de l’Apocalypse : l’évocation des malheurs qui touchent les humains (guerre, famine, mort) et la consolation et la protection que peut donner l’Église à travers le message du Christ à saint Jean. Les clés de voûte sont ornées de blasons des familles nobles du coin alors que la clé de voûte centrale figure l’écusson aux trois coquilles et aux deux perdrix des seigneurs de Bourcy.
Non loin de là se trouve le château-ferme de Bourcy, construit par phases successives du XVIIe au XIXe siècle et qui abritait les seigneurs du lieu sous l’Ancien Régime.
Bourcy
6600 Longvilly

Classé comme monument le 20 novembre 1972
Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove
Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix à Bastogne
Située en plein centre de la ville, dans l’artère commerçante, la petite chapelle Notre-Dame-de-la-Paix était autrefois dédiée à Notre-Dame-de-la-Halle. Située par ailleurs à l’angle de la rue de la Halle, elle abrite une haute vierge à l’enfant du 17e siècle, en bois polychromé (recouvert de plusieurs couches d’enduits divers).
Les murs de cette chapelle ont été blanchis et l’on y accède par une porte en verre et fer forgé ajoutée au 20e siècle. Un panneau de pierre replacé sur la façade latérale, daté de 1693, nous renseigne sur la date probable de construction de la première chapelle.
L’édifice actuel est en effet plus récent et daterait des alentours de 1845. Au début du 19e siècle, le maire de Bastogne souhaitait la démolition du bâtiment afin de favoriser la circulation à cet endroit ; elle fut donc détruite mais reconstruite à son emplacement actuel quelques années plus tard.
L’on raconte également qu’à la fin du 19e siècle, elle servait de lieu de rendez-vous aux campagnards qui venaient au marché vendre leurs œufs et leur beurre.
Rue du Sablon 99
6600 Bastogne

Classée comme monument le 30 novembre 1989
Institut du Patrimoine wallon

G. Focant
Ferme Schumer à Wardin
Le hameau de Bizory dépendait autrefois de la commune de Wardin, avant le rattachement de celle-ci à Bastogne après la fusion des communes en 1977. Ce petit village a fort souffert pendant l’offensive des Ardennes au cours de l’hiver 1944-1945, mais il est toutefois riche de deux édifices classés. Parmi ceux-ci, la ferme Schumer date de 1771 comme l’indique une inscription située au-dessus de la porte d’entrée. Occupée sans interruption par la même famille, elle est vouée à l’exploitation agricole et dispose de bâtiments annexes anciens. Jean Nicolas Schumer, né en 1769, est l’auteur d’un ouvrage paru en 1836 consacré aux maladies des chevaux, bêtes à cornes, moutons et porcs. Il y donne des conseils et des remèdes, en français et en luxembourgeois. Comme bon nombre d’autres fermes de la région, elle a été construite en moellons de grès crépis et blanchis. Non loin de là, l’ancienne chapelle Saint-Cunibert bénéficie elle aussi d’une mesure de classement.

Bizory
6600 Wardin

Classée comme monument le 5 octobre 1982
Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove
Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Conduite de Bastogne
Cette petite chapelle trapue construite en moellons crépis et dont les façades sont recouvertes d’ardoises a été érigée en 1673 comme l’indique une inscription gravée au-dessus de l’entrée.
Le culte de Notre-Dame-de-Bonne-Conduite semble lié à celui de Notre-Dame-de-Foy près de Dinant, d’où sont originaires les sœurs grises franciscaines qui s’étaient installées au couvent de Bethléem (rue Pierre Thomas à Bastogne). Des Bastognards se rendaient en effet en pèlerinage dans la petite localité de Foy-Notre-Dame pour demander sa protection.
La statuette présente dans la chapelle pourrait avoir été ramenée au cours d’un de ces voyages. L’édifice est situé à plus de deux kilomètres de la ville et avait pour voisin un ermite. Les voyageurs pouvaient ainsi venir se recueillir et demander protection sur le chemin qui les menait vers Arlon lorsqu’ils craignaient de faire de mauvaises rencontres.
C’est également à cet endroit que se réunissaient les membres de la Société Saint-Sébastien et que défilaient les communiants qui, peut-être, y faisaient la promesse d’avoir une « bonne conduite » ! la chapelle s’inscrit dans un petit site entouré d’arbres centenaires et d’un muret contre lequel vient s’intégrer l’un des nombreux vestiges de la bataille des Ardennes.
Chemin du Saiwet 10
6600 Bastogne

Classée comme monument et comme site le 30 novembre 1989
Institut du Patrimoine wallon
