
Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam
Statue saint ARNOULD
Statue de saint Arnould, réalisée par Victor Demanet, sur le pont de Liège 25 juin 1939 puis au bout du quai de la Tannerie après la Libération de 1945.
Sculpteur des rois et des reines, des soldats et des résistants, des personnages historiques lointains comme de personnalités contemporaines, Victor Demanet a fait de l’espace public, notamment de Wallonie, sa galerie d’exposition. Remarqué au Salon des Artistes français de Paris, en 1923, pour son buste de Bonaparte à Arcole, Victor Demanet s’est rapidement imposé comme un portraitiste de talent auquel sont confiées de nombreuses commandes publiques. Il a déjà participé à plusieurs expositions internationales et reçu d’importants prix et distinctions lorsque lui est confiée la réalisation de deux statues, l’une de saint Arnould et l’autre de Godefroid de Bouillon, destinées à la ville de Bouillon.
Dans la deuxième moitié des années 1930, la cité achève en effet d’importants travaux de voirie : dédoublement de la rue de la Maladrerie et création d’un nouveau quai qui dégage de nouvelles perspectives (circa 1937). S’inspirant du Pont Saint-Ange à Rome, les autorités locales ont par conséquent décidé de garnir les deux accès du pont de Liège des statues en question. Chargé de cette importante commande publique, Victor Demanet doit inscrire les deux statues sur un socle imposant (2,5 m de haut, sur 0,9 m de large) où viendront s’inscrire des bas-reliefs en bronze à motifs héraldiques.
Dès 1938, les statues d’Arnould et de Godefroid sont achevées par le sculpteur et peuvent être installées aux accès du Pont de Liège. La cérémonie d’inauguration, le 25 juin 1939, se déroule en grandes pompes. La duchesse de Vendôme (la sœur de feu le roi Albert Ier) a fait le déplacement. Mais quelques mois plus tard, lors de l’invasion allemande de mai 1940, aucune chance n’est laissée au Pont de Liège. Miraculeusement, le bombardement épargne les deux statues. À la Libération, il n’est plus question de les réinstaller sur le pont reconstruit. Elles sont séparées et le Godefroid de Bouillon escalade le contrefort pour trouver place à quelques mètres de l’entrée du château, tandis que le saint Arnould est relégué en bord de Semois, au bout du quai de la Tannerie. On l’aperçoit tant bien que mal depuis l’autre rive, en scrutant bien depuis le boulevard Vauban. Saint Arnould aura moins de visibilité que son homologue Godefroid.
Moins célèbre en dehors de Bouillon que l’homme des croisades, Arnould (ou Arnoul) n’en est pas moins considéré comme le premier dans la généalogie des ducs de Bouillon, descendant des comtes d’Ardenne. Né vers 582 à Lay-Saint-Christophe, près de Nancy, Arnoul serait le fils de Bodogisel et de Chrodoara (celle qui deviendra l’abbesse d’Amay). Ayant grandi au sein d’une noble famille franque, il est considéré comme le fondateur de la dynastie des Arnulfiens, famille alliée aux Pépinides. Aussi appelé Arnoul de Metz, il a gouverné l’Austrasie avec Pépin de Landen à l’époque des Mérovingiens (en l’occurrence Thibert II, la régente Brunehilde, puis Clotaire II). Fils d’Arnoul, Ansegisel épouse d’ailleurs Begge, la fille de Pépin, contribuant ainsi au développement de la dynastie carolingienne. Mais lassé par la vie de cour, Arnoul accepte d’être désigné évêque de Metz, alliant alors fonctions administratives et religieuses (613-628) ; il est à ce moment aussi précepteur du jeune Dagobert Ier. Mais il aspire à consacrer exclusivement sa vie à Dieu ; il renonce définitivement aux affaires de la cité et vit désormais en ermite solitaire jusqu’à son décès en 640. Godefroid en serait un lointain descendant. Décédé un 18 juillet de l’année 640 ou 641, Arnoul est fêté localement à cette date. Patron des brasseurs, il n’est pas le saint patron de Bouillon car c’est saint Eloi qui a ce titre.

Ayant grandi au confluent de la Sambre et de la Meuse où ses parents tiennent un commerce d’antiquités au cœur de la ville, Victor Demanet (Givet 1895 – Namur 1964) était appelé à leur succéder si ses études à l’Académie des Beaux-Arts (1916-1919), ne lui avaient pas donné le goût de la pratique de la sculpture. Élève de Désiré Hubin, Demanet eut la révélation en voyant des œuvres de Constantin Meunier et surtout celles traitant de la thématique sociale et ouvrière développée par le peintre/sculpteur bruxellois. Lors d’un séjour à Paris, les œuvres de Rude, Carpeaux et Rodin avaient fini de convaincre Demanet que sa voie était dans la sculpture. Comme d’autres artistes de son temps, il va réaliser plusieurs monuments aux victimes des deux guerres ; auteur de plusieurs dizaines de médailles, il poursuit aussi une œuvre plus personnelle à l’inspiration comparable à celle de Constantin Meunier, avec de nombreux représentants du monde du travail.
Les sculptures en pierre de Victor Demanet à Bouillon, Les jalons d’une ville n°3, dans http://bouillon.communesplone.be/shared/revue-communale/2008.09.pdf
http://www.sculpturepublique.be/6830/Demanet-GodefroidDeBouillon.htm
http://www.osotatarl.com/monument_chapuis.86.html#Ch%C3%A2teau%20Bouillon%2001 (s.v. novembre 2013)
Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 397
Jacques TOUSSAINT, Les médailles du sculpteur-médailleur Victor Demanet (1895-1964), dans Revue belge de numismatique et de sigillographie, Bruxelles, 1984, n°130, p. 141-204 + planches
Jacques TOUSSAINT, Victor Demanet dans Arts plastiques dans la province de Namur 1800-1945, Bruxelles, Crédit communal, 1993, p. 147
M-J-F. OZERAY, Histoire des pays, château et ville de Bouillon, depuis l’origine du Duché jusqu’à la révolution de 1789…, Luxembourg, 1827, p. 313
Le Guetteur wallon, 1961, n°3, p. 65
sur le pont de Liège puis au bout du quai de la Tannerie après la Libération de 1945
6830 Bouillon

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam
Monument Charles VAN LERBERGHE
Monument à la mémoire de Charles Van Lerberghe, 14 juin 1936
À l’initiative de la Société des Écrivains ardennais
À l’initiative de la revue Le Thyrse et spécialement de la Société des Écrivains ardennais, un hommage est rendu à Charles Van Lerberghe (Gand 1861 – Bruxelles 1907), à Bouillon, avec l’érection d’un bloc de granit avec inscription, à hauteur de la Vieille route de France. La cérémonie se déroule le 14 juin 1936. C’est en bénéficiant d’une vue exceptionnelle sur la Semois, en séjournant « à la Ramonette », que le poète gantois a composé sa Chanson d’Eve. L’inauguration est l’occasion pour la Société de céder officiellement le mémorial aux autorités locales. Plusieurs discours sont prononcés rendant hommage à Charles Van Lerberghe et le moment est aussi choisi pour remettre l’ordre de commandeur de la Légion d’honneur à Albert Mockel. Consul général de France à Liège, Fernand Sarrien a fait expressément le déplacement à Bouillon pour honorer le fondateur de La Wallonie – le mot comme la revue – ainsi que le poète qui assure des responsabilités au sein de l’association Les Amis de Charles Van Lerberghe. La date du 14 juin 1936 est celle du cinquantième anniversaire du symbolisme et de la revue qui illustra le mieux ce mouvement. Et comme il était écrit que cette journée du 14 juin 1936 serait exceptionnelle à plus d’un titre, le représentant des Écrivains de Belgique fait observer que, parallèlement, on inaugure à Bruxelles un monument en l’honneur de l’écrivain Hubert Krains qui, dans les Portraits d’Écrivains belges, avait consacré une analyse particulièrement fine à l’œuvre de Van Lerberghe.
Dans les milieux littéraires, en effet, la qualité de la poésie écrite en français par ce Gantois n’a échappé à personne. On loue sa liberté d’expression, l’absence d’influences sur son style et sur une production qui a réussi à éviter les modes. L’indépendance du poète lui a vraisemblablement coûté une audience plus grande de son vivant, mais il ne la recherchait pas. L’isolement dont il bénéficia lors de ses nombreux séjours aux portes de Bouillon correspondait parfaitement à son état d’esprit. Orphelin à ses 10 ans et de santé fragile, Van Lerberghe est élevé par un tuteur, oncle de Maurice Maeterlinck ; à ce duo d’adolescents se joint Grégoire Le Roy durant leurs humanités à Gand et l’on comprend aisément comment Van Lerberghe va cultiver la langue française avec délectation. S’il s’essaye à la philosophie à l’Université de Gand, la poésie devient son quotidien. Moins connu que ses anciens condisciples, il se fait plus rare : Les Flaireurs paraît en 1889, Entrevisions en 1898, avant qu’il ne parvienne pas enfin à achever La Chanson d’Ève (1904) qu’il portait en lui depuis longtemps. Mockel rapporte avoir partagé la lente maturation de la dernière œuvre de « son frère en poésie ». Les premiers vers sont écrits avant un voyage en Italie (vers 1900) ; une brève idylle avec une jeune Américaine inspire le poète qui découvre le paradis d’Eve dans un joli coin de Toscane (1901). Pourtant, c’est revenu à Bouillon que le poète laisse courir sa plume sur le papier, produisant d’un seul coup plusieurs milliers de vers sans contrainte. « Ici naquit le chef d’œuvre qui nous rassemble et dont l’esprit est parmi nous, dira Albert Mockel lors de son discours à Bouillon, le 14 juin 1936. Ce lieu nous est sacré. Que notre admiration y dépose les plus nobles palmes ». S’il ne pouvait « travailler que dans un beau trou comme Bouillon » comme il le disait lui-même, le poète gantois ne laisse jamais identifier les sources de son inspiration : aucune allusion directe à Bouillon, à la Semois ou à l’Ardenne ne figure dans son œuvre. Dans sa quête amoureuse, c’est aussi sous la forme de la rêverie que l’écriture évite la narration pour suggérer et exprimer une certaine souffrance.
Face au refus du propriétaire de la maison où avait logé le poète, le bloc de granit ne fut installé ni devant ni dans le petit espace latéral de la pension où fut composée La Chanson d’Eve. Certes, le titre de l’ouvrage figure aujourd’hui, bien visible, sur la façade du n°17, mais le monument a été installé cent mètres plus haut, le long de la chaussée devant les rochers. En 2007, à l’occasion du centenaire de la disparition du poète, la pierre de la Vieille route de France a été nettoyée à l’initiative des autorités locales de Bouillon. Sur le bloc en granit de 1936, l’inscription indique :
LE POETE
CHARLES VAN LERBERGHE

COMPOSA ICI
LA CHANSON D’EVE
SOCIETE DES
ECRIVAINS ARDENNAIS
1936.
Par ailleurs, une autre mention du séjour de Charles Van Lerberghe se retrouve dans le nom donné à un square situé en bord de Semois, sur le quai Vauban. Pendant de nombreuses années, la plaque en l’honneur du poète resta quelque peu perdue, à quatre mètres du sol, le temps faisant son œuvre au point de la rendre à peine lisible. En 2008, le lettrage a été redoré et la plaque en schiste du square Van Lerberghe a été replacée sur un rocher de l’ancienne plaine de jeux, entre le tunnel et le pont de Cordemois. Son inauguration a eu lieu le 14 septembre :
SQUARE
CHARLES VAN LERBERGHE
POETE AYANT SEJOURNE
A BOUILLON
DE 1899 A 1906
Informations collectées auprès de la propriétaire de la maison « Chanson d’Eve » (juin 2014)
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
Le Thyrse, 1er juillet-1er août 1936, n°7-8, p. 225
La Vie wallonne, juin 1936, CXC, p. 342-344
Hubert JUIN, Charles Van Lerberghe, Paris, Seghers, 1969, coll. Poètes d’aujourd’hui
http://www.arllfb.be/bulletin/bulletinsnumerises/bulletin_1936_xv_03.pdf (s.v. juillet 2013)
http://www.servicedulivre.be/sll/fiches_auteurs/v/van-lerberghe-charles.html (s.v. juin 2014)
Vieille Route de France
6830 Bouillon

Paul Delforge

IPW
Musée ducal et hôtel de ville de Bouillon
L’actuel hôtel de ville de Bouillon servait de palais ducal, sous le règne de la famille de la Tour d’Auvergne. Ce vaste ensemble enduit composé d’un bâtiment du XVIIe siècle, fortement reconstruit au XIXe siècle, situé à la pointe nord de l’esplanade du château et dominant la place ducale était donc la résidence du gouvernement bouillonnais.
Nationalisé après la Révolution française, le bâtiment devint officiellement l’hôtel de ville de Bouillon en 1840. Inscrite dans le périmètre de l’ancien palais ducal, la résidence au gouverneur du duché est intimement liée au palais princier.

Non loin de là, l’actuel musée ducal est installé dans un très bel hôtel particulier édifié par Nicolas-Joseph de Spontin, conseiller à la Cour souveraine du duché de Bouillon. Une cour s’étend face à l’entrée des bâtiments enduits de crépi blanchi et surmontés de toitures à la Mansart couvertes d’ardoises en schiste du pays. L’ensemble témoigne encore de l’esprit du XVIIIe siècle. En tant que musée d’histoire local, l’institution retrace plusieurs siècles d’histoire du duché.
Rue du Petit 1
6830 Bouillon

Frédéric MARCHESANI, 2013

SPW-Patrimoine
Château de Bouillon et fortifications de la ville médiévale et moderne

Le site de Bouillon a de tout temps été occupé pour son important attrait stratégique.
Le large méandre décrit par la Semois à cet endroit enserre un important éperon naturellement protégé par un escarpement rocheux et par la large rivière qui l’entoure.
Le site est occupé dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. À quelques centaines de mètres du site de l’actuel château, le plateau de la Ramonette qui culmine à 300 m d’altitude a lui aussi été occupé rapidement. Il servit d’assise au Moyen Âge à une première fortification qui prenait la forme d’une motte castrale destinée à défendre le château. Celle-ci, la tour de Beaumont, disparut définitivement en 1141.
Un premier château est quant à lui mentionné à Bouillon en 988. La construction de la seconde forteresse, à l’initiative du duc Godefroid de Bouillon, fut entamée sous son règne (1061-1100).

Toujours en grande partie debout, la forteresse domine ce site grandiose et répond parfaitement, de par sa position avantageuse, aux usages militaires du Haut Moyen Âge.
Le château et son système de défense ont sans cesse évolué jusqu’au XVIe siècle. Devenus ducs de Bouillon, les princes-évêques n’eurent de cesse de perfectionner cette machine de guerre censée protéger le sud de leur territoire face au royaume de France et au duché de Luxembourg.
À l’exception d’un élément de tour, peut-être médiéval, les bâtiments visibles de nos jours ne remontent pas au-delà du XVIe siècle. Les constructions médiévales ont en effet souffert du siège de Charles Quint en 1521. Il faut attendre 1551 et le règne de Georges d’Autriche pour que d’importants travaux soient réalisés : il fit construire la petite poudrière ronde, la porte à bossage et le frontispice du troisième châtelet d’entrée, la tour de l’Horloge et la tour d’artillerie qui porte son nom au début du château, la « tour d’Autriche ». Gravées sur celle-ci se trouvent les armoiries du prince-évêque millésimées de 1551.
La physionomie du site fut alors une première fois bouleversée et fit disparaître les éléments anciens ; contrairement aux croyances largement établies, le château ne conserve donc rien de l’époque du célèbre Godefroid de Bouillon.
L’arrivée des de la Tour d’Auvergne en 1591 ouvrit près d’un siècle de contestation entre les princes-évêques et cette famille pour l’obtention du titre de duc de Bouillon, un siècle sans travaux majeurs. La prise du château en 1676 par Louis XIV lors de la guerre de la ligue d’Augsbourg et la confirmation du titre aux vicomtes de Turenne en 1678 annoncèrent une nouvelle campagne d’importance.
Une plaque en l’honneur du roi de France se situe d’ailleurs au-dessus du porche en plein cintre d’entrée du château. Datée de 1684, elle mentionne également le duc de Bouillon Godefroid-Maurice de la Tour d’Auvergne et porte l’inscription latine « Ludovico Magno Galliar regi principum vindici belli pacis que arbitro Godef. Maurit. De Turre Avernae dei gratia bullionni dux (…)» (Louis le Grand, roi de France, justicier et arbitre de la guerre et de la paix. Godefroid-Maurice de la Tour d’Auvergne, par la grâce de Dieu, duc de Bouillon (…)). Vauban se rendit à Bouillon et, impressionné par le site, rédigea immédiatement un mémoire pour la fortification du château et de la ville. Dans un premier temps, les Français renforcèrent et modernisèrent les défenses du château : rehaussement des courtines, maisons pour officiers, casernes pour les troupes, nouvelle poudrière, nouvel arsenal. Dans un second temps, la ville se vit elle aussi fortifiée : les plans de Vauban apportèrent plusieurs courtines à créneaux, des portes, des casernes et l’édification de neuf tours bastionnées.

Une ancienne caserne de Vauban subsiste boulevard Heynen ; construit en 1690, ce bâtiment constitue un remarquable exemple de corps de caserne de cavalerie. Plus loin, se trouve l’ancienne infirmerie militaire. Parmi les ouvrages conservés en ville, les bastions de Bretagne, de Bourgogne et du Dauphin constituent des éléments caractéristiques de l’art défensif de l’époque. Ce sont de solides bâtisses de schiste en forme de pentagone percés de meurtrières et présentant une échauguette.

Esplanade Godefroy 1
6830 Bouillon

Frédéric MARCHESANI, 2013

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam
Statue Godefroid de Bouillon à Bouillon
Sculpteur des rois et des reines, des soldats et des résistants, des personnages historiques lointains comme de personnalités contemporaines, Victor Demanet a fait de l’espace public, notamment de Wallonie, sa galerie d’exposition. Remarqué au Salon des Artistes français de Paris, en 1923, pour son buste de Bonaparte à Arcole, Victor Demanet s’est rapidement imposé comme un portraitiste de talent auquel sont confiées de nombreuses commandes publiques. Il a déjà participé à plusieurs expositions internationales et reçu d’importants prix et distinctions lorsque lui est confiée la réalisation d’une statue de Godefroid de Bouillon destinée à la ville de Bouillon. Paradoxalement, en effet, il existe à Bruxelles, depuis 1848, l’impressionnante statue équestre réalisée par Eugène Simonis et à Liège, depuis 1884, une statue due au ciseau de Léon Mignon sur la façade du Palais provincial, mais Bouillon ne dispose d’aucune représentation de son plus illustre représentant. L’occasion de réparer cet oubli est offerte aux autorités locales au moment où s’achèvent d’importants travaux de voirie : jusque-là fort encombrée, la rue de la Maladrerie a fait l’objet d’un dédoublement et le nouveau quai dégage de nouvelles perspectives (circa 1937). À l’instar plus modeste du Pont Saint-Ange à Rome, les autorités locales décident de garnir les deux accès du pont de Liège d’une statue : l’une dédiée à Saint-Arnould, l’autre à Godefroid de Bouillon. La commande des deux œuvres est passée à Victor Demanet qui doit inscrire les deux statues sur un socle imposant (2,5 m de haut, sur 0,9 m de large) où viendront s’inscrire des bas-reliefs en bronze à motifs héraldiques.
Artiste certes aguerri, Victor Demanet est ainsi confronté au défi de supporter la comparaison avec ses illustres devanciers liégeois, tout en inscrivant « son » Godefroid dans l’histoire locale, celle du duché millénaire et de la ville natale de Léon Degrelle.
Réalisée en terre cuite en 1938, son étude (19 cm) convainc ses commanditaires et rapidement la statue de Godefroid de Bouillon, signée Victor Demanet et datée de 1938 (sur le côté droit du socle), peut être installée à l’un des deux accès du Pont de Liège. La cérémonie d’inauguration, le 25 juin 1939, se déroule en grandes pompes. La duchesse de Vendôme (la sœur de feu le roi Albert Ier) a fait le déplacement. Mais quelques mois plus tard, lors de l’invasion allemande de mai 1940, aucune chance n’est laissée au Pont de Liège. Le bombardement épargne miraculeusement les deux statues. À la Libération, il n’est plus question de les réinstaller sur le pont reconstruit. Elles sont séparées et le Godefroid de Bouillon escalade le contrefort pour trouver place à quelques mètres de l’entrée du château. Son socle est réduit au minimum, bénéficiant cependant de la pente du contrefort pour conserver le caractère dominateur qu’avait imaginé le sculpteur. Ni cheval ni cotte de maille, ni heaume ni épée, ni couronne ni drapeau, le Godefroid de Bouillon de Demanet est plutôt solennel, presque religieux, en partie caché ou protégé par un haut bouclier. Ostensiblement, sur le côté droit du duc lotharingien, apparaît un parchemin avec trois sceaux, et seule se lit la fameuse formule des croisés répondant à l’appel du pape Urbain II : « Dieu le veult ». On ignore si le sculpteur était ravi par l’emplacement choisi après-guerre pour sa statue, mais on sait que l’œuvre avait été appréciée. De nombreux exemplaires en petit format ont en effet été produits et vendus par la suite ; de surcroît, lors du neuf centième anniversaire de la naissance de Godefroid de Bouillon (1961), les talents de médailliste de Victor Demanet sont à nouveau sollicités pour la réalisation d’une médaille représentant en buste l’illustre chef de la croisade.
Ayant grandi au confluent de la Sambre et de la Meuse où ses parents tiennent un commerce d’antiquités au cœur de la ville, Victor Demanet (Givet 1895 – Namur 1964) était appelé à leur succéder si ses études à l’Académie des Beaux-Arts (1916-1919), ne lui avaient pas donné le goût de la pratique de la sculpture. Élève de Désiré Hubin, Demanet eut la révélation en voyant des œuvres de Constantin Meunier et surtout celles traitant de la thématique sociale et ouvrière développée par le peintre/sculpteur bruxellois. Lors d’un séjour à Paris, les œuvres de Rude, Carpeaux et Rodin avaient fini de convaincre Demanet que sa voie était dans la sculpture. Comme d’autres artistes de son temps, il va réaliser plusieurs monuments aux victimes des deux guerres ; auteur de plusieurs dizaines de médailles, il poursuit aussi une œuvre plus personnelle à l’inspiration comparable à celle de Constantin Meunier, avec de nombreux représentants du monde du travail.
Sources
Les sculptures en pierre de Victor Demanet à Bouillon, Les jalons d’une ville n°3, dans
http://www.sculpturepublique.be/6830/Demanet-GodefroidDeBouillon.htm
Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 397
Jacques TOUSSAINT, Les médailles du sculpteur-médailleur Victor Demanet (1895-1964), dans Revue belge de numismatique et de sigillographie, Bruxelles, 1984, n°130, p. 141-204 + planches
Jacques TOUSSAINT, Victor Demanet dans Arts plastiques dans la province de Namur 1800-1945, Bruxelles, Crédit communal, 1993, p. 147
Général GUILLAUME, Godefroid de Bouillon, dans Biographie nationale, t. 2, col. 802-819

Pont de Liège
6830 Bouillon

Paul Delforge
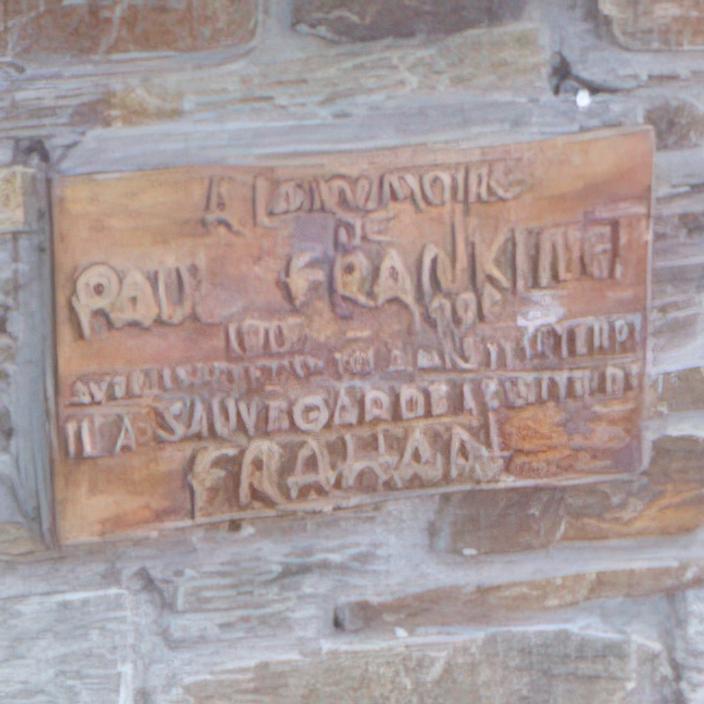
Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam
Stèle Paul FRANKINET
Pendant plusieurs années, l’architecte Paul Frankinet (1919 – 1999) a mené campagne contre la présence de campings installés de manière illégale sur le site de Frahan. Alors que le méandre formé par la Semois avait été relativement épargné par la présence humaine au cours du temps, l’implantation de deux campings au tournant des années 1960 et 1970 crée une situation nouvelle : le paysage naturel remarquable se trouve désormais envahi par des tentes, des voitures et des caravanes multicolores, sans oublier les baraques à frites, tandis que la vie traditionnelle du village est chamboulée par la présence massive et saisonnière des campeurs. Faisant valoir à la fois l’intérêt paysager, la préservation de la nature et le caractère illégal des exploitations, les Amis de la Terre se mobilisent autour de Paul Frankinet, leur représentant sur le terrain.
Architecte de formation et de profession, Frankinet a fait l’essentiel de sa carrière en Afrique ; s’il s’y est occupé de construire des maisons, il s’est surtout préoccupé de l’alphabétisation des populations. À la suite de l’indépendance du Congo en 1960, il est forcé de rentrer en Europe et choisit de s’installer à Rochehaut, en raison du cadre exceptionnel que lui offre le méandre de la Semois, à hauteur de Frahan. S’opposant au développement du tourisme de masse, Frankinet va, de manière plus générale, se préoccuper de conservation du patrimoine. Il était d’ailleurs membre de la Commission des Monuments et des Sites avant la régionalisation, il se préoccupe de la sauvegarde de la Lyresse et il contribue activement à la préservation du Couvent des Sépulcrines, au cœur de Bouillon, y rencontrant de vives oppositions, comme à Frahan.
En dépit des dispositions légales – des arrêtés d’interdiction de camping sont adoptés en 1972 ; le plan de secteur approuvé par la Région wallonne en 1984 classe le site en zone verte d’intérêt paysager ; le Conseil d’État valide le plan de secteur en 1987 contre le recours introduit par les propriétaires de camping –, la situation ne change pas sur le terrain ; avec l’aide des Amis de la Terre, Frankinet porte l’affaire en justice et, en juin 1989, le tribunal de Neufchâteau ordonne la cessation des activités et la remise du site dans son état d’origine, endéans une année. Ce succès fait l’objet d’un article dans le tout premier numéro (n°0) de la revue des ami(e)s de la Terre (août 1989). Alors que de nouvelles caravanes résidentielles sont installées, un véritable bras de fer oppose les parties en présence, créant l’agitation dans toute la région. Finalement, en septembre 1990, les campings illégaux sont définitivement fermés. Paul Frankinet a fini par remporter une vraie guerre d’usure, non sans que l’atelier de céramique de son épouse ne pâtisse de sa détermination. En janvier 1992, en effet, une intrusion nocturne se solde par la mise à sac de la poterie de la rue des Moissons, à Rochehaut. En février 1991, Frankinet avait été distingué par Inter-Environnement Wallonie qui, en lui décernant sa palme 1990 de l’environnement, entendait renforcer sa lutte contre l’installation des campings industriels dans les fonds de vallée et favoriser, sur les hauteurs, un tourisme respectueux de la nature et de ceux qui vivent en permanence à la campagne. Quant aux épicéas plantés dans les vallées, ils étaient aussi dans la ligne de mire de Frankinet d’IEW : dans les années 2000 plusieurs projets, soutenus par l’Europe et l’OWDR, rencontrent cette préoccupation. En 1997, à l’initiative du ministre-président Robert Collignon, le site de Frahan fait l’objet d’un arrêté de classement au Patrimoine majeur de Wallonie.
Quelques mois après le décès de Paul Frankinet est lancée l’idée d’élever un monument en mémoire de ce défenseur de l’environnement. Mais aucune autorisation n’est accordée par les autorités locales pour élever un monument privé sur une propriété communale (2000). Finalement, c’est en bord de trottoir, sur un terrain privé que, le 31 octobre 2004, en présence des responsables des Amis de la Terre-Belgique et du voisinage, une stèle est inaugurée,
A la mémoire
de
PAUL FRANKINET
1919 – 1999
Avec le soutien des AMIS de la TERRE
IL A SAUVEGARDÉ LE SITE DE
FRAHAN
Cette plaque en céramique est fixée sur la face avant d’une stèle rectangulaire formée de pierres de schiste de la région. Au sommet du monument qui ne dépasse pas le mètre de hauteur, se trouve un cadran solaire en bronze. Le cadran est l’œuvre de Laure Frankinet, la fille de Paul et de Denise Frankinet, cette dernière étant à l’initiative du monument et la créatrice tant de la stèle que de la céramique. Sculpteur, dessinatrice et pastelliste, Laure Frankinet (Stanleyville 1955 – Rochehaut 1998) s’est formée à La Cambre (auprès de Rik Poot) en choisissant la sculpture monumentale. Installée à Oisy, elle réalise, à partir du métal, des œuvres inspirées des femmes, des enfants ou des chevaux, pleines de fantaisie. Son travail s’apparente en quelque sorte à celui d’un artiste-forgeron ; en 1998, elle participe activement aux Eurofêtes, à Viroinval, au Trou du Diable et l’année suivante, ses œuvres font l’objet d’une exposition d’hommage. Denise Frankinet, pour sa part, elle aussi diplômée de La Cambre, est avant tout céramiste, même si elle signe de nombreuses aquarelles représentant… des paysages. En 2012, il fait paraître un roman, Le Requiem de Carlsbad qui porte aussi la signature de Paul Frankinet.
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, en particulier Le Soir (1989-1991 et 12 février 1991)
Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 588
http://www.molignee-ecologie.be/hommages/renee_christine_bequet/renee_christine_bequet.htm
http://www.molignee-ecologie.be/hommages/renee_christine_bequet/contenu.htm (s.v. avril 2015)

Rue des Moissons 17
6830 Frahan (Rochehaut)

Paul Delforge

D'autres traces liées au duché de Bouillon
Plusieurs autres bâtiments et monuments sont liés de près ou de loin au passé bouillonnais, parmi lesquels ceux cités ci-après.
1. Bouillon, ancien hôpital civil, édifié par le duc de Bouillon Emmanuel de la Tour d’Auvergne. Important ensemble de style traditionnel construit en 1633.
2. Bouillon, maison Dorival, résidence de plusieurs présidents de la Cour souveraine.
3. Bouillon, couvent des Sépulcrines, fondé par le prince-évêque de Liège Ferdinand de Bavière.
4. Bouillon, maison du prévôt. Demeure construite en même temps que les casernes, dans le dernier tiers du XVIIe siècle. Logement du commandant de la place.
5. Bouillon, ancien corps de garde de la Porte de la Poulie, une des portes d’accès de la ville construite par Vauban.
6. Bouillon/Dohan, château de Dohan, siège d’une seigneurie du duché de Bouillon. Rebâti en 1619 par Florent Lardenois de Ville, seigneur de Dohan et capitaine-prévôt de Cugnon-Chassepierre. Manoir en schiste et grès des XVIIe et XVIIIe siècles surplombant la Semois.
7. Bouillon/Ucimont (Botassart), château de Botassart, ancien siège de la seigneurie du même nom (Botassart était une des 4 « siries » du duché de Bouillon – sortes de pairies).
8. Paliseul/Carlsbourg, école d’agriculture, ancien château de Carlsbourg, ayant appartenu aux ducs de Bouillon. Transformé et aménagé dans le troisième quart du XVIIIe siècle par les de la Tour d’Auvergne.
9. Paliseul/Opont (Beth), ancien château des Abbyes ou château de Beth, résidence du seigneur des Abbyes (remanié par la suite).
10. Bièvre/Gros-Fays, château-ferme de Gros-Fays, siège d’une seigneurie hautaine du duché de Bouillon aux mains des Lamock (se trouve sur le territoire du duché de Luxembourg, prévôté d’Orchimont). Manoir traditionnel construit par Florent de Lamock en 1684, constitué d’un corps de logis flanqué de deux tourelles et de dépendances du XVIIIe siècle.

Frédéric MARCHESANI, 2013

Jo Van Hove
Moulin du Rivage à Ucimont-Botassart (Bouillon)
Le site d’Ucimont est connu depuis la fondation, au XVIe siècle, d’une église dédiée à saint Nicolas. Précédemment, il constituait une simple terre placée sous la dépendance directe des ducs de Bouillon. Botassart était, quant à elle, une des quatre siries du duché. Le premier seigneur du lieu, Jean de Botassart, est cité dans les textes au XIVe siècle. En 1841, les deux villages sont joints et forment une commune indépendante jusqu’à leur rattachement à Bouillon en 1977.
Le site est caractérisé par son célèbre « tombeau du géant » et s’inscrit au cœur d’une nature typique des paysages ardennais. Classé patrimoine naturel d’intérêt paysager, le « tombeau » s’élève au centre d’un des nombreux méandres de la Semois et sa plaine alluviale a récemment été restaurée en prés de fauche. Au milieu des arbres et des sentiers se dresse le moulin du Rivage, là où le « grand ruisseau » se jette dans la Semois, face au site du « tombeau ».
Cet ancien moulin isolé se présente sous la forme d’un ensemble clairsemé situé sur la rive ouest du ruisseau et composé de volumes en schiste datant d’époques diverses relativement récentes. La partie la plus ancienne est constituée par une construction, sans doute du début du XIXe siècle. Est greffé à celle-ci, un logis du milieu du XIXe siècle. Et, isolé du coté nord, subsiste un fournil de la même époque. À proximité se trouvent, enfin, des vestiges de bâtiments et de murets bordant le ruisseau qu’enjambe un petit pont de schiste.
Moulin du Rivage
6833 Ucimont-Botassart (Bouillon)

Classé comme monument le 4 avril 1990
Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove
Chapelle de l'Immaculée Conception d'Ucimont-Botassart
Sous l’Ancien Régime, Botassart était une des quatre scieries du duché de Bouillon. Le premier seigneur du lieu, Jean de Botassart, est cité dans les textes au 14e siècle. Ses descendants passent la main à la famille de Lamock au 16e siècle ; celle-ci s’attache à donner à Botassart un certain cachet, notamment sur le plan architectural en érigeant une chapelle et un château.
En 1841, Ucimont et Botassart sont joints et forment une commune indépendante jusqu’à leur rattachement à Bouillon en 1977. Le site est caractérisé par son célèbre « tombeau du géant » et s’inscrit au cœur d’une nature typique des paysages ardennais.
Située au milieu de son ancien cimetière cerné de murs, la chapelle de l’Immaculée Conception est un petit édifice construit dans le premier tiers du 17e siècle en moellons de schiste, pierre traditionnelle de l’Ardenne.
L’église est composée d’une nef unique terminée par un chœur à trois pans. On y accède par une porte surmontée d’une dalle décorée des armoiries de la famille De Lamock-De Copin qui a fourni les fonds nécessaires à sa construction. Cette pierre est datée de 1624. De nombreuses dalles funéraires de membres de cette famille se trouvent encore à l’intérieur et datent des 17e et 18e siècles. Dans le chœur se trouve un très bel autel à retable en bois peint et, dans la nef, sont conservés dix-neuf bancs en chêne contemporains de la construction de la chapelle.
Rue de Neumoulin
6833 Ucimont-Botassart

Classé comme monument le 17 décembre 1981
Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove
Église Saint-Lambert de Sensenruth
Le village de Sensenruth abrite l’édifice le plus ancien du duché de Bouillon. La première mention d’une église dédiée à saint Lambert date de 1069 au moment où elle figurait dans les biens de Godefroid le Barbu, duc de Basse-Lotharingie. À cette date, il l’offre à l’abbaye de Saint-Hubert, donation confirmée par le pape Innocent II en 1139.
Depuis 1096, le duché de Bouillon fait partie des possessions de l’évêque de Liège, mais déjà au moment de son édification, l’église est située dans le diocèse de Liège. On doit ainsi y voir un rapport avec la dédicace : saint Lambert, assassiné à Liège vers 700, est le patron du diocèse.
Dressée au milieu de son ancien cimetière, l’église a été construite en schiste et entièrement recouverte d’un enduit clair. Elle est composée d’une seul nef construite entre 1696 et 1707 et d’un chœur datant pour sa part du XVIe siècle. Rien ne subsiste donc de l’édifice roman construit au XIe siècle.
Le clocher est recouvert d’ardoises et surmonté d’une flèche octogonale. L’intérieur est tout aussi exceptionnel : on y trouve un fragment de vitrail polychrome du XVIe siècle représentant le Christ en croix entouré de saint Jean et de la Vierge, inséré dans des vitraux modernes placés en 1963.
Des fouilles archéologiques ont mis au jour un fragment des fonts baptismaux du XIIe siècle, aujourd’hui maçonné dans un mur de la nef. Parmi les belles croix funéraires présentes à l’extérieur, certaines datent du XVIIIe siècle.

Rue Saint-Lambert
6832 Sensenruth

Classée comme monument le 30 octobre 1989
Institut du Patrimoine wallon
