
Delhaize Jean-Jacques
Socio-économique, Entreprise
Ransart 1805, Ransart 1857
Présente à Ransart depuis plusieurs générations, la famille Delhaize est traditionnellement occupée dans le domaine du négoce. Ainsi, Jean-Jacques Delhaize tient-il commerce à la fois en vins et en charbon. Il mène son activité de manière traditionnelle pour nourrir une famille nombreuse comprenant neuf garçons et deux filles, nés de son mariage avec Joséphine Ponsart (1806-1893). Les affaires prospèrent suffisamment pour permettre d’offrir une formation aux garçons qui le souhaitent : ils seront professeurs – sciences commerciales, latin, français –, surveillant-éducateur, médecin-vétérinaire, voire militaire. Lorsqu’il décède en 1857, le père Jean-Jacques Delhaize est loin d’imaginer que la destinée de ses enfants. En s’illustrant principalement dans le commerce, ils vont être les fondateurs du groupe multinational Delhaize Le Lion, et des chaînes de distribution Louis Delhaize et AD Delhaize. L’exemple paternel inspire en effet Jules (1829-1896), Auguste (1838-1895), Louis (1833-1897), Édouard (1835-1888) et Adolphe (1840-1899), tous impliqués dans l’émergence d’un nouveau modèle de la distribution alimentaire moderne et de ses multiples diversifications.
Sources
Emmanuel COLLET, Pierre DUMONT, Jacques WITMEUR, Delhaize « Le Lion » : épiciers depuis 1867, Bruxelles, Racine-Groupe Delhaize, 2003
Nicolas COUPAIN, Serge JAUMAIN, Ginette KURGAN-VAN HENTENRYK, La distribution en Belgique : Trente ans de mutations, Bruxelles, Racine, 2005
Serge JAUMAIN, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 190-193
Paul Delforge

De Gorge Henri
Socio-économique, Entreprise
dit DE GORGE-LEGRAND
Orsinval (Villers-Pol) 12/02/1774, Hornu 22/08/1832
Aîné d’une famille nombreuse et paysanne du nord de la France dont l’aisance lui permet de suivre une formation aux collèges du Quesnoy et de Bavay, Henri Degorge est attaché à l’Intendance de l’Armée de Sambre-et-Meuse en 1795, devient fournisseur des armées sous le Consulat et l’Empire, tout en se spécialisant dans le négoce de charbon. Son mariage, en 1800, avec Eugénie Legrand, fille d’un grossiste lillois, favorise des affaires qui prospèrent et lui permettent de se porter acquéreur, en 1810, d’une concession houillère sur les terres de l’ancienne abbaye de Saint-Ghislain. À proximité du canal Mons-Condé en cours de réalisation, le site est reconnu comme difficile, les eaux s’engouffrant systématiquement dans les percements. Après plusieurs essais infructueux, il tombe sur une veine présentant d’excellentes qualités et parvient à assécher les travaux miniers (1814). Aidé de ses frères, il commence à récolter le fruit de ses efforts à partir de 1816. Propriétaire et directeur des charbonnages du Grand-Hornu, dans le Couchant de Mons, il achètera encore d’autres concessions plus au sud et exploitera le Grand Bouillon.
Afin de conserver les mineurs à proximité de son exploitation principale et de disposer de locaux administratifs et de maintenance, Henri Degorge réalise, à partir de 1823, un ambitieux projet architectural sous la forme d’une cité ouvrière modèle, comprenant 500 maisons avec jardin, des places publiques et des rues conduisant vers les différents puits, des salles de classes et autre bibliothèque. Conçu par l’architecte tournaisien Bruno Renard, le site du Grand-Hornu est achevé à l’entame des années 1830, avec la fameuse salle de l’Atelier de Construction de Machines à Vapeur et de Mécaniques (1831-1832). Sur le site charbonnier, la société fondée par Degorge allait en effet s’avérer capable de fabriquer toutes sortes de machines pour l’exploitation des mines ou d’autres industries.
On peut citer un autre aspect de l’esprit d’innovation dont fit preuve l’entrepreneur. Ayant vu fonctionner en Angleterre les premiers chemins de fer, celui qui a pris l’habitude de scinder son nom de famille en deux et d’y accoler celui de sa belle-famille se lance aussi dans la construction d’une des tout premières lignes ferrées privées du pays wallon. Dès l’été 1830, une voie à petite section conduit le charbon de la mine vers le canal ; des chevaux assurent la traction. Ce bouleversement dans le mode de transport sera particulièrement mal apprécié par les charretiers et autres boteresses ; à la faveur des événements révolutionnaires de septembre et octobre 1830, les mécontents viendront saccager et arracher les rails de ce dangereux concurrent, tout en semant la pagaille sur l’ensemble du site.
Essentiellement préoccupé par la bonne marche de ses affaires, Henri De Gorge-Legrand slalomera entre les grandes idées politiques de son temps. Élevé dans la foi catholique, il accède à d’importantes responsabilités au sein de la franc-maçonnerie lilloise. Ayant obtenu la nationalité des Pays-Bas en 1825, il se montre pro-orangiste avant 1830, réunioniste en 1830 et défenseur de l’indépendance belge après 1830… Membre du Comité provincial d’Industrie, de Commerce et d’Agriculture du Hainaut (1831-1832), il est choisi comme sénateur par les catholiques de l’arrondissement de Mons ; il siège à la Haute Assemblée du 29 août 1831 jusqu’à son décès, dû au choléra.
Sources
Revue du Conseil économique wallon, n°74-75, mai 1965, p. 54-56
Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 138-139
Hubert WATELET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 166
Léopold DEVILLERS, dans Biographie nationale, t. X, col. 115-117
Paul Delforge

Defuisseaux Nicolas
Politique, Révolutions, Socio-économique, Entreprise
Mons 02/02/1802, Baudour 24/11/1857
Le nom de Nicolas Defuisseaux figure parmi ceux d’un millier d’acteurs majeurs de 1830 proposés, en 1831, pour recevoir la Croix de Fer. Une Commission officielle du jeune État belge a en effet retenu qu’au cours des journées de la révolution de 1830, ce jeune avocat montois a contribué « à développer l’esprit national et à organiser la résistance aux actes oppressifs du gouvernement déchu ; il remplit plusieurs missions délicates et périlleuses au nom du gouvernement provisoire, fut chargé de procéder à l’instruction des troubles au Borinage, et effectua lui-même les premières arrestations ». « Héros de 1830 », ce fils de la « bonne » bourgeoisie libérale montoise (son père était bijoutier) était un passionné, doté d’une forte personnalité. En témoignent ses plaidoiries à la Cour d’Assises de Mons à la fin des années 1820, qui lui valurent d’être désigné à la tête du jeune barreau montois, et ses interventions en tant que Commissaire du gouvernement en 1831 qui contribuèrent à rétablir l’ordre social.
Nommé major ff. du commandement de la garde civique de Mons (1838-1848), auditeur militaire pour la province de Hainaut en 1842, il est élu conseiller communal de Mons, puis conseiller provincial du Hainaut en 1838 et défend le programme du parti libéral, en se préoccupant à la fois de favoriser le développement économique et l’amélioration du sort des moins favorisés. En 1852, il entre à la Haute Assemblée comme sénateur élu direct de l’arrondissement de Mons, mais renonce à son mandat dès 1854, porté par un autre projet.
À côté de son implication dans la vie publique, ce porteur du diplôme de docteur en Droit de l’Université de Gand – à l’époque les cours s’y donnent encore en français – a décidé d’abandonner aussi son métier d’avocat au barreau de Mons (1854), pour se consacrer entièrement à la Manufacture de Porcelaine de Baudour, qu’il a rachetée six ans plus tôt. Il est à la tête de quatre faïenceries et de près de 200 personnes. Les services de table, la spécialité de sa société, sont très en vogue à l’époque et les affaires prennent de l’ampleur quand la mort surprend l’entrepreneur, laissant à sa veuve la responsabilité de l’entreprise et la charge de leurs trois enfants, Léon (1841-1906), Alfred (1843-1901) et Fernand (1848-1912). Tous avocats, hormis Fernand, ils feront de la politique, étant tous les trois parlementaires du POB, après l’adoption du suffrage universel tempéré par le vote plural. Mais seul Fernand aidera leur mère, Louise Eléonore Messine (1810-1881) dans la direction des affaires qui prennent une tournure exceptionnelle : la Manufacture de Porcelaine de Baudour devient en effet le seul producteur du pays en porcelaine industrielle pour matériel électrique.
Sources
Liste nominative de 1031 citoyens proposés pour la Croix de Fer par la Commission des récompenses honorifiques (p. 1-129) dans Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de Belgique, n°807, 1835, t. XI, p. 28-29
Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 136
Histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999, p. 392
Jean PUISSANT, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 165-166
Marie ARNOULD, dans Nouvelle Biographie nationale, t. 7, p. 93-95
Histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999, p. 392
Cédric PIECHOWSKI, La porcelaine électrique, de l’utilitaire au design, dans Art et industrie, Art&Fact, numéro 30, Liège, 2011, p. 116-119
Jules DELECOURT, dans Biographie Nationale, t. V, col. 86-87
Paul Delforge

Defuisseaux Fernand
Politique, Socio-économique, Entreprise
Mons 04/02/1848, Mons 29/06/1912
Dernier né du couple Nicolas Defuisseaux-Louise Eléonore Messine, Fernand est le frère de Léon et Alfred Defuisseaux et deviendra, comme eux, parlementaire au lendemain de l’introduction du suffrage universel tempéré par le vote plural. À la différence de ses frères, Fernand n’a pas suivi des études de Droit ; par contre, il s’est très tôt intéressé à la gestion de l’entreprise familiale achetée en 1848 par son père et gérée par sa mère après la disparition de ce dernier (1857). Spécialisée dans les services de table, article très en vogue à l’époque, la Manufacture de Porcelaine de Baudour s’est orientée vers la fabrication de porcelaine industrielle pour matériel électrique qui en fait la seule industrie du genre du pays. C’est vers 1870 que la faïencerie familiale s’oriente vers la production d’isolateurs en porcelaine. En 1875, la veuve N-J. Defuisseaux décroche un premier contrat avec le gouvernement français, pour la fourniture de 270.000 isolateurs électrotechniques. Le stade du million de pièces est rapidement dépassé, la société trouvant de nouveaux débouchés commerciaux dans un secteur en pleine expansion.
Successeur de L-E. Messine, Fernand Defuisseaux rachète les parts de ses frères et devient seul propriétaire, en 1883, des Usines Defuisseaux qu’il transforme, en 1898, en société anonyme Produits céramiques de Baudour. Dans leur secteur d’activités, les manufactures Defuisseaux occupent le premier rang. Spécialiste numéro 1 de la porcelaine, l’entreprise de Baudour fabrique aussi bien de la vaisselle de table haut de gamme et courante, des têtes de poupées, des statues, que les produits destinés aux lignes téléphoniques, télégraphiques et électriques, autant de domaines en plein développement.
Comme ses frères, Fernand Defuisseaux se laissera attirer par la politique. De 1883 à 1894, il siège au nom du parti libéral au Conseil provincial du Hainaut. Après quelques années d’interruption, il reçoit le soutien des électeurs socialistes de l’arrondissement de Mons-Soignies qui lui demandent de les représenter à la Haute Assemblée. Sénateur direct (27 mai 1900), il siège jusqu’au 26 juin 1912, soit trois jours avant son décès. Les successeurs de Fernand Defuisseaux, via son gendre Charles Greyson, feront les beaux jours des établissements de Florennes et Baudour, jusque dans les années 1970 : la vaisselle de table est abandonnée, tandis que la société NGK reprend les activités « électriques ».
Sources
Jean PUISSANT, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 165-166
Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 136
Histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999, p. 392
Jules DELECOURT, dans Biographie Nationale, t. V, col. 86-87
Cédric PIECHOWSKI, La porcelaine électrique, de l’utilitaire au design, dans Art et industrie, Art&Fact, numéro 30, Liège, 2011, p. 116-119
Paul Delforge

De Fontaine Pierre-Joseph
Socio-économique, Entreprise
dit DE FONTAINE-SPITAELS
Mons /1779, Mons /05/1833
Marchand de charbon, propriétaire de charbonnages dans le Borinage, Pierre de Fontaine va également s’engager dans le secteur de la banque après son mariage avec Jeanne-Françoise, fille du banquier montois Jean Spitaels. Dans les années 1820, il décide d’investir toute sa fortune dans le financement de la métallurgie qui se met en place dans le bassin de Charleroi. Après avoir financé en partie les projets de Paul Huart-Chapel, ce « capitaliste » imagine de monter un complexe de sidérurgie intégrée similaire et entreprend, avec Paul Henrard, de construire deux hauts-fourneaux à Couillet et de commencer l’exploitation de charbonnages à Marcinelle-Nord et à Châtelet, ainsi que d’une carrière de castine, à Couillet dont la maison Fontaine-Spitaels se porte acquéreuse. À Couillet toujours, sont encore construits deux machines soufflantes de 50 chevaux chacune et cent fours à coke. Avant que n’éclate la Révolution de 1830, Fontaine-Spitaels dispose de plusieurs hauts-fourneaux auxquels s’ajoute le haut-fourneau au coke des Hauchies, provenant de la société Huart-Chapel absorbée au sein d’un même ensemble industriel (8 juin 1830). En mai 1831, Fontaine-Spitaels rejette la proposition du Congrès national de Belgique lui offrant le mandat de député de Mons.
Aidé par son jeune neveu, Ferdinand Spitaels, le projet industriel de Pierre-Joseph de Fontaine-Spitaels pâtit cependant d’un manque de capitaux et, après le décès de l’ambitieux entrepreneur, ses sociétés – tant bancaires qu’industrielles – sont mises en liquidation. Cependant, l’investisseur avait vu juste ; plus tard, le succès sera au rendez-vous sous la direction de Ferdinand Spitaels et de la Société Générale. L’ambitieux projet industriel du précurseur P-J. de Fontaine lui survivra sous la forme de la « SA des hauts-fourneaux, Usines et Charbonnages de Marcinelle et Couillet », constituée le 1er juillet 1833, et qui deviendra le fleuron de la Société Générale dans le bassin de Charleroi au XIXe siècle.
Sources
Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 560
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 330 ; t. II, p. 28
Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995
Paul Delforge

De Dorlodot Eugène Charles
Socio-économique, Entreprise
Bruxelles 01/02/1823, Carlsbad (Tchéquie) 25/07/1891
Depuis la fin du XVIIe siècle, le nom des Dorlodot est associé à l’industrie du verre à Charleroi. Depuis dix générations, cette famille de maîtres-verriers est installée en bord de Sambre où prospère l’établissement du Faubourg. Cependant, depuis les années 1820, le nom des Dorlodot est cité à côté de celui des Cartier d’Yves, Huart-Chapel, Puissant et autres Houyoux en raison des investissements considérables réalisés pour moderniser le secteur de la métallurgie et leur contribution à la révolution industrielle dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. Sur son site d’Acoz et Bouffioulx, Eugène de Dorlodot est à la tête d’une entreprise qui n’a rien à envier à celle des Cockerill. C’est à la gestion de ces hauts-fourneaux et laminoirs ultra-modernes pour l’époque qu’est associé Eugène-Charles, son fils aîné.
Très jeune, il s’impose comme un chef d’entreprise particulièrement audacieux et très heureux dans l’ensemble de ses choix. On vante « ses capacités intuitives d’administration, de fabrication et surtout de négoce » au point d’être entouré d’une véritable aura, et que ses concurrents calquent leurs stratégies sur ses initiatives.
À partir de 1858, Eugène Charles est seul à bord des forges d’Acoz qui atteignent leur apogée vers 1870, comptant davantage d’ouvriers que Cockerill par exemple, et produisant davantage de tonnes d’acier que les usines liégeoises. Craignant un trop grand isolement de ses usines d’Acoz, il déplace une partie de leurs activités vers le cœur du bassin houiller du Hainaut, et surtout à proximité des axes de communication fluviaux et ferroviaires ; choisissant Châtelineau, il y construit le plus grand laminoir du bassin de Charleroi (1870-1872).
Comme son père, auquel il succède comme bourgmestre d’Acoz en 1869, Eugène Charles de Dorlodot est aussi attiré par la politique. En août 1870, il remplace à la Chambre des représentants Dominique Jonet, ce maître verrier qui est le demi-frère de son cousin Léopold. Député de l’arrondissement de Charleroi, E-C. de Dorlodot est membre du parti catholique et aspire au renouvellement de son mandat, en juin 1874. L’échec politique qu’il essuie alors est souvent présenté comme la raison de son départ jugé précipité de Charleroi. Ce n’est qu’en 1877 qu’il abandonne ses fonctions de bourgmestre d’Acoz.
En fait, depuis quelques années, il fait l’objet d’une pressante sollicitation de la part d’un groupe d’investisseurs français qui lui proposent de prendre la direction d’un projet industriel dans le nord de la France. Étant engagé dans son projet industriel personnel à Châtelineau et investi de responsabilités politiques à la Chambre, il hésite jusqu’au moment où il perd son mandat parlementaire. Sa décision est alors prise. Cédant les entreprises familiales à la SA des Forges d’Acoz (fondée en 1872), il se désintéresse de toutes ses activités industrielles dans le pays de Charleroi pour prendre la direction des Aciéries de France, qui doivent comprendre hauts-fourneaux, laminoirs, ateliers, mines de fer, charbonnages, lignes ferroviaires et canaux dans le nord de la France. En acceptant le management du projet français, il a posé ses conditions ; contre la garantie qu’il apporterait le succès, il obtient les pleins pouvoirs et une participation plantureuse aux bénéfices.
C’est en s’entourant d’une partie de son ancien personnel wallon, tant des employés que des ouvriers, qu’il organise toutes les activités des Aciéries de France (1881), transférant de l’autre côté de la frontière à la fois un précieux savoir-faire et une réputation de patron exceptionnel dont bénéficient les Aciéries d’Isbergues, les Forges et Laminoirs de Grenelle, ainsi que les Mines et Usines de la régie d’Aubin. Lors de l’Exposition universelle de Paris, en 1889, les spécialistes français reconnaissent « le rôle immense de la Société des Aciéries de France dans la métallurgie de notre pays. Grâce à M. de Dorlodot, l'industriel le plus hardi et le plus heureux peut-être de notre temps, l'acier a pu être livré à la consommation à son prix minimum. C'est lui qui a pour ainsi dire, terminé l'œuvre de Bessemer, en en tirant les dernières conséquences au point de vue humain. Le nom de Dorlodot restera lié désormais à cette étape métallurgique décisive, maintenant franchie ».
Contrairement à ce que disent certains travaux, Eugène Charles n’est pas l’époux de la fille du sénateur catholique Sylvain Pirmez ; mais le mariage, en 1852, de Marie Pirmez-Bastin avec son frère, Charles Auguste Joseph de Dorlodot (1830-1902), témoigne des liens étroits qui unissaient milieux industriels et politiques au XIXe siècle. Marié en 1844 à sa cousine Amélie Marie Mathilde de Dorlodot (1823-1903), Eugène Charles disparaît sans laisser de descendance.
Sources
Revue du Conseil économique wallon, n°40, septembre 1959, p. 68-69
Revue du Conseil économique wallon, n°54-55, janvier-avril 1962, p. 80-81
La Belgique héraldique, t. IV, p. 13-19
Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 164
Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 131
Francis LAUR, Les mines et usines en 1889. Étude complète sur l’exposition universelle de 1889, Paris, 1890
Paul Delforge

De Dorlodot Léopold
Socio-économique, Entreprise
dit aussi De Dorlodot-MORIAMÉ
Baisy-Thy 28/10/1805, Lodelinsart 23/02/1870)
Descendant de maîtres-verriers implantés à Charleroi depuis le XVIIe siècle, Léopold de Dorlodot est le représentant de la 10e génération de cette importante famille ; petit-fils de Jean-Baptiste (1723- ?), Léopold ne connaîtra guère son père, Léopold, décédé en 1809. Sa mère s’étant remariée avec le meunier Joseph Jonet, actif à Sart-Dame-Avelines, Léopold de Dorlodot reste impliqué dans les activités de ses oncles et cousins. Ayant épousé en 1825 sa cousine germaine, Sophie de Dorlodot, la fille d’Édouard-Michel (1739-1816) et la sœur d’Édouard-François (1783-1869), le jeune Léopold participe à la gestion des usines familiales et, en 1826, se voit confier la direction de l’usine du Faubourg, le siège historique des Dorlodot. Comme l’indique le pedigree de Léopold, le métier de verrier ressemble à une chasse gardée ; les secrets de fabrication font l’objet d’une attention toute particulière ; le métier est protégé. Au sein de la profession, la corporation des souffleurs défend également ses membres ; on évite les souffleurs étrangers, qualifiés de bâtards, pour privilégier les souffleurs de sang. Mais face aux prétentions de ces derniers, le jeune Léopold de Dorlodot introduit la concurrence, assure la formation d’apprentis et augmente par conséquent le nombre de « spécialistes ». L’esprit d’entreprise et la chasse à toutes formes de protectionnisme conduisent d’ailleurs l’intrépide de Dorlodot à s’introduire aux Pays-Bas dès janvier 1831 pour y renouer des échanges commerciaux. Démasqué alors qu’il voyage sous passeport français, il connaîtra pendant quelques heures la paille des prisons de Nimègue.
Au décès successif de sa mère (1835) et de sa belle-mère, Philippine de Beelen-Bertholff (1835), il hérite des établissements du Faubourg dont il assurait déjà la direction ; conscient que ses activités pèsent peu face à La Manufacture de Glaces, Verres à vitres, Cristaux et Gobeleteries, qui rassemble de nombreuses fabriques sous la coupole de la Société Générale de Belgique, Léopold de Dorlodot entreprend de réunir des verreries à vitres et à bouteilles de Charleroi et de Jumet et, sous le patronage de la Banque de Belgique, de fonder la Société de Charleroy pour la Fabrication du Verre et de la Gobeleterie (juillet 1836) ; deux des entreprises de Dorlodot sont concernées. De 1837 à 1845, il est le directeur-gérant de cette association finalement dissoute. Entre-temps, il a réactivé la verrerie de Couillet avec son demi-frère Dominique Jonet (1835) : il y fabrique des glaces coulées puis du verre à vitres. En 1854, il construit à Lodelinsart la verrerie dite Deschassis, considérée comme l’outil le plus moderne de son époque. À partir de 1859, il associera à cette affaire son fils aîné, Léopold, né d’un second mariage. Veuf de Sophie de Dorlodot, Léopold a en effet épousé Ludolphine de Moriamé en 1844 et aura deux fils. Léopold troisième du nom (1831-1900), reprendra l’entreprise familiale, la transformera, mais en 1906, la faillite est prononcée, sonnant le glas des verreries Dorlodot en bord de Sambre.
Au-delà de ses activités d’entrepreneur avisé, Léopold de Dorlodot (second du nom) a pris une part certaine dans la vie de la cité ; en août et septembre 1830, il s’était résolument engagé dans le combat pour la séparation administrative des provinces hollandaises et belges, voire l’indépendance des provinces du sud. Son nom est d’ailleurs proposé par une Commission spéciale instaurée par le nouvel État belge pour recevoir la Croix de Fer ; ses faits d’arme sont décrits comme suit : « Arbora, le 29 août 1830, la cocarde nationale malgré la défense du commandant de la garnison, et plaça le drapeau de l’indépendance à l’une des croisées de sa maison, le 2 septembre ; le 24, il prit le commandement des volontaires du faubourg de Charleroy, réunis par ses soins, et les conduisit aux combats soutenus aux abords du Parc, les 25 et 26 ». « Héros de 1830 », capitaine de la garde civique de Charleroi pendant plusieurs années, collaborateur au journal Le Démocrate, Léopold de Dorlodot affichait nettement des idées libérales et, de 1863 à 1870, il sera le bourgmestre de Lodelinsart.
Sources
Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 162-163
Stéphane PALAUDE, La question du privilège dans les familles verrières du Hainaut. XVIe – XIXe siècles, Regards croisés sur l’histoire des familles verrières
Liste nominative de 1031 citoyens proposés pour la Croix de Fer par la Commission des récompenses honorifiques (p. 1-129) dans Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de Belgique, n°807, 1835, t. XI, p. 26-27 ;
Liste des citoyens qui se sont vus décerner la Croix de Fer, Ibidem, p. 138-139
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. II, p. 35
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. IV, p. 400
Paul Delforge
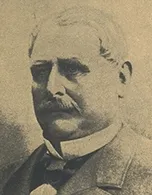
De Dorlodot Eugène
Socio-économique, Entreprise
dit Eugène-François de DORLODOT-HOUYOUX
Charleroi 27/03/1783, Bruxelles 18/04/1869
Descendant de maîtres-verriers implantés à Charleroi depuis le XVIIe siècle, Eugène de Dorlodot est le représentant de la 9e génération de cette importante famille ; fils aîné d’Édouard-Michel de Dorlodot (1734-1816), il est plongé dès son enfance dans le métier du verre puisque son père continue l’exploitation de l’usine du Faubourg de Charleroi, le siège historique des Dorlodot. À son décès, c’est sa mère, Philippine de Beelen Bertholff (1762-1835), qui reprend la direction des affaires, tout en se faisant aider par ses enfants. Mais une autre perspective s’offre à Eugène, lorsqu’il épouse, en 1819, Thérèse Houyoux (1799-1849), la fille du maître de forges Pierre Joseph Houyoux (1776-1832). Ce n’est pas vers la politique, même si, de 1815 à 1818, il est conseiller communal de la ville de Charleroi. En fait, lorsque Léopold (son jeune beau-frère) rejoint son frère Édouard à la tête de la verrerie familiale (1825), Eugène de Dorlodot s’en retire pour se consacrer exclusivement au métier du fer, où les perspectives sont particulièrement enthousiasmantes.
En 1818, son beau-père a fait l’acquisition de la platinerie d’Acoz ; c’est là que, quelques années plus tôt, avait été installé le premier laminoir à l’anglaise, à l’initiative de Georges Gauthier-Puissant. Engagé dans cet autre métier du feu où les progrès techniques sont considérables, Eugène de Dorlodot en fait régulièrement le constat lors de ses séjours en Angleterre où il assouvit sa passion pour les chevaux. Il est fort possible que ce soit dans ces circonstances que s’établit le contact entre Pierre Joseph Houyoux et l’anglais Thomas Bonehill, car c’est ce dernier qui se charge de transformer les forges d’Acoz dès 1825, en installant un laminoir pour étirer les fers en barre, sous l’action de roues hydrauliques.
Bénéficiant des investissements et du savoir-faire de son beau-père et des conseils avisés de spécialistes comme Bonehill, Eugène de Dorlodot va construire progressivement « l’établissement sidérurgique le plus considérable de tous ceux possédés dans l’arrondissement de Charleroi par un particulier », pour reprendre l’expression de Jean-Louis Delaet. En 1840, en effet, sur le site d’Acoz et sur celui de Bouffioulx, de Dorlodot possède notamment deux hauts-fourneaux au coke. Comme les Puissant, les Cartier d’Yves et les Huart-Chapel, de Dorlodot a recours aux techniciens anglais pour moderniser ses outils et introduire les laminoirs à l’anglaise ; comme eux, il peut être considéré comme l’un des initiateurs de la révolution industrielle dans le bassin de Charleroi.
Mais la crise frappe en 1840 et oblige l’entrepreneur à prendre des décisions. Eugène de Dorlodot met en chômage le laminoir d’Acoz et installe près de Maubeuge, de l’autre côté de la frontière, un laminoir permettant de construire des rails et de répondre ainsi à des commandes venant de compagnies ferroviaires françaises. C’est ce laminoir de Bois-le-Tilleul qui fusionne en 1853 avec les Hauts-Fourneaux de Hourpes (Thuin et Leernes) pour former la SA des Forges et Laminoirs de la Sambre. En 1858, cessant ses activités à l’âge de 75 ans, Eugène de Dorlodot cède la direction des usines d’Acoz qui compte alors quatre hauts-fourneaux et deux laminoirs. Il abandonne au même moment le mandat de bourgmestre d’Acoz qu’il exerçait depuis l’indépendance de la Belgique. Il conservera encore jusqu’en 1863, le mandat de sénateur qu’il avait conquis en 1850, en tant que représentant du parti catholique, pour l’arrondissement de Charleroi. Du 6 septembre 1850 au 9 juin 1863, le maître de forges d’Acoz et de Bouffioulx avait siégé au sein de la Commission des Travaux publics.
Lorsqu’il s’éteint, en 1869, son fils Eugène-Charles est à la tête des forges d’Acoz qui atteignent leur apogée, comptant davantage d’ouvriers que Cockerill par exemple, et produisant davantage de tonnes d’acier que les usines liégeoises. Le maître verrier avait parfaitement réussi sa reconversion dans la sidérurgie.
Sources
Revue du Conseil économique wallon, n°40, septembre 1959, p. 68-69
Revue du Conseil économique wallon, n°54-55, janvier-avril 1962, p. 80-81
Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 131
Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 163-164
Histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999
Paul Delforge

De Dorlodot Jean-Baptiste et Édouard-Michel
Socio-économique, Entreprise
DE DORLODOT Jean-Baptiste (VIII)
Charleroi 1723, date et lieu de décès inconnus
DE DORLODOT Édouard-Michel (VIII)
Charleroi 29/11/1739 (ou 1734), Charleroi le 30/10/1816
Représentant de la 8e génération des Dorlodot, Jean-Baptiste est fils de Jean (1697- ?) et petit-fils de François de Dorlodot (1664-1727), ces verriers venus d’Argonne développer leurs activités à Charleroi, dans le comté de Namur. De son mariage avec Marguerite Thomas naîtra un fils prénommé Léopold de Dorlodot (1769-1809), mais c’est surtout son petit-fils, porteur du même prénom (1805-1870), qui contribuera à asseoir la renommée de la famille dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. Fils de Jean et frère d’Édouard-Michel, Jean-Baptiste de Dorlodot donne ainsi naissance à une branche familiale qui restera active dans le secteur du verre.
Son frère, Édouard dit Édouard-Michel, restera lui aussi occupé dans le secteur verrier. À l’entame du XIXe siècle, il tient toujours l’exploitation de verreries dans le Faubourg de Charleroi, sur l’emplacement ou dans le voisinage de la fournaise fondée à la fin du XVIIe siècle par son ancêtre François de Dorlodot. De son mariage en 1781 avec Philippine de Beelen Bertholff (1762-1835) naîtront plusieurs enfants qui aideront leur mère à tenir l’exploitation après la disparition du père, en 1816. Avec son cousin Léopold, Édouard (1784- ?), le plus jeune, poursuivra la tradition familiale dans le secteur du verre, tandis que l’aîné Eugène(-François) deviendra maître de forges et surtout un puissant industriel. Fils de Jean et frère de Jean-Baptiste, Édouard-Michel Dorlodot est à l’origine de la branche familiale qui fera fortune dans l’acier.
Sources
Revue du Conseil économique wallon, n°40, septembre 1959, p. 68-69
La Belgique héraldique, t. IV, p. 13-19
Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 162-163
Paul Delforge

De Dorlodot François
Socio-économique, Entreprise
Vienne-le-Château 10/09/1664, Charleroi 21/04/1727
Dans la famille des gentilshommes de Dorlodot, on porte depuis 6 générations au moins un titre de noblesse que l’on concilie avec des activités dans le secteur du verre. Depuis le début du XVIe siècle au moins, on est maître de verreries de père en fils dans le Barrois et la Champagne. Les de Dorlodot semblent aussi apparentés aux Des Androuins depuis plusieurs décennies, les deux familles partageant des activités verrières identiques à certaines époques. Seigneur de la Tomelle et des Essarts, François de Dorlodot va donner naissance à la branche carolorégienne de la famille en fondant une dynastie verrière le long de la Sambre.
Orphelin très jeune (il perd sa mère en 1665 et son père en 1667), François de Dorlodot pourrait bien avoir accompagné son cousin Gédéon des Androuins dans le comté de Hainaut, au lendemain de la création de la place forte de Charleroi. Maître des lieux, Charles II, roi d’Espagne et des Pays-Bas (1665-1700), développera une politique visant à susciter la création durable d’établissements industriels aux abords de l’ancienne paroisse de Charnoy : celle-ci est située sur la rive gauche de la Sambre, dans le comté de Namur, et fait face à Marcinelle qui dépend, quant à elle, de la principauté de Liège. Mais le 2 juin 1667, durant la courte guerre de Dévolution, Turenne s’empare de Charleroi. Attribuée au royaume de France par le Traité des Pyrénées (1668), la place forte ne revient dans les mains espagnoles qu’en 1678, lors du Traité de Nimègue.
Les diverses sources et travaux s’accordent à affirmer que les « Dorlodot » sont installés à Charleroi depuis 1688, mais la présence de Gédéon Des Androuins est antérieure de quelques années. Seule certitude, le 7 février 1689, François de Dorlodot épouse Anne-Michelle de Condé et s’installe dans le château de son beau-père, le maître verrier Jean de Condé, à Lodelinsart. Quant à son « cousin » Des Androuins, il avait épousé la sœur aînée d’A-M. de Condé quelques années plus tôt… C’est Gédéon des Androuins qui héritera en principal des activités industrielles de son beau-père. Quoi qu’il en soit, dans les faubourgs de Charleroi, les deux « émigrés » font prospérer une production de verre à vitres dont la qualité est reconnue, quoi qu’en disent des concurrents qui voudraient priver « ces étrangers » du droit de le fabriquer.
Deux fils et une fille naîtront du mariage de François de Dorlodot avec Anne-Michelle de Condé : le cadet, Philippe, sera chevau-léger de la garde ordinaire du roi de France, tandis que l’aîné, Jean de Dorlodot de la Tournelle reprendra les activités industrielles paternelles, que son fils Édouard-Michel fera prospérer.
Sources
Revue du Conseil économique wallon, n°40, septembre 1959, p. 68-69
La Belgique héraldique, t. IV, p. 13-19
Paul Delforge
