
Levaux Laurent
Socio-économique, Entreprise
Liège 06/03/1956
Diplômé en Sciences économiques appliquées de l’Université catholique de Louvain (1979), lauréat du Prix du Ministre du Commerce extérieur, cet ingénieur commercial a une série de projets et de contrats en tête, au Pérou et en Afrique du Sud, mais il entame sa carrière en reprenant une PME liégeoise où travaillent une centaine de personnes ; il relève le challenge que lui a proposé le tournaisien Jean Losfeld et, en 1984, il revend la PME, avant de partir aux États-Unis compléter sa formation par un MBA à l’Université de Chicago (1985). À son retour en Europe, Laurent Levaux fonde une entreprise active dans les services à l’industrie, tout en étant associé-gérant pendant quatre ans auprès du bureau bruxellois de consultance Mc Kinsey. Durant ces années, Laurent Levaux conduit plusieurs dossiers de fusion d’entreprises et se forge la réputation d’un solide redresseur d’entreprises en difficultés.
À l’entame de l’hiver 1995-1996, il est d’ailleurs nommé administrateur délégué de l’entreprise CMI, où il défend et applique un « plan de renouveau » à l’horizon 1999, afin d’effacer les charges du passé et de donner des chances de redéploiement à la branche mécanique de Cockerill-Sambre. Disposant de 16 business units actives dans trois secteurs spécialisés différents (biens d’équipement, maintenance et services, fabrications spéciales), Cockerill Mechanical Industries connaît déjà une nouvelle jeunesse lorsqu’Usinor devient l’actionnaire principal de Cockerill-Sambre. Ayant évolué dans le secteur de la maintenance et des services sous la direction générale de Laurent Levaux, CMI devient un véritable spécialiste complet des équipements industriels que le Groupe Usinor s’empresse de revendre, en 2002, à un actionnariat privé indépendant. En 2004, CMI devient Cockerill Maintenance & Ingénierie. Pour Laurent Levaux, c’est le temps du changement.
En janvier 2003, il est nommé par le Conseil d’administration de la SNCB à la tête de sa division spécialisée dans le transport des colis. Le défi est de redresser rapidement ABX, qui emploie des centaines de personnes à travers le monde, et d’en faire une société rentable… à l’image du pari réussi avec CMI. Quittant Liège et le monde de la sidérurgie, Laurent Levaux abandonne la présidence d’Agoria Liège-Luxembourg, organe professionnel des patrons du secteur des fabrications métalliques, poste qu’il occupait depuis 2001 et qui lui avait donné l’occasion d’appeler à un renforcement du leadership des grosses entreprises, ainsi qu’à des mesures attirant les investisseurs et améliorant les relations sociales. A cette époque-là, il était aussi chargé de cours à HEC-ULg, où il a enseigné la stratégie internationale pendant dix années.
Dès 2005, l’action entreprise par le nouvel administrateur délégué d’ABX fait sentir ses effets. En 2006, le fonds britannique i3 se porte acquéreur d’ABX Logistics Worldwide qui sort définitivement de la SNCB au moment où elle réalise des bénéfices, avec la moitié du personnel en moins. Après la revente d’ABX à un groupe danois (été 2008), Laurent Levaux en devient vice-président, avant que « 3i » ne l’invite à reprendre la direction d’Aviapartner, société moribonde, employant 6.000 personnes, active dans le service aux passagers et un peu dans le cargo dans plusieurs aéroports (novembre 2008).
Administrateur indépendant d’EVS (2000), administrateur de la FN Herstal SA (2008) et de Bpost (2012), premier vice-président de l’Union wallonne des Entreprises, Laurent Levaux parvient à redresser la barre de l’opérateur dont il est le président exécutif et le président administrateur délégué. Après la fusion d’Aviapartner avec WFS (2012), il devient vice-président de la nouvelle société. En septembre 2013, Laurent Levaux est nommé au Conseil d’administration de Belgacom.
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (Trends-LeVif)
Entreprendre, novembre 2007, n°11, p. 24-26
Paul Delforge

Lambotte Thiéry
Socio-économique, Entreprise
Wavre ( ?), Namur circa 1657-1659
En pays wallon, depuis plusieurs générations, l’industrie du verre se concentre principalement dans le Hainaut. Au XVe siècle, des familles d’origine italienne font évoluer les techniques, de même que des Lorrains. Le plus souvent, une fournaise est implantée en un endroit et des verriers ambulants obtiennent le droit de fabrication. Le comté de Namur paraît quelque peu à l’écart d’une activité qui s’implante aussi en principauté de Liège et dans la partie romane du Brabant, et est principalement contrôlée par la famille des Colnet. Dans la première moitié du XVIIe siècle, Thiéry Lambotte va tenter d’introduire durablement la fabrication du verre dans le Namurois et, si son entreprise n’est pas couronnée du succès qu’il espérait, il reste l’un des premiers verriers, sur le continent européen, à avoir recours à la houille à la place du charbon de bois (1643).
Originaire de Wavre où son père faisait commerce du verre, Thiéry (ou Thiry) Lambotte vient s’installer dans le Namurois à l’entame du XVIIe siècle. En fait, son père Jean avait dû essuyer les plaintes des marchands de verre de Namur se plaignant qu’un « étranger » puisse fournir les vitres du collège des Jésuites de la cité mosane. Ne parvenant pas à trouver place lui-même au sein du métier des merciers de Namur, Jean fait admettre son fils, Thiéry (1619), qui, très vite, est inscrit dans la bourgeoisie de Namur (1622). Marchand de verre à vitres et miroirs, il s’approvisionne auprès de verriers Lorrains établis à Baisy-Thy. Jusque dans les années 1630, ses affaires sont prospères, mais il cherche à se démarquer en se présentant comme « peintre sur verre ».
Par ailleurs, le contexte est troublé par les guerres à répétition dans l’espace wallon ; le climat d’insécurité a fait fuir les verriers étrangers, le verre se raréfie et, par conséquent, le verre de Hollande tend à envahir le marché des Pays-Bas, en même temps que le prix du verre est en forte hausse au milieu des années 1620. En 1625, Lambotte plaide si bien sa cause qu’il obtient aisément l’autorisation d’établir à Namur « une fabrique pour faire du verre propre à faire verrières ». Ayant obtenu les privilèges nécessaires pour construire ses propres fours, il reste pourtant tributaire des ouvriers lorrains pour assurer sa production. Le sol namurois paraissant présenter des qualités particulières pour la verrerie, Lambotte doit découvrir les secrets des maîtres verriers lorrains, s’il veut fabriquer lui-même un verre de qualité.
Longtemps, on a cru que Thiéry Lambotte avait été le premier fabricant de verre dans le Namurois. En fait, il a surtout été un entrepreneur et un homme d’affaires décidé à créer une nouvelle industrie, en s’entourant de gens compétents et en incitant des partenaires à investir leurs capitaux. Vers 1626-1627, sa fournaise voit le jour à Namur. Une autre apparaît à Rivière en 1630, quand un nouvel investisseur, Juste Damant, entre en scène. La fournaise est transférée à La Foliette, en 1636. Tributaire des Lorrains, ainsi que de l’augmentation du prix du bois, Lambotte tente de faire venir des ouvriers anglais pour « cuire à la houille » et se démarquer des cuissons sur bois traditionnelles.
Malgré ses nombreuses tentatives, Lambotte ne parviendra jamais à ses fins, d’autant que la guerre entre l’Espagne et la France sème le désordre dans la vallée de la Sambre. Profitant de leurs secrets, les Lorrains (en fait, quatre familles : les Thietry, Tisaque, Bisval et surtout Hennezel) viendront s’installer dans le Namurois ; en 1651, Josué de Hennezel s’associera même avec Lambotte, avant de devenir son concurrent en installant une fournaise au quartier de la Neuville (1653). Lambotte, quant à lui, cherchera à installer un four à verre dans le Hainaut voisin (1654).
S’il n’est ni l’inventeur d’une nouvelle technique, ni un entrepreneur récompensé de ses efforts, Thiéry Lambotte a réussi à introduire durablement la fabrication du verre dans le Namurois et est l’un des premiers (avec des Normands et les Liégeois Bonhomme et Libon), sur le continent européen, à avoir recours à la houille à la place du charbon de bois (1643) ; le procédé avait été utilisé en Angleterre vers 1616-1619. L’un des fils Lambotte ou peut-être un petit-fils établira plus tard une verrerie à la façon de Venise dans la région de Madrid.
Sources
Édouard GARNIER, Histoire de la verrerie et de l’émaillerie, Tours, 1886, p. 162-163, 165, 311
Dictionnaire biographique namurois, sous la direction de Fr. JACQUET-LADRIER, Numéro spécial de la revue Le Guetteur wallon, n°3-4, Namur, 1999, p. 152
Revue du Conseil économique wallon, n° 47, novembre 1960, p. 64-66
Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938, p. 22
Raymond CHAMBON, Les Verreries forestières du Pays de Chimay du XIIe au XVIIIe siècle d’après les documents d’archives, dans Publications de la Société d’histoire régionale de Rance 1959-1960, Chimay, 1960, t. IV, p. 111-180
Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955, p. 104-105
Paul Delforge
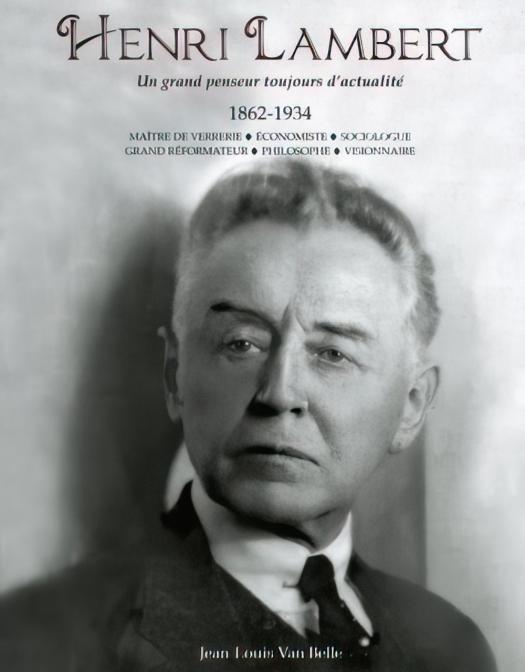
Lambert Henri dit CASIMIR-LAMBERT
Socio-économique, Entreprise
Dampremy 14/11/1862, Paris 12/10/1934
Depuis le XVIIe siècle, moment de leur installation dans le pays de Charleroi, les Lambert participent à l’exploitation des houillères et, à partir du XIXe siècle, Casimir-Lambert (1797-1864) se lance dans la verrerie suite à son mariage avec la fille du maître verrier Desguin. Les verreries de Lodelinsart construites par le grand-père sont développées par Casimir Lambert (1827-1896), ingénieur sorti de l’École des mines de Mons, industriel et député libéral de Charleroi entre 1874 et 1890. Dans la tradition familiale, Henri Casimir-Lambert conservera cette activité industrielle en lui donnant une prospérité toute nouvelle, mais en menant des activités remarquées dans un tout autre domaine : en effet, sorti de l’Université de Liège avec un diplôme d’ingénieur civil en 1886, Henri Lambert est profondément marqué par les émeutes qui frappent alors le bassin industriel wallon. De ces événements dramatiques naîtra une forte réflexion, synthétisée, en 1920, dans un ouvrage intitulé Nouveau Contrat social. Au-delà du socio-économique, ce patron wallon d’entreprise atypique défendra aussi des positions pacifistes déterminées.
Au décès de Casimir Lambert, en 1896, la question de la succession génère des différends tels que Henri Lambert préfère quitter les Verreries de l’Ancre (devenue SA des Verreries de l’Ancre réunies) pour construire sa propre usine de production de verres à vitres, toujours à Lodelinsart. Lors de ses débuts dans l’entreprise paternelle, il avait commencé à introduire plusieurs innovations. Ses contacts avec Eugène Baudoux l’y aidèrent. Une fois à son compte, la société en commandite Henri Lambert et Cie dispose du plus grand four d’Europe ce qui lui vaut, de la population, le surnom de Verrerie Barnum. Plusieurs centaines d’ouvriers assurent sa prospérité jusqu’au milieu des années 1920. Entre-temps, Henri Lambert a apporté son soutien à Émile Fourcault lorsque ce dernier met au point son brevet révolutionnaire avec Émile Gobbe, et il apporte aussi des capitaux dans la SA des Verreries de Dampremy. Quand, à son tour, Henri Casimir Lambert introduit la mécanisation dans son entreprise, il sonne le glas des souffleurs de verre carolorégiens. Transformée en Société anonyme des Verreries mécaniques de Lodelinsart sous la contrainte des banques, l’entreprise de Henri Lambert se dissout au sein de l’Union des Verreries mécaniques belges-Univerbel (octobre 1930).
Toutes les transformations statutaires que connaissent les entreprises de Henri Casimir-Lambert ne correspondent guère à l’idéal que s’est forgé le personnage tout au long de ces années. Ayant hérité de son père la conviction du libre-échange économique, l’entrepreneur se fait philosophe et va tenter de concilier d’autres valeurs politiques : le principe du suffrage universel dont il est partisan et le caractère excessif du simple système majoritaire, d’une part, le principe de la liberté d’association et le pouvoir engendré par les formes capitalistiques des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, d’autre part. Dans son Nouveau Contrat social, sa réponse aux tensions ainsi identifiées, il plaide en faveur d’une organisation de la « démocratie individualiste », régime dans lequel triompheraient la liberté, une solidarité volontaire et une responsabilité solidaire. À cette doctrine originale de la société, il ajoute un engagement résolu en faveur du pacifisme. En 1913, il explique sa pensée dans Pax Œconomica, qui n’est alors qu’un essai, avant de multiplier des lettres ouvertes à Sir Edward Grey et au président Woodrow Wilson. Ayant quitté Charleroi en septembre 1914 pour la Hollande, puis l’Angleterre, il débarque aux États-Unis en septembre 1916 pour faire pression avec les milieux pacifistes et libre-échangistes américains sur le président Wilson. Selon J-L. Van Belle, l’industriel et pacifiste wallon parvient à s’immiscer dans l’entourage des décideurs de la Maison Blanche et à influencer le fameux programme en « Quatorze points » du 8 janvier 1918). Lors de son séjour en Amérique, il met encore la dernière main à son Pax Economica définitif.
Opposant farouche aux dispositions de Versailles, sceptique quant à l’utilité de la Société des Nations, Henri Lambert ne semble pas avoir bénéficié d’une grande écoute de son vivant, ni d’ailleurs post mortem. Une dernière synthèse, métaphysique, intitulée Hypothèse sur l’évolution physique et métaphysique de l’énergie (1935) ne rencontre guère de succès : il y émet l’hypothèse d’un ordre naturel du monde et affirme l’existence d’un dieu, « énergie attractive immatérielle », qui opère depuis le noyau de tous les atomes.
Sources
Jean-Louis VAN BELLE, Henri Lambert. Un grand penseur toujours d’actualité (1862-1934), Braine-le-Château, 2010
Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 407
Jean-Louis VAN BELLE, dans Nouvelle Biographie nationale, t. 11, p. 46-48

Laloux René
Socio-économique, Entreprise
Liège 19/01/1895, Liège 22/11/1981
Dans le secteur de l’armurerie liégeoise, le nom de famille Laloux évoque directement une longue tradition dans la fabrication d’armes et surtout la création de la Fabrique nationale d’Armes de guerre, la FN. Petit-fils de l’un des fondateurs (Adolphe), fils de celui qui sera administrateur pendant plus de 50 ans et président du Conseil d'administration de la société (Georges), René Laloux hérite, avec son frère André, des multiples participations de leur paternel non seulement à la FN, mais aussi dans plusieurs autres sociétés liégeoises.
Ayant suivi une formation d’ingénieur, René Laloux est nommé sous-directeur en 1932 et associé au patron Gustave Joassart à partir de 1948 ; il prendra la direction générale de la FN en 1950, succédant à Gustave Joassart. Après avoir favorisé la créativité de Dieudonné Saive en le laissant notamment réaliser les fusils automatiques, René Laloux est aussi le responsable de la réussite de la diversification de la FN quand l’entreprise liégeoise se met à construire des moteurs Rolls-Royce dès la fin des années 1940, suite aux excellents contacts noués par Joassart en Angleterre. Ensuite, la FN se lancera dans le nucléaire (Métallurgie et Mécanique Nucléaire, 1958), ainsi que dans le spatial (programme Eldo, 1963).
À la tête de 13 à 14.000 hommes, le patron dirige avec le paternalisme du siècle précédent ; chacun s’accorde à reconnaître chez lui une préoccupation sociale et un souci constant de qualité : ses compétences techniques ne sont jamais prises en défaut, il est capable d’intervenir sur n’importe quel poste dans l’entreprise ; du cadre à l’ouvrier, il est craint et respecté. Sur le plan commercial, cependant, il est davantage préoccupé par la qualité des produits qu’il fournit que par la rapidité du paiement de ses livraisons : René Laloux devient progressivement un obstacle pour les actionnaires majoritaires au sein du Conseil d'administration. En octobre 1963, il abandonne sa fonction de directeur général.
Face aux nouveaux défis industriels, les Laloux ne disposent plus du capital suffisant pour réaliser les investissements nécessaires. Très vite, la Société Générale prend l’ascendant, écartant les Laloux et confiant les rênes de la société à ses propres cadres. L’orientation de l’entreprise, son reformatage et les méthodes de management décident René Laloux à passer la main. Président et administrateur délégué de la FN de 1963 à 1971, il est le dernier représentant de la famille dans le Conseil d’administration de l’entreprise.
Sources
Pascal DELOGE, Une histoire de la Fabrique nationale de Herstal, Liège, Cefal, 2012, p. 26, 39Auguste FRANCOTTE, René LALOUX (préface), Fabrique nationale d'armes de guerre. 1889-1964, Liège, Desoer, 1965
Paul Delforge

Laloux André
Socio-économique, Entreprise
Liège 13/07/1897, Liège 28/01/1985
Dans le secteur de l’armurerie liégeoise, le nom de famille Laloux évoque directement une longue tradition dans la fabrication d’armes et surtout la création de la Fabrique nationale d’Armes de guerre, la FN. Petit-fils de l’un des fondateurs (Adolphe), fils de celui qui sera administrateur pendant plus de 50 ans et président du Conseil d'administration de la société (Georges), André Laloux hérite, avec son frère René, des multiples participations de leur paternel non seulement à la FN, mais aussi dans plusieurs autres sociétés liégeoises.
Administrateur de plusieurs entreprises au Congo, des Pieux Franki, de Cuivre et Zinc, de La Gazette de Liège, André Laloux reste pendant plusieurs années le délégué de la Société Générale auprès de la FN. Depuis ses bureaux, il gère également une « île de paix » en Inde. Face aux nouveaux défis industriels qui se profilent à l’horizon des années 1950, les Laloux ne disposent plus du capital suffisant pour réaliser les investissements nécessaires.
Très vite, la Société Générale prend l’ascendant, écartant les Laloux et confiant les rênes de la société à ses propres cadres. En 1964, André Laloux est remplacé par Othon Drechsel (le frère de Max Drechsel) comme directeur général. Juriste de formation, André Laloux avait épousé Claire Regout. Leur fils, André (1924-), sera le dernier représentant de la famille Laloux à travailler au sein de la FN. Ingénieur entré à la FN après la Seconde Guerre mondiale, il s’opposera à la stratégie de diversification de la Société Générale et quittera l’entreprise en 1978.
Sources
Pascal DELOGE, Une histoire de la Fabrique nationale de Herstal, Liège, Cefal, 2012, p. 26, 39, 69
Auguste FRANCOTTE, René LALOUX (préface), Fabrique nationale d'armes de guerre. 1889-1964, Liège, Desoer, 1965
Paul Delforge

Laloux Georges
Socio-économique, Entreprise
Liège 23/02/1866, Liège 30/01/1955
Pendant plusieurs siècles, les armuriers ont fait la prospérité de Liège et sa renommée. Le nom de famille Laloux est étroitement associé à ce secteur : au XIXe siècle, les Laloux sont armuriers, entrepreneurs, patrons de sociétés toutes vouées à la fabrication d’armes. À la fin du XIXe siècle, avec d’autres armuriers liégeois, Adolphe Laloux va donner naissance à la Fabrique nationale d’Armes de Guerre et son fils, Georges, va lui succéder. Docteur en Droit comme son père, Georges Laloux sera administrateur de la Fabrique nationale d’Armes de guerre pendant plus d’un demi-siècle.
Entré dans la société en 1896 et au Conseil d’administration en 1899, Georges Laloux prend une part active dans le déploiement de la société alors aux mains de la société allemande Ludwig Loewe & Cie, actionnaire majoritaire. En 1904, il repère un jeune ingénieur civil promis à un bel avenir d’après ses résultats universitaires et Laloux engage Alexandre Galopin pour diriger un laboratoire d’essai des métaux et de réception des matières premières. Décidé en 1904, ce « centre de recherche scientifique » au sein d’une entreprise était une première. Moins de dix ans plus tard, Galopin deviendra le directeur de la FN (1913).
En plus des armes de guerre, des fusils de chasse et d’un contrat avec l’Américain John Moses Browning qui trouvera dans l’usine wallonne son principal fabriquant en Europe, la FN va se lancer dans la production des bicyclettes et des automobiles avant la Grande Guerre. Attentif au potentiel de développement du bassin industriel liégeois, Georges Laloux appose sa signature au bas d’une brochure qui, en 1907, réclame le passage et l’arrêt à Liège des grandes lignes ferroviaires internationales. Durant la Grande Guerre, les administrateurs décident de la fermeture de l’usine. Bien que minoritaire, G. Laloux tente de faire obstacle aux intentions allemandes ; il est arrêté après avoir été surpris à passer clandestinement du courrier du côté de Maastricht : condamné, il passe l’hiver 1915-1916 dans une prison allemande. Finalement, l’usine est placée sous séquestre à partir de 1917.
Après l’Armistice, la FN cherche des débouchés dans le domaine civil, mais en raison de la crise de 1929, en revient à ses fondamentaux. En mai 1940, Georges Laloux comme tous les dirigeants et ouvriers de la Fabrique d’Armes de guerre refuse de se mettre au service des Allemands.
En février 1944, suite à l’assassinat d’Alexandre Galopin, il accepte, pour préserver autant que possible les intérêts de l’entreprise, la présidence du Conseil d’administration de la FN qu’il exerce jusqu’en 1951, année où il est remplacé par Paul Gillet. À 83 ans, le « patriarche » a été « invité » par la Société générale à quitter sa fonction : pourtant, au lendemain de la Première Guerre mondiale, Georges Laloux était parmi ceux qui avaient convaincu la Société générale d’entrer dans le capital de la FN afin d’y remplacer l’Allemand Ludwig Loewe… À l’époque, avait été créée la SA Union Financière et industrielle de Liège, pour permettre à la Société générale d’être l’actionnaire majoritaire de la FN.
Fondateur de la Société G. Laloux et de plusieurs entreprises au Congo, Georges Laloux a aussi été régent de la Banque nationale pendant 45 ans, membre délégué de la Société Générale au siège de Liège et administrateur de nombreuses sociétés, comme les Pieux Franki, Cuivre et Zinc, voire La Gazette de Liège. Marié à Juliette Vanderheyden a Hauzeur, Georges Laloux aura neuf enfants, dont André et René qui seront impliqués dans la marche de la FN.
Sources
Pascal DELOGE, Une histoire de la Fabrique nationale de Herstal, Liège, Céfal, 2012, p. 37-38, 60, 62
Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 524
Marie-Thérèse BITSCH, La Belgique entre la France et l’Allemagne 1905-1914, Paris, 1994, p. 349
Auguste FRANCOTTE, René LALOUX (préface), Fabrique nationale d'armes de guerre. 1889-1964, Liège, Desoer, 1965, dont p. 106

Laloux Adolphe
Socio-économique, Entreprise
Liège 1834, Liège 1919
Pendant plusieurs siècles, les armuriers ont fait la prospérité de Liège et sa renommée. Le nom de famille Laloux est étroitement associé à ce secteur : au XIXe siècle, les Laloux sont armuriers, entrepreneurs, patrons de sociétés toutes vouées à la fabrication d’armes. À la fin du XIXe siècle, Adolphe Laloux va donner naissance à la Fabrique nationale d’Armes de Guerre.
Fils de Henri-Joseph Laloux, Adolphe Laloux fait des études à l’Université de Liège et obtient un diplôme de docteur en Droit. C’est lui qui hérite de l’entreprise familiale, la société en commandite par actions Dresse-Laloux-Ancion, spécialisée dans la fabrication des armes à feu. Cela n’empêche pas Adolphe Laloux de se marier, en 1881, avec Louisa Lelièvre, et d’entrer ainsi dans la famille de l’un des deux principaux fondateurs des verreries et cristalleries du Val Saint Lambert.
Face à la concurrence étrangère, Adolphe Laloux tente de former, vers 1870, avec d’autres armuriers liégeois (Auguste Francotte, Pirlot-Frésart), une association destinée à attirer vers eux de nombreuses commandes des quatre coins du monde (atelier dit du Petit-Syndicat) : ensemble, ils fabriquent les fusils modèle Comblain que le gouvernement destine aux gardes civiques. La guerre franco-prussienne est aussi profitable.
Après avoir traversé une période difficile due à la crise des années 1873-1880, une association plus solide se forme vers 1886, sous le nom de « Fabricants d’Armes Réunis ». À côté d’Adolphe Laloux qui est l’un des gérants de la Société Dresse, Laloux et Cie, on retrouve les armuriers liégeois Ancion, Dumoulin, Dresse, Jansen, Nagant, Pirlot, Frésart, Simonis et Pieper. Cette volonté de s’associer pour mieux résister à la concurrence va finalement se concrétiser en décembre 1888. Pour répondre à une importante commande du gouvernement belge (150.000 fusils à répétition système Mauser, type 1889, de la société allemande Ludwig Loewe & Cie), ces armuriers liégeois forment une nouvelle société, la Fabrique nationale d’Armes de Guerre, projet auquel s’associe Auguste Francotte.
De temporaire, l’entreprise va s’installer dans la durée quand, en 1896, Ludwig Loewe & Cie devient actionnaire majoritaire et donne naissance à l’une des plus importantes sociétés de Wallonie. Parmi les premiers actionnaires, on retrouve bien sûr Adolphe Laloux qui détient 10% de la FN via sa société et il apparaît ainsi comme l’un des 12 co-fondateurs. À partir de 1899, c’est son deuxième fils, Georges, qui va siéger, à titre individuel cette fois, au sein du Conseil d'administration de la FN.
Administrateur de sociétés, Ad. Laloux détient encore un quart du capital de l’Armurerie et clouterie mécanique liégeoise ; il est aussi intéressé au développement de la Banque liégeoise et Caisse d’épargne dont il devient le président, et il est aussi administrateur du Val Saint-Lambert et de la société de gestion de la ligne de chemin de fer Liège-Maastricht et des Tramways à vapeur piémontais. Dans le même esprit social que les fondateurs du Val Saint-Lambert, il administre la Société liégeoise pour la construction et l’achat de maisons d’ouvriers.
Sources
Pascal DELOGE, Une histoire de la Fabrique nationale de Herstal, Liège, Céfal, 2012, p. 37
Auguste FRANCOTTE, René LALOUX (préface), Fabrique nationale d'armes de guerre. 1889-1964, Liège, Desoer, 1965
Paul Delforge

Laloux Henri-Joseph
Socio-économique, Entreprise
Liège 1800, Liège 1866
Fils de Jean-Henri (1750-1831), Henri-Joseph Laloux hérite en 1828 de sa fonction d’éprouveur des armes à feu. L’armurier liégeois conserve la direction du banc d’épreuve jusqu’en 1846. À ce moment, il retrouve le métier de ses ancêtres, la fabrication d’armes, aidé dans sa tâche par son mariage avec la fille d’une famille de maîtres de forges, par ailleurs aussi fabricants d’armes. Avec ses beaux-frères Dieudonné Ancion et Olivier Dresse, Henri-Joseph Laloux constitue d’ailleurs la société en commandite par actions Dresse-Laloux-Ancion, spécialisée dans la fabrication des armes à feu (1862). C’est son fils unique, Adolphe, qui sera à l’origine de la Fabrique nationale d’Armes de Guerre.
Sources
Pascal DELOGE, Une histoire de la Fabrique nationale de Herstal, Liège, Cefal, 2012, p. 37
Auguste FRANCOTTE, René LALOUX (préface), Fabrique nationale d'armes de guerre. 1889-1964, Liège, Desoer, 1965
Paul Delforge

Kock Marcus Danielson
Socio-économique, Entreprise
(né Remacle KOCK)
Liège (Chênée) 14/02/1585, Avesta (Suède) 20/11/1657
Petit-fils de Remacle Kock dit le Serwyr, Remacle dit Marc Kock est l’un des neuf enfants de Daniel Kock, illustre représentant d’une famille spécialisée dans la fabrication d’instruments de pesage, mais surtout considéré comme l’inventeur de la fenderie. Tandis que ses frères perpétuent les activités familiales en bord de Meuse, Remacle entreprend un « voyage » qui l’amène en France, en « Autriche », en Hongrie, puis dans l’Empire romain de la Nation germanique, vraisemblablement dans les toutes premières années du XVIIe siècle. Autodidacte, il se forme à de nombreuses techniques au cours de son périple, qu’il s’agisse de l’exploitation minière ou la frappe des monnaies.
En Prusse orientale, il retrouve son oncle, Abel Kock, qui est maître des monnaies de la ville de Dantzig. Durant son séjour dans cette ville, il fait la rencontre de la fille d’un marchand brabançon spécialisé lui aussi dans la frappe de monnaie, qui avait fait souche en terres prussiennes. Ensuite, le couple Kock-van Eyck (marié en 1614) s’installe à Bromberg (Pologne), où il est nommé maître des ateliers monétaires (1613-1622), avant d’exercer la même fonction à Königsberg, près de l’électeur de Brandebourg, pendant quelques mois (1622-1624).
Vers 1624, Remacle Kock est à Berlin, où il devient aussi directeur des monnaies. C’est là qu’il rencontre vraisemblablement le roi Gustave-Adolphe de Suède qui, à la tête de son armée, va mener une première guerre en Pologne (1626), avant de s’engager dans la Guerre de Trente Ans (1630), et d’affronter la Ligue catholique conduite par un général wallon, le comte de Tilly. Mais ces événements ne concernent pas directement Kock : confronté à de sérieux problèmes avec un propriétaire polonais, il choisit de partir pour Stockholm en 1626, devient « maître des monnaies du royaume de Suède » et, à ce titre, réorganise profondément l’établissement suédois de Nyköping en y apportant des innovations « familiales ». Dès 1627, sur les pièces à l’effigie de Gustave-Adolphe, on retrouve les initiales « M.K. » de celui que l’on appelle désormais Marcus Kock. Maître des monnaies, Kock le sera à Nyköping de 1627 à 1629, à Sater de 1632 à 1636, à Arboga en 1628, à Stockholm de 1633 à 1639, à Sala de 1639 à 1641 et enfin à Avesta.
À l’instar des De Bèche et de Louis de Geer, l’entrepreneur wallon – dont le père est considéré comme l’inventeur de la fenderie – obtient du roi scandinave le droit exclusif d’établir, pour une durée de douze ans, le long des cours d’eau suédois, des fenderies exemptes de tout impôt. Les fenderies selon les méthodes wallonnes devaient rapidement prospérer, attirant des investisseurs locaux ou « étrangers », comme le wallon Louis de Geer. Tout en important en Suède le savoir-faire wallon, Marcus Kock paraît avoir inventé sur place « la technique du revêtement des cylindres en acier doux, à l’aide d’acier trempé d’une très grande dureté ». Cette innovation est appliquée à partir de 1644 à Avesta, où est transféré le siège de la frappe des monnaies de cuivre, dont chacun s’accorde à reconnaître qu’elles sont parmi les belles d’Europe.
À Avesta voit le jour un complexe industriel quasiment indépendant, hormis pour ses besoins en minerai et charbon de bois. Au total, ce sont plusieurs usines et machines que Kock installe en Suède et qui resteront actives pendant près d’un siècle : four d’affinage, martinet à cuivre et son four, atelier de vérification des pièces de monnaie, martinet pour le poinçonnage, four de fenderie, atelier de cisaillement des flans, atelier de frappe, atelier de bocardage, etc. La qualité de frappe des monnaies suédoises fut telle que plusieurs pays européens y firent battre leurs propres pièces.
Les quatre fils et la fille du couple Marcus Kock/Elisabeth van Eyck grandiront en Suède et eux comme leur descendance y jouiront d’une large reconnaissance : à partir de 1666, ils seront anoblis et le titre de baron sera accordé à ceux qui porteront désormais le nom de Cronström, à consonance davantage suédoise.
Sources
Jean YERNAUX et M. MATHY, Une famille de pionniers industriels wallons au XVIIe siècle : les Kock, de Limbourg, dans Bulletin de l’Académie royale de Belgique, classe des Lettres, 5e série, t. 46, p. 66-124
Jean YERNAUX, dans Biographie nationale, t. XXXI, col. 515-528
Georges HANSOTTE, La métallurgie wallonne au XVIe et dans la première moitié du XVIIe siècle, Essai de synthèse, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, Liège, 1972, t. LXXXIV, p. 37
Jean YERNAUX, dans Biographie nationale, t. 31, 3e supplément, col. 515-517
Revue du Conseil économique wallon, n° 64, septembre 1963, p. 69
Paul Delforge

Kock David
Socio-économique, Entreprise
Limbourg fin du XVIe siècle, Liège ( ?) circa 1613-1614
Frère de Daniel et fils de Remacle Kock dit le Serwyr, David Kock est originaire du duché de Limbourg où sa famille s’est spécialisée dans la fabrication d’instruments de pesage. On le sait associé à son frère dans l’exploitation des mines de la Blanche Plombière à Prayon. En 1601, avec son frère Daniel, il obtient du prince-évêque (Ernest de Bavière) un brevet lui reconnaissant la paternité d’une machine destinée à puiser l’eau des galeries et puits de mines. Vraisemblablement mise au point lors de l’exploitation du site de Prayon-Trooz, cette machine comprenait des séries de pompes étagées, mues par les eaux de la Vesdre. Il s’agit là de la préfiguration de ce qui sera utilisé par Renkin Sualem à Marly, pour amener l’eau de la Seine dans les jardins du château de Versailles.
En effet, Renkin Sualem était le fils de Renkin et de Catherine Kock, fille de David Kock..., en d’autres termes le gendre de ce dernier. Au début du XVIIe siècle, un certain Renard dit Renkin Sualem, venant de Campine, s’était fixé à Forêt et il apparaît comme directeur à la Blanche Plombière en 1633, chargé de l’entretien des machines d’exhaure. Parti en 1642 s’installer à Jemeppe-sur-Meuse, ledit Renard y applique son savoir-faire dans les charbonnages du bassin de Liège. C’est là que naquit, Renkin Sualem junior, le célèbre inventeur de la machine de Marly. Dans une certaine mesure, la machine de Marly doit beaucoup à David Kock.
Sources
Jean YERNAUX, dans Biographie nationale, t. XXXI, col. 515-528
Georges HANSOTTE, La métallurgie wallonne au XVIe et dans la première moitié du XVIIe siècle, Essai de synthèse, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, Liège, 1972, t. LXXXIV, p. 37
Jean YERNAUX et M. MATHY, Une famille de pionniers industriels wallons au XVIIe siècle : les Kock, de Limbourg, dans Bulletin de l’Académie Royale de Belgique, classe des Lettres, 5e série, t. 46, p. 66-124, dont les pages 74-79
Revue du Conseil économique wallon, n° 64, septembre 1963, p. 69
Paul Delforge
