
Cremer Jean-Marie
Socio-économique, Entreprise
Cherain 25/08/1945
S’appuyant sur une forte expertise en Recherches et Développement développée par l’ingénieur-architecte René Greisch, Jean-Marie Cremer contribue, en 1984, à la transformation de son bureau en société anonyme. À partir des années 1990, Jean-Marie Cremer – par ailleurs professeur à l’Université de Liège – en devient l’administrateur-délégué et contribue au développement et à la diversification de ses activités, dont la contribution à l’installation du Pont de Millau, en France, ne constitue qu’une des facettes internationalement reconnues.
En 2005, en se voyant attribuer à Lisbonne le « Prix international du mérite dans la construction civile », J-M. Cremer reçoit surtout le témoignage de la reconnaissance de son expertise par ses pairs au niveau international. Il précise lui-même que son métier, c’est lancer des ponts.
Ardennais ayant quitté Cherain pour mener à Liège ses humanités « latin-math » au Collège Saint-Servais, puis des études d’ingénieur à l’Université, Jean-Marie Cremer est un ingénieur civil en construction (1968) qui va mener de concert une carrière de chef d’entreprise et de formateur. Ingénieur chez Galère (1968-1973), il devient l’un des collaborateurs de René Greisch et se voit confier l’animation d’une équipe spécialisée dans la conception et l’étude des ouvrages d’art (1973-1984).
Co-fondateur du Beg SA (Bureau d’études Greisch) en 1984, il devient l’administrateur délégué de la « Société Greisch coordination et études » en 1990, puis de « Greisch Ingénierie sa » en 1991, avant de succéder à René Greisch. Administrateur délégué du « Beg » (2003-2009), co-fondateur et président du Conseil d’administration de « Canevas » (2004) spécialement dédiée à l’architecture, il se retrouve à la tête de plus de 100 personnes qui travaillent à différents volets de la construction – à la fois des activités d’ingénierie (constructions de ponts, etc.) et d’architecture et de génie civil –, avec comme objectif d’allier technique et esthétique. Après avoir assuré des heures de formation à l’Institut Gramme (-1995), Jean-Marie Crémer est associé aux travaux de l’Université de Liège, désigné comme chargé de cours à temps partiel (1998) et nommé professeur en masters (2007-2010).
Le pont de Ben-Ahin (1987), avec ses 16.000 tonnes de poussée, était une performance mondiale du fait de sa construction par rotation. Le pont de Wandre (1989), quant à lui, est d’emblée considéré comme l’un des plus beaux d’Europe. La construction du pont-canal de Houdeng par poussage d’une structure de 65.000 tonnes est une autre performance mondiale, comme la construction par lançage du pont de Millau.
Il est d’autres réalisations qui sont aussi remarquées et distinguées par plusieurs prix (prix de la Convention européenne pour la construction métallique 1987, médaille d’Or Gustave Magnel 1989, Prix de l’Urbanisme de Liège 1993, prix « Limburg 94 », etc.). D’autres récompenses sont attribuées à Jean-Marie Crémer comme le prix 1995 de l’Association française des Ponts et Charpentes, le prix IABSE 2005, le prix Albert Caquot 2009 de l’AFGC, la Médaille d’Or AILg 2011 du mérite industriel Alexandre Galopin, la fib Medal of Merit 2012, voire son admission comme membre de l’Académie royale de Belgique.
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
Principales réalisation
1985-1987 : pont de Ben-Ahin
1984-1989 : pont de Wandre
1990 : pont de Milsaucy
1990-1994 : viaduc de l’Eau-Rouge
1991-1995 : aménagement intérieur du Parlement wallon (ancien hospice Saint-Gilles)
1995 : bâtiment tri-facultaire de l’Université de Liège (Sart-Tilman)
1995-1998 : Moulins de Beez
1998 : aéroport/aérogare de Liège-Bierset
1998-1999 : agrandissement du stade du Standard de Liège
1997-2000 : pont du Pays de Liège, dit du Val Benoît et divers travaux sur la liaison E40-E25
1998-2000 : stabilisation du Pass, site du Crachet
1998-2000 : Institut de Mécanique et de Génie-Civil de l’Université de Liège (Sart-Tilman)
1998-2001 : Pont-Canal du Sart, à Houdeng
2003 : passerelle Céramique à Maastricht.
2003-2005 : viaduc TGV sur la Moselle (1510 mètres, le plus long de la ligne Est)
2007-2014 : nouvel hôpital de Charleroi
2009 : rénovation de huit ponts métalliques aux Pays-Bas
2010-2015 : écluse de Lanaye

Crahay Vincent
Socio-économique, Entreprise
Liège 08/01/1961
Depuis les années 1930, le puissant groupe Nestlé détenait une entreprise de fabrication de céréales pour enfants à Hamoir. Modifiant sa politique globale (en l’occurrence décentralisant sa production vers le Portugal et l’Espagne), Nestlé était décidé en 2005 à fermer définitivement son site de production en Wallonie et à licencier 140 travailleurs. Le désastre social se profilait à l’horizon quand Vincent Crahay propose de racheter l’entreprise en management buy out. Fin 2005, un plan social est âprement négocié, des prépensions sont accordées, une cellule de réinsertion (New Job) est mise en place par Nestlé avec l’aide des syndicats et de la Région wallonne, tandis qu’un gros quart du personnel se mobilise autour de celui qui avait été nommé directeur général du site Nestlé en février 2002 pour développer une nouvelle activité.
Ingénieur agro-alimentaire de formation, V. Crahay avait d’abord travaillé comme assistant au département « fermentation » aux Facultés agronomiques de Gembloux, avant d’être engagé comme ingénieur de production par « Chaudfontaine Monopole » (1983-1986). Recruté par la famille Marziale, il renforce les effectifs du glacier Mio à Chênée : directeur de la production, directeur de la qualité R&D, puis directeur de l’usine. Déjà à ce moment, il a pu mesurer les difficultés d’une entreprise familiale performante pour rester indépendante par rapport aux grands groupes multinationaux. Néanmoins, quand Nestlé l’invite à prendre la direction du site de Hamoir, il n’hésite pas (2002) et, moins de quatre ans plus tard, c’est lui qui rachète l’outil à Nestlé. Seul actionnaire, V. Crahay prend la responsabilité d’un projet industriel ambitieux en donnant vie à l’entreprise Belourthe. En 2015, dans le monde des céréales hydrolysées pour enfants, il s’agit d’un cas exceptionnel de producteur indépendant.
Disposant de la marque Ninolac, déposée depuis 2009, V. Crahay concentre les activités de sa société sur des produits de haute valeur ajoutée, s’appuie sur un département R&D performant, dispose d’un mode de production très automatisé, propose des produits très diversifiés et adaptés à la demande, et prospecte les marchés considérés comme périlleux, notamment avec l’aide des agents de l’AWEX, ou lors de missions économiques. De 27 personnes au départ, Belourthe a plus que doublé ses effectifs (80) et réalise un chiffre d’affaires à deux chiffres. L’encadrement s’est renforcé, tandis que Vincent Crahay poursuit le volet « commercial » en Afrique, en Asie, au Moyen Orient, en Europe (Portugal) avec un succès certain.
Durant l’été 2014, un important investissement a porté sur la construction d’un système de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) en collaboration avec Primagaz, afin de disposer d’une source d’énergie autonome et propre. Même s’il exporte 95% de ses produits et est présent dans 50 pays sur tous les continents, l’administrateur délégué de Belourthe ne passe pas inaperçu dans le paysage industriel de la Wallonie, où sa société puise l’essentiel de ses matières premières. En octobre 2014, la société Belourthe a été désignée « Entreprise de l’année 2014 » par EY, BNP Paribas Fortis et L’Écho, avant de recevoir « le prix wallon de l’Entreprenariat » décerné par l’Agence wallonne de Stimulation économique (ASE), des récompenses qui valorisent toute une équipe et son capitaine.
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

DE COLNET Jacques-Antoine
Socio-économique, Entreprise
Lieu de naissance inconnu c. 1720, Charleroi ( ?) 05/06/1797
Descendants de la famille des Colnet, maîtres-verriers connus en pays wallon depuis le XVe siècle, plusieurs Colnet ou « de Colnet » apparaissent comme les figures de proue de cette dynastie aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Le remplacement progressif de l’emploi du charbon de bois par la houille dans les fours des verreries a une conséquence importante dès le milieu du XVIIe siècle. La qualité des charbons maigres du pays de Charleroi y attirent les maîtres-verriers.
Contribuant à l’essor de la période pré-industrielle dans le bassin de la Sambre (deuxième moitié du XVIIIe siècle), Jacques-Antoine de Colnet et Jean Vigneron créent en association une nouvelle usine à Jumet en 1745, afin d’y produire des bouteilles ; pendant près de vingt ans, les deux entrepreneurs jouissent d’avantages et d’immunités favorisant pleinement leurs activités. L’objectif du régime autrichien, dont dépend alors le Hainaut, est de permettre à cette industrie d’être concurrentielle par rapport aux produits français. En 1745, J-A. de Colnet est l’un des tout premiers industriels à en bénéficier. Douze ans plus tard, J-A. de Colnet s’associe cette fois à Emmanuel Falleur pour lancer une nouvelle fournaise, mais sans autre atout que son savoir-faire.
Héritier d’un titre nobiliaire obtenu au XVe siècle en raison de l’activité de verrier déployée par Jean et Colard, les Colnet devront défendre en justice ce titre et les avantages qui y sont liés car, à la fin du XVIIe siècle, ils leur étaient contestés ; c’est J-A. de Colnet qui aura confirmation des droits familiaux à un titre de noblesse non usurpé. Par ses activités dans le domaine de la verrerie à vitres, de la gobeleterie et de la bouteillerie, J-A. de Colnet perpétue un très ancien savoir-faire familial et contribue à une véritable activité industrielle dans le bassin de Charleroi qui prendra tout son essor au XIXe siècle.
Sources
E. CLOSE, Les gentilshommes verriers, dans Le Guetteur wallon, 1927, n°10, p. 203-217
http://gw.geneanet.org/pierfit?lang=fr;p=jacques+antoine;n=de+colnet (s.v. novembre 2014)
Ad. HABART, Les verreries de l’arrondissement de Charleroi, dans Documents et rapports de la société paléontologique et archéologique de l’arrondissement administratif de Charleroi, Mons, 1868, p. 288-292
Collection des actes de franchise…, dans Documents et rapports de la société paléontologique et archéologique de l’arrondissement administratif de Charleroi, Mons, 1870, t. III, p. 255-259
Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938
M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 93-103
Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955
Hervé HASQUIN, Une mutation. Le « Pays de Charleroi » aux XVIIe et XVIIIe siècles. Aux origines de la Révolution industrielle en Belgique, Bruxelles, 1971, p. 196-197
Paul Delforge

Colnet (ou Colinet) Nicolas
Socio-économique, Entreprise
Barbençon c. 1620, Barbençon 30/01/1696
Fils de Gilles de Colnet (ou de Colinet), Nicolas est le représentant de la 8e génération des Colnet depuis l’attestation de la présence de Jean de Colnet à Leernes au XVe siècle ; il appartient à la branche de Gilles Colnet, frère d’Englebert et fils de Colard Colnet. En 1651, il se retrouve à la tête de la fournaise de Barbençon. En trois décennies, le père a redynamisé la verrerie qui produit à la fois du verre clair potassique de modèles vénitiens, des verres « à la façon d’Allemagne » et du véritable « cristal de Venise ». Par son mariage avec une fille Polchet de la puissante famille de maître de forges, Nicolas de Colnet élargit et renforce la puissance économique de sa famille, d’autant que, sa sœur Françoise, a épouse Francesco Savonetti, un excellent verrier de Murano.
Mais la concurrence des Liégeois « Bonhomme » se fait de plus en plus sentir. Désormais installés à Bruxelles en plus de leur exploitation liégeoise (1658), les Bonhomme contestent la présence de verres de Barbençon à Bruxelles. Pendant quinze ans, l’affaire traîne en justice ; les procès se succèdent et, au final, la décision est favorable aux Bonhomme : en 1674, l’interdiction de fabriquer des verres fins est imposée à Nicolas de Colnet et à ses familiers qui ont déjà enregistré le départ de la plupart de leurs meilleurs souffleurs. L’avenir de leur activité est cependant préservé in extremis car, à la suite du traité de Nimègue (1678), Barbençon est attribuée à la couronne de France ; la production du « cristal de Venise » peut dès lors reprendre, avec de nouvelles perspectives commerciales : en plus de l’Entre-Sambre-et-Meuse, la France accueille les produits verriers wallons. Outre les produits à la façon de Venise, la verrerie Colnet s’adaptera à l’évolution du goût de l’époque, en copiant ceux de Bohème.
Dirigée ensuite par Albert Emmanuel de Colnet (Barbençon 1654, Barbençon 02/10/1742), seigneur de Charnaux, fils de Nicolas, la verrerie de Barbençon, enclave française, sera la dernière gobeleterie héritière des premières fournaises allumées dans le pays wallon au XVe siècle.
Sources
M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 103-104
Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938
Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955
http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=nicolas;n=de+colnet (s.v. novembre 2014)
Informations communiquées par Michel Hubert (novembre 2014)
H. SCHUERMANS, Verres façon de Venise fabriqués aux Pays-Bas. 9e lettre au Comité, dans Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1889, t. 28, p. 209-260
Paul Delforge

De Colnet Jean
Socio-économique, Entreprise
Pays wallon XVIIe siècle
Descendants de la fameuse famille des maîtres-verriers Colnet (Colinet), connus en pays wallon depuis le XVe siècle, plusieurs « Jean de Colnet » apparaissent comme les figures de proue de cette dynastie au XVIIe siècle. Sur les liens de parenté unissant les uns aux autres, la prudence reste toutefois de mise, en raison de l’absence de sources très précises. Les archives font cependant état, avec certitude du privilège d’exploiter une verrerie à Jumet, aux Hamendes, accordé par les archiducs Albert et Isabelle à un Sir de Colnet en 1599. La même année, Jean et Pierre Colnet sont traités de la même façon pour leurs établissements installés à Ways-Bousval, Thy et Baisy, confirmant la présence des Colnet aussi en Brabant wallon.
Mais la prospérité d’antan des Colnet souffre de plusieurs facteurs. Le remplacement progressif de l’emploi du charbon de bois par la houille dans les fours des verreries a une conséquence importante dès la première moitié du XVIIe siècle. La qualité des charbons maigres du pays de Charleroi y attirent les maîtres-verriers. Par ailleurs, Anvers a obtenu un monopole absolu sur les productions à la manière de Venise. À Liège, les Bonhomme sont de redoutables concurrents. Enfin, les troubles provoqués par les guerres de religion font fuir les ouvriers étrangers. En quelques années, les Colnet ont dû vendre Momignies et fermer progressivement Leernes, Froidchapelle et Beauwelz, celle-ci en 1620. L’heure est à la reconversion…
En 1614, un Colnet sert comme trésorier général le duc de Croy. Vers 1655-1659, deux Colnet travaillent à Liège dans les verreries de la famille Bonhomme. On retrouvera encore des Colnet, fondateurs de verreries au XVIIIe siècle, à Gand, à Bruges (Arnould-Joseph y est le plus gros producteur de bouteilles) et à Dunkerque, voire en Angleterre.
Attirés par la présence du charbon, des Colnet s’installent à Lodelinsart, à Gilly et encore à Jumet. Ils participent à l’exploitation d’une verrerie à Châtelet, pour laquelle le verrier italien Antoine Buzzone a obtenu l’octroi en 1636 ; elle sera reprise ensuite par Henry Bonhomme. En 1645, deux verreries fonctionnent à Charleroi et une à Hourpes ; elles sont aux mains de Jean, Roch et Guillaume Colnet. Dispersées dans la campagne, elles assurent une production de verres communs (verres à vitres, gobelets) ; seul Barbençon se singularise par le maintien d’une production de qualité originale.
Ayant hérité de leurs ancêtres un statut nobiliaire très particulier en raison de leur art si singulier, le Jean de Colnet qui est connu comme « maistre de la verrerie des Hamendes », à Jumet, au milieu du XVIIe siècle, use de son patronyme pour correspondre à son statut et bénéficier des avantages qui y sont liés. Pendant douze ans, Jean de Colnet devait jouir d’un privilège de fabrication exclusive pour son usine de Gilly, obtenu le 3 avril 1686, pour l’ensemble des Pays-Bas. Il aura l’obligation de marquer ses verres à son coin et d’établir un magasin dans les principales villes des Pays-Bas ; l’exclusivité qu’il avait obtenue sous prétexte que l’industrie verrière de la région était anéantie devait lui permettre de fabriquer aussi bien des bouteilles, des gobelets que du « verre de vitre en table ». Propriétaire d’une verrerie à bouteilles dans le faubourg de Charleroi, Gédéon Desandrouin contestera en justice ce monopole (1688) et Jean de Colnet ne disposera plus de l’exclusivité que pour le verre à vitre, mais verra ce privilège renouvelé pour six ans, en 1695.
Par ailleurs, fabriquant de gobelets et de bouteilles, un Jean-Baptiste de Colnet, cousin de Jean de Colnet, obtient le droit d’installer à Gilly une verrerie fabriquant des vitraux peints (1686) ; son entreprise pâtira cependant de la prise de Charleroi, en 1693, par les armées françaises ; la Guerre dite de Neuf Ans (1688-1697) rend en effet particulièrement périlleuses toutes entreprises industrielles ou commerciales en pays wallon.
Par le truchement des Colnet, les contacts ont été nombreux, au XVIIe siècle, entre les verreries du pays de Liège et celles des terres hennuyères ressortissant aux Pays-Bas espagnols. Ils se poursuivront au XVIIIe siècle. Ainsi, un descendant d’un verrier altariste, Jacques de Castellano, épousera une Colnet, et œuvrera à la fois à Liège et à Charleroi, où il mourut en 1719. Sous le régime autrichien, les Colnet restent des maîtres-verriers actifs dans le pays de Charleroi, mais ils partagent la production avec d’autres familles, comme les Falleur, les Dorlodot, les Desandrouins, les de Condé ou les Foucault.
Sources
Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938
M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 93-103
Michel PHILIPPE, Naissance de la verrerie moderne XIIe-XVIe siècles. Aspects économiques, techniques et humains, Turnhout, Brepols, coll. dans De Diversis Artibus, XXXVIII, p. 80, 241-242, 402-403
Benoît PAINCHART, extrait de la revue Éclats de Verre, n°8 ; cfr www.genverre.com
Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955
Hervé HASQUIN, Une mutation. Le « Pays de Charleroi » aux XVIIe et XVIIIe siècles. Aux origines de la Révolution industrielle en Belgique, Bruxelles, 1971, p. 71
http://afaverre.fr/Afaverre/bibliographie-de-raymond-chambon-concernant-le-verre/
Georges DANSAERT, Faire son chemin. Histoire de la famille Desandrouin, dans Documents et rapports de la Société royale paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, Thuin, 1937, t. 37, p. 1-14, 19
E. CLOSE, Les gentilshommes verriers, dans Le Guetteur wallon, 1927, n°10, p. 203-217
La difficile gestion des ressources humaines autour d’un four de verrerie à la fin de l’Ancien Régime en France par Stéphane Palaude, docteur en Histoire, Université de Lille 3
Adolphe-Jérôme BLANQUI, Dictionnaire du commerce et de l’industrie, Volume 4, p. 449
Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 256
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 277
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 277
Paul Delforge

de COLNET (COLINET) (lignée Englebert Colnet) François
Socio-économique, Entreprise
Pays wallon début du XVIe siècle, Leernes après 1559
Fils du maître verrier Englebert de Colnet, François poursuit les traditionnelles activités verrières à Leernes. Il produit essentiellement des bouteilles et de la gobeleterie. Néanmoins, pour faire face à une concurrence de plus en plus rude, François de Colnet s’associe à d’autres verriers, dont Jean Ferry, de cette famille de verriers italiens qui feront souche en pays wallon, et Robert de Liège.
En 1559, Philippe II confirme les privilèges accordés aux de Colnet depuis le siècle précédent et les associés de François de Colnet sont inclus dans les lettres patentes accordées pour l’exploitation de Leernes. Marié à Catherine Polchet, fille d’un puissant maître de forges du pays de Chimay, François de Colnet n’aura qu’un enfant, Paul, avec lequel s’éteint la branche inaugurée par Englebert dans la dynastie des Colnet. C’est par la branche de Gilles que les Colnet continueront pendant quatre siècles à fournir au pays wallon l’essentiel des bouteilles, gobelets et verres à vitres courants. Entre le XVe et le XIXe siècle, ils sont plus de cent Colnet actifs dans le secteur du verre.
Sources
M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique : des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 93-103
Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938
http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=gilles;n=de+colnet
http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=englebert+ou+engrant;n=de+colnet
http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=collart;n=de+colnet
http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=francois;n=de+colnet;oc=3 (s.v. 27 novembre 2014)
Michel PHILIPPE, Naissance de la verrerie moderne XIIe-XVIe siècles. Aspects économiques, techniques et humains, Turnhout, Brepols, coll. dans De Diversis Artibus, XXXVIII, p. 80, 241-242, 402-403
Stanislas BORMANS, La fabrication du verre de cristal à Namur, dans Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1888, volume 27, p. 472, note 1 qui cite J-G. Le Fort, héraut d’armes du pays de Liège
Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955
Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 256
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 277
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 277
Paul Delforge

Collinet Léon
Politique, Socio-économique, Entreprise
Liège 12/05/1842, Huccorgne 19/09/1908
Avocat et administrateur de sociétés, bourgmestre de Huccorgne, Léon Collinet est connu comme le fondateur de la société Carmeuse, en 1860, devenue leader mondial de la production de calcaire.
Fils de François Joseph Michel, avoué près de la Cour d’Appel de Liège, l’avocat Léon Collinet épouse, en 1864, Fanny d’Oreye, une union qui consolide sa position dans le milieu juridique – son beau-père est conseiller à la Cour d’Appel – et lui ouvre les portes du milieu industriel liégeois – son beau-frère est l’industriel Maximilien D’Oreye.
Fondateur, en 1860, de la société Carmeuse, à Liège, spécialisée dans la production de la chaux et du calcaire, « Léon Collinet a 23 ans lorsqu’il s’engage dans le mouvement de structuration de l’opinion catholique (1865). Il accepte de défendre les couleurs catholiques, sans espoir aux élections de 1882 ». Ultramontain reconverti au catholicisme social, Président de l’Union nationale pour le redressement des Griefs, fondée en 1884, il est à l’origine des deux premiers Congrès des Œuvres sociales à Liège, en 1886 et 1887. Convaincu de la nécessaire recatholicisation en profondeur de la société, il devient bourgmestre de Huccorgne, en 1890, une fonction qu’il exercera jusqu’à sa mort.
Administrateur de nombreuses sociétés, soutenues par la Banque des Travaux publics de Bruxelles et par le Crédit général liégeois, à la tête d’une importante fortune – dès 1884, Léon Collinet possède 23 biens immobiliers dans la région liégeoise – qui lui permet d’être éligible au Sénat, à partir de 1889 (achat du château de Famelette), il rédige de nombreuses brochures affirmant la supériorité de l’Église sur l’État. Publiciste, il collabore également à la Gazette de Liège et au Courrier de Bruxelles.
Sources
Ginette KURGAN-VAN HENTENRIJK, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, éd., Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les réseaux, Bruxelles, De Boeck, 1996, p. 117-118
http://www.carmeuse.com/history http://gw.geneanet.org/gounou?lang=fr;p=leon;n=collinet
http://www.lesoir.be/archives?url=/regions/liege/2010-06-09/le-groupe-mondial-reste-une-societe-familiale-775027.php (s.v. décembre 2014)
Marie Dewez

Brain Richard
Conception-Invention, Ingénieur-inventeur, Socio-économique, Entreprise
Grande-Bretagne fin XVIIIe siècle, Liège c. 1840/1850
Ouvrier anglais ayant travaillé comme surveillant et contremaître dans l’entreprise Boulton-Watt à Birmingham, Richard Brain se laisse convaincre de suivre John Cockerill dans les projets qu’il développe à Liège et à Seraing. Il s’y installe en 1818. Détenant quelques secrets de fabrication que l’Angleterre tente, tant bien que mal, de conserver, il contribue au montage de plusieurs machines à vapeur et, avec Cockerill, il prospecte aussi le marché des exploitations houillères wallonnes afin d’évaluer les besoins et de proposer des machines adaptées. Responsable de la fonderie, Brain ne s’entend cependant plus avec les frères Cockerill et, durant l’été 1819, le mécanicien anglais décide de voler de ses propres ailes en prospectant pour lui-même au pays de Liège.
Le transfuge y propose ses services – surtout son savoir-faire et ses connaissances – à quelques rentiers qui sont prêts à investir dans les « techniques nouvelles », porteuses de revenus intéressants. À Ougrée, avec un autre ouvrier anglais (Hope), Brain convainc Ista d’investir dans une fonderie que Charles Quirini-Goreux (Liège 1780 - Jemeppe 1862) a créée récemment (1809), mais qu’il ne parvient pas à rentabiliser. Occupant une vingtaine d’ouvriers, la fonderie d’Ougrée créée en décembre 1819 parvient notamment à vendre une petite dizaine de machines à vapeur. Ainsi, Richard Brain a-t-il installé plusieurs machines du type Watt pour actionner des moulins à Alost (1819), à Hamme (1820), à Gand et à Louvain (1821). Ce sont les toutes premières machines de ce type installées en Flandre. Mais ce n’est pas suffisant pour la société de Brain et ses associés, et la faillite est déclarée (1822). En décembre 1826, Brain tente d’installer à Bruxelles une grande fabrique de machines à vapeur, sans succès cependant. En 1827, avec un projet similaire, il s’associe avec un industriel installé à Hourpes, Hubert Lejeune, sans plus de réussite.
Relançant son projet « liégeois » avec d’autres bailleurs de fonds, Brain fonde les « Ateliers d’Ougrée à Seraing » (1821), en s’associant avec Watrin-Dardespine. Parmi les 17 machines installées, on sait qu’il vend notamment une machine à vapeur soufflante à Hubert Lejeune – il s’agit seulement de la 2e machine de ce type installée en Hainaut – et qu’il installe à Bruxelles une machine permettant l’alimentation en eau. Mais son activité pourtant diversifiée ne parvient toujours pas à décoller (1828).
La troisième tentative wallonne de Brain sera la bonne. La fortune des Lamarche est telle qu’ils peuvent se permettre de racheter tous les biens de Quirini-Goreux, y compris les installations conçues par Brain. Il n’est plus question de location et de production à petite échelle. Richard Brain a convaincu Gilles Antoine Lamarche et ses frères de se lancer dans un projet ambitieux. Les Lamarche s’occupent de la gestion financière et Brain dispose de toute l’indépendance nécessaire dans la direction technique.
À la manière d’un William Cockerill avec les industriels de la laine verviétois, Richard Brain pilote le projet industriel, embauche des ouvriers anglais qui lui apportent les derniers perfectionnements techniques et utilise la main d’œuvre locale dont l’habilité n’a rien à envier à ses collègues d’outre-Manche. L’ancienne fonderie se transforme en usine intégrée, avec comme objectif la fabrication de machines à vapeur et autres objets métalliques (1829). En moins de sept ans, la Société d’Ougrée connaît un développement exceptionnel.
En 1836, avec l’apport en capital de la jeune Banque de Belgique, se constitue la « Société anonyme de la Fabrique de Fer » qui se dote progressivement du matériel le plus moderne de l’époque (deux hauts fourneaux au coke, 16 fours à puddler, laminoir, fonderie, 6 machines à vapeur) pour « fabriquer de la fonte moulée, du fer et des machines ». Au moment où, sous la gouverne d’un ministre liégeois, la Belgique se lance dans la construction d’un ambitieux réseau ferroviaire, la société fournira, notamment, les rails du chemin de fer. Pour Richard Brain, la transformation de la fabrique en Société anonyme marque la fin de son association d’égal à égal avec les Lamarche : ceux-ci reprennent toutes les participations financières de l’Anglais qui est désormais employé par la Société de la Fabrique de fer d’Ougrée, avec un salaire à la hauteur de son apport technique et de son statut de « directeur-gérant ». C’est ainsi qu’un mécanicien anglais, autre que William Cockerill, désormais installé en pays wallon, contribue à l’essor de la révolution industrielle en Wallonie. Une quarantaine de machines à vapeur sortiront de « son » usine et seront implantées en Belgique. Il avait surtout contribué à installer la structure de base de la Fabrique de Fer d’Ougrée, appelée à un développement considérable.
Sources
Anne VAN NECK, Les débuts de la machine à vapeur dans l’industrie belge, 1800-1850, Bruxelles, Académie, 1979, coll. Histoire quantitative et développement de la Belgique au XIXe siècle, p. 119, 242, 267, 269, 281, 288, 289, 293-295, 307-309, 316, 323, 331-333, 356, 359, 371, 416, 419, 540, 543, 559, 561, 564, 571, 572, 728, 783, 830
Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 21-22
J. PURAYE, G.A. Lamarche, 1785-1865. Notes pour servir à l’histoire industrielle du pays de Liège, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 1962, t. 75, p. 101-151
Frank BECUWE, In de ban van Ceres. Klein- en grootmaalderijen in Vlaanderen (ca. 1850 – ca 1950), Bruxelles, 2009, Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen n°3 (https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELM/3/RELM003-001.pdf ) (s.v. octobre 2014)
Marinette BRUWIER, Les relations dynamiques entre le progrès industriel et la construction des machines, dans B. VAN DER HERTEN, M. ORIS, J. ROEGIERS (dir.), La Belgique industrielle en 1850 : deux cents images d’un monde nouveau, Anvers, Bruxelles, 1995, p. 133
Paul Delforge
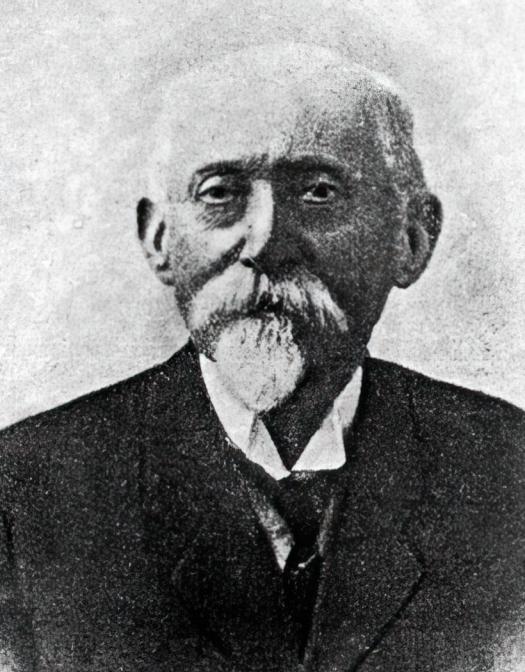
Bon Cassian
Socio-économique, Entreprise
Liège 14/10/1842, Terni 13/11/1921
En Ombrie, la cité de Terni, petite bourgade campagnarde au début du XIXe siècle devient en quelques années un centre industriel et ferroviaire de première importance. Ce développement, la cité le doit en partie à un Wallon, Cassian Bon, qui, dans les années 1870, s’est en quelque sorte transformé en « John Cockerill » de l’industrie sidérurgique italienne. Mais autant il occupe une place importante dans l’histoire de l’Italie, de Terni en particulier, autant il est totalement oublié dans l’histoire de la Wallonie.
Beau-frère de Léopold de la Vallée Poussin, le « patron » de la toute jeune SA « Cie générale des Conduites d’eau » spécialisée dans la fabrication et la pose de tuyaux destinés à la distribution d’eau et de gaz, Cassian Bon est un fils de bonne famille (d’origine albigeoise, son père fait sa carrière d’avocat à Liège) qui est envoyé à Rome, en 1867, pour surveiller un des plus gros chantiers du moment : l’aménagement de l’Acqua Pia. Avant l’inauguration de l’aqueduc (10 septembre 1870), Cassian Bon a noué plusieurs contacts dans la péninsule, il a certes rencontré des artistes wallons en séjour à Rome (comme Léon Philippet qui réalisera son portrait), mais surtout il a visité plusieurs villes d’Ombrie, de Toscane, du Latium ou de Vénétie et constaté l’absence d’équipements publics.
Afin de convaincre de l’intérêt des « progrès techniques », Cassian Bon obtient des autorités italiennes et de celles de Pérouse le droit d’installer, à ses frais, une usine à gaz de pétrole : au début des années 1870, la cité est éclairée par plus de 500 « illuminations ». Privilégiant le gaz de pétrole – moins cher et plus riche en Italie – il a fait breveter un système de son invention qui va essaimer dans la botte italienne. À la tête de la « Société générale pour l’éclairage au gaz », C. Bon gère, à partir de 1874, les approvisionnements des éclairages installés à Pérouse, Lecce, Cosenza, Terni, et bien d’autres villes encore.
Mais là ne s’arrête pas l’aventure italienne du Wallon. Au contraire, elle ne fait que commencer. Sa rencontre avec le Vénétien Stéphano Breda, entrepreneur (aqueducs, voies ferrées, etc.) et homme politique, est importante.
À Terni, on ne trouve ni houille ni minerai de fer ; très éloignée de la mer, l’environnement de la cité ne présente que deux atouts : la force hydraulique de la rivière Néra et l’abondante forêt d’Ombrie. Y trouvant un combustible à très bon marché et en faisant venir les minerais de l’île d’Elbe, des industriels milanais et allemands installent deux hauts fourneaux au lendemain de la guerre franco-prussienne. Le prix élevé de la fonte n’a qu’un temps et la qualité de la fonte produite est loin de correspondre à la demande du marché.
Après moins de deux années d’exploitation (1873-1875), l’usine « Lucowich et Cie » ferme ses portes. En 1879, les premiers investisseurs sont très satisfaits de revendre les outils à Cassian Bon qui s’empresse de fonder une société en commandite par actions, la « Sté des hauts fourneaux et fonderies de Terni, Cassian Bon et Cie ». La société va fabriquer des tuyaux en fonte et du matériel hydraulique destinés aux aqueducs qui se construisent à Venise, Naples, Ancône, etc., et à nombre de nouvelles distributions d’eau et de gaz. L’industriel wallon devient un acteur du développement industriel italien, obtenant des commandes dans des domaines qui se diversifient (bateaux, canons, etc.). Il n’ignore pas, grâce à des contacts avec Stephano Breda, entrepreneur comme lui, ingénieur mais surtout député, que l’État italien cherche le moyen de se rendre indépendant de l’étranger dans la fabrication d’armes de guerre. Plusieurs sites sont en concurrence, mais finalement c’est Terni qui est choisie, en 1883, par le ministre Benedetto Brin et la société Veneta, appartenant à Breda, devient le maître d’œuvre.
Pour Cassian Bon qui connaît alors d’importantes difficultés, ce choix est providentiel. Ayant pris contact avec Henri Schneider au Creusot, il s’associe à la société de Breda et, en 1884, voit le jour la « Sté des hauts fourneaux, fonderies et aciéries de Terni » ; le capital de la Saffat sera multiplié par sept en vingt ans. Dans les milieux politiques italiens, on s’est (enfin) accordé pour faire de Terni – située loin des frontières et disposant d’une énergie hydraulique considérable – le plus grand complexe sidérurgique pour la production d’armements.
Faisant venir plusieurs ingénieurs du Creusot et de Liège, Cassian Bon s’assure ainsi de la collaboration et de l’expérience du Creusot et de la société John Cockerill. Il s’agit d’être à la pointe dans la technologie, notamment dans les matériaux de blindage. En juillet 1887, bien qu’il fonctionne déjà depuis plusieurs mois, le « Grand Marteau de Terni », pesant 108 tonnes, est inauguré officiellement ; il restera en activité jusqu’en 1910, symbolisant les débuts de la révolution industrielle en Italie. En 1889, de Terni sort 50 % de la production italienne d’acier. De Terni sortent des produits à la fois très diversifiés et à la pointe du progrès pour la défense nationale italienne : au début du XXe siècle, Terni en détient le monopole.
Mais par ailleurs, Cassian Bon diversifie ses activités. À Terni, il réalise des produits destinés au commerce (clous, rails, wagons, tôles, boulons, rivets, etc.). Il fait venir de Liège de nombreuses machines-outils. Investisseur, il dote aussi la cité de la distribution d’eau potable, de l’éclairage public, d’une fabrique de glace pour les hôpitaux de la ville, tandis que d’autres industriels viennent s’y installer, favorisés par l’inauguration d’une ligne de chemin de fer qui relie Terni à Sulmona (1883).
Par conséquent, c’est toute une région qui se transforme, vivant sa « Révolution industrielle » et ses multiples conséquences, en raison de l’investissement initial de Cassian Bon. Mais d’autres initiatives relèvent encore de l’investisseur, en France comme ailleurs en Italie. L’un des premiers biographes, Maurice Cloës, assure qu’il reçut de la population comme des autorités italiennes de multiples marques de sympathie, de remerciements et de reconnaissance (notamment il a été élevé Chevalier de l’Ordre de la Couronne italienne). Une avenue de Terni porte notamment son nom et sans conteste, Bon, Breda et Brin ont leur nom gravé au panthéon de l’industrie sidérurgique italienne.
Sources
Maurice CLOËS, dans La Vie wallonne, I, 1968, n°321, p. 21-27
Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, Liège, 1995, p. 260
Thérèse LAMARQUE-BON, Cassian Bon : un maître de forges en Italie au XIXe siècle, s.l., Hélette-Curutchet, 1998
Gino PAPULI, La macchina e il monumento. La grande pressa di Terni, Instituto per la cultura et la storia d’impresa « Franco Momigliano », 2006
Alessandro BOSELLI, La sidérurgie de guerre de l’Italie, monopole de Terni, traduit de l’italien
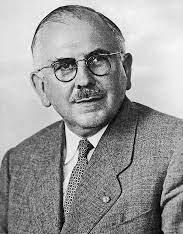
Bister François
Socio-économique, Entreprise
Namur 4/10/1891, Namur 3/02/1968
Peut-être moins connue que celle de Dijon, la moutarde Bister qui est produite dans la région namuroise est le produit phare d’une entreprise familiale qui s’est développée au XXe siècle grâce à François Bister. Fils d’un entrepreneur spécialisé dans la plomberie et l’installation des systèmes sanitaires, François laisse à son frère Jules le soin de poursuivre les activités de la fructueuse entreprise familiale, et se tourne vers le secteur alimentaire. Après la période de la Grande Guerre, où il fut volontaire et combattant sur l’Yser, François Bister reprend d’abord « la Chicorée de la Meuse » dans les années 1920.
Installé à Jambes, rue de Francquen, l’industriel subit d’importants préjudices suite aux inondations catastrophiques de la Meuse en janvier 1926. Cette année 1926 est généralement retenue comme la date de naissance de la fabrique Bister. C’est en tout cas le moment où il relance ses activités de torréfaction, avant d’installer successivement une vinaigrerie et une moutarderie, l’année même où éclate la crise de Wall Street. Le rachat du secret de fabrication de la moutarde « L’Impériale », marque connue depuis 1877, est un succès qui brave le contexte économique morose ; dès les années 1930, la moutarde régionale est vendue au poids, dans les épiceries, à partir de gros pots en grès déjà fort caractéristiques.
Alors que la torréfaction de la chicorée a été abandonnée (1939), le succès de la moutarde ne se dément pas à la Libération, moment où Bister lance sur le marché un pot dont la forme évoque la grenade américaine Mills, cet explosif à fragmentation qui trouve, dans la cuisine, une interprétation bien particulière en raison de son goût piquant et fort. Assurément, l’industriel wallon a un sens commercial et surtout une approche marketing peu communes.
Modèle déposé, la forme particulière du bocal assure définitivement l’image de la marque. Le vinaigre l’Epi (fait à partir de grains) vient enrichir une gamme de produits qui ne cessera plus de se diversifier (oignons, cornichons, etc.), remportant des médailles lors de nombreuses expositions. En plus du développement de son entreprise sur les bords de la Meuse, à Jambes, François Bister est aussi l’un des fondateurs de la Fédération des industries alimentaires. Son fils Jean, puis sa petite-fille, Fabienne, poursuivront les activités de l’entreprise.
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
Philippe-Edgard DETRY, dans Françoise JACQUET-LADRIER (dir.), Dictionnaire biographique namurois, Namur, Le Guetteur wallon, n° spécial 3-4, 1999, p. 37-38
http://www.bister.com/la-famille-bister-et-lhistoire-de-la-moutarderie (s.v. septembre 2014)
Paul Delforge
