
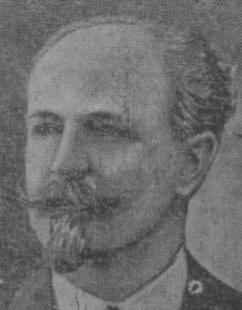
Proumen Henri-Jacques
Culture, Littérature
Dison 23/05/1879, Bruxelles 01/10/1962
Cherchant à cerner l’œuvre littéraire de Henri-Jacques Proumen, son meilleur biographe évoque l’abondance dans la diversité : « Roman, conte, nouvelle, poème, fable, étude psychologique, étude de mœurs, récits de science-fiction, récits des temps préhistoriques, récits fantastiques, comédie, satire, farce, critique littéraire voisinent chez cet écrivain polygraphe avec des œuvres qui traitent de chimie ou de physique » (LACROIX).
Ayant grandi dans les milieux de l’opulente bourgeoisie verviétoise enrichie par ses activités dans le textile, H-J. Proumen accomplit ses humanités de l’Athénée de Verviers, tout en cherchant sa voie à l’Académie des Beaux-Arts de Liège (1895). Attiré par la peinture et le chant, ce lecteur assidu se passionne pour les sciences ; ingénieur civil des Mines de l’Université de Liège (1902), il se spécialise dans le domaine de la radioactivité, et est rapidement reconnu par les experts du moment, comme Marie Curie, sans parvenir à décrocher un poste à l’Université de Paris. Professeur de Sciences aux Athénées de Verviers, Bruxelles, puis Hal, le chercheur poursuit ses activités et publie des traités pointus de physique et de chimie, ainsi que des ouvrages pédagogiques. Appelé comme collaborateur scientifique à l’Institut Solvay, il dispense la Physique aux cours publics de la ville de Bruxelles peu avant la Grande Guerre ; il restera le titulaire de ce cours jusqu’en 1954. Au moment de l’invasion allemande d’août 1914, H-J. Proumen parvient à trouver refuge en Grande-Bretagne : professeur à Eton et à Londres, il devient ensuite proviseur au Lycée français de Londres (1915-1919) ; après six mois d’enseignement à Paris, il reprend son poste à Bruxelles, et son activité scientifique est reconnue quand il est nommé à la direction du nouvel Institut des Arts et Métiers de Bruxelles (1930-1938) ; mais le scientifique, qui continuera à publier des traités jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, a déjà amorcé une autre activité où son talent est aussi reconnu.
Chroniqueur artistique du journal Le Jour, à Verviers (1902-1905), H-J. Proumen publie son premier roman à Paris au printemps 1914, et deux autres suivent, à Londres, en 1918, qui sont favorablement accueillis par la critique. Membre de la Société des Gens de Lettres de France (1924), Proumen est un auteur éclectique et fécond : plusieurs centaines de contes et de nouvelles paraissent dans des journaux et revues, en Belgique comme à l’étranger ; certains textes sont rassemblés dans des recueils ; et chaque année au moins, l’écrivain sort un ouvrage sans se laisser enfermer dans un genre précis. Maniant facilement l’ironie et la satire, il se ferme quelques portes en critiquant, avec Léon Debatty, L’Académie des Lettres belges (1922). Néanmoins, le Prix du gouvernement Belge qui récompense Totor et moi (1924) consacre un talent neuf, qui atteint sa pleine maturité dès 1928, quand il publie Le chemin des dieux ; dédié à Maurice Renard, ce premier roman fantastique est généralement reconnu comme sa meilleure œuvre. En 1930, c’est Le Sceptre volé aux hommes qui attire sur lui le Prix international de Littérature de Genève et le Prix Maurice Renard de la Société des gens de lettres de France. Explorant des thèmes neufs (la préhistoire et la condition de la femme, par exemple), Henri-Jacques Proumen est un précurseur dans le roman d’anticipation. Avec la naissance de sa fille, il s’adonne aussi à l’écriture de contes et de récits pour enfants : Panache d’or et couette d’argent (1937) est un succès de librairie. Conférencier, il est aussi chroniqueur scientifique.
Ayant ralenti considérablement ses activités durant la Seconde Guerre mondiale, il les relance en 1945, en créant notamment l’Académie internationale de Culture française, dont l’objectif vise à proclamer et propager l’universalité de la culture française (1945-1973). En 1949, un an après Maeterlinck, l’Académie française lui décerne la médaille de la langue française pour l’ensemble de son œuvre, en particulier pour ses Fables choisies. En 1953, c’est le conseil provincial de Liège qui lui octroie le Prix de consécration littéraire de langue française. L’écrivain a ralenti le rythme de ses publications ; en 1956 sort son dernier roman, Mon clair matin, où il évoque son enfance heureuse à Andrimont et à Dison, localité qui honore son citoyen cette année-là. Alors que de nombreux projets et manuscrits sont en chantier ou achevés, une thrombose (1959) handicape définitivement les derniers jours de l’écrivain.
Situant généralement en France le lieu de ses récits, Proumen a peu évoqué sa région natale ; quelques endroits surgissent un peu par hasard et s’il n’a pas la fibre régionaliste, il écrit, vers 1923-1924, un hymne chaleureux à la Wallonie dans la préface aux Contes et nouvelles de Wallonie, extraits de l’Almanach wallon.
Sources
Jean LACROIX, Henri-Jacques Proumen. À la découverte d’une œuvre, dans La Vie wallonne, 1988, n°401-402, p. 18-28 ; 1988, n°403-404, p. 152-159
http://ecrivains-vervietois.blog4ever.com/proumen-henry-jacques (s.v. mai 2016)
Œuvres principales
Ouvrages scientifiques
Les rayons X, le Radium, les Rayons N, 1905
La Matière, l’Ether, l’Électricité, 1909
Œuvre littéraire
La Pétaudière, Paris, 1914
Petites Âmes, Londres, 1918
Le Petit Lapin de Maman, Londres, 1918
Transplantés chez Albion, 1921 (préf. Henri Barbusse)
Totor et moi, 1924
Le ver dans le fruit, 1925
La Suprême flambée, 1927
Sur le chemin des dieux, 1928
Le sceptre volé aux hommes, 1930
La boîte aux marionnettes, 1930 (recueil)
L’Homme neuf, 1931
Le nez de mon oncle, 1932 (recueil)
Il pleut bergère…, 1932 (recueil)
Cupidon sans fard, 1933 (recueil)
Gens de la plèbe, 1933 (recueil)
Eve proie des hommes (roman de la femme préhistorique), 1934
Kiss aux yeux d’or, 1934 (recueil)
Fable sur tout et sur rien, 1936
Panache d’or et couette d’argent, 1937 (pour enfants)
Le roi Berlingot, 1938 (recueil)
Chrysos aux ailes de flamme, 1939 (pour enfants)
Aubes cruelles, 1942
Annette, fille des champs, 1943
Bellis et les quatre génies, 1943
Guitte, 1944
La brèche d’enfer, 1946
La couronne d’émeraudes, 1946 (pour adolescents)
Vieil-Ami, 1947
Fables choisies, 1948
La tabatière d’or, 1948
Monsieur Coq en pâte, 1948
Mitsou, 1950
L'homme qui a été mangé et autres récits d'anticipation, 1950
Armes nouvelles dans une guerre future, 1950
Annick et Poutinet, 1952 (recueil)
Mon clair matin, 1956
 © Bibliothèque du Conservatoire royal de Bruxelles
© Bibliothèque du Conservatoire royal de Bruxelles
Prevost Germain
Culture, Musique
Tournai 23/08/1891, San Francisco 1987
Altiste du Quatuor Pro Arte dirigé par Alphonse Onnou, Germain Prevost a participé à l’aventure étonnante de ce quatuor à corde constitué dans des conditions difficiles au moment de la Grande Guerre, qui rencontra plein succès dans l’Entre-deux-Guerres, avant de connaître une seconde vie aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale.
Natif de Tournai, formé au Conservatoire de Bruxelles, Germain Prevost y remporte, en 1913, un premier prix d’Alto, dans la classe de Léon Van Hout, membre du Quatuor Ysaÿe. Le projet de former un quatuor sur le modèle « Ysaÿe » animait déjà le violoniste verviétois Alphonse Onnou. Il faudra quelques années avant que ne se mette en place définitivement le Quatuor Pro Arte, nom trouvé en 1917. La composition du groupe varie fortement en ces années de guerre et de reconstruction. Mais Onnou s’appuie très rapidement sur Laurent Halleux, un autre Verviétois, comme second violon et, à partir de 1919, Germain Prévost en devient le troisième pilier ; arrivé en même temps que lui, Fernand Quinet (Prix de Rome 1921) cèdera son siège à Robert Maas. Contraints au service militaire, les jeunes musiciens se produisent parfois sous le nom de « Quatuor à Archets du 1er Régiment des Guides » (1920-1921), mais une fois libérés de leurs obligations, les membres du quatuor ne vont plus cesser de se produire sous le nom Pro Arte, pendant vingt ans, rencontrant un succès exceptionnel durant tout l’Entre-deux-Guerres.
Pendant un peu plus de dix ans, jusqu’au début des années 1930, Bruxelles est le lieu régulier des Concerts Pro Arte, mais, de plus en plus souvent, le quatuor est appelé à l’étranger. Remarqué par Elizabeth Sprague Coolidge, une milliardaire américaine passionnée par la musique de chambre, le quatuor est invité aux États-Unis dès 1926 ; il se produit lors de l’inauguration de la salle de musique de la bibliothèque du Congrès, à Washington, puis régulièrement, grâce à sa mécène, il retourne en Amérique du Nord pour donner notamment les Concerts Pro Arte-Coolidge.
Le quatuor fait connaître des compositeurs de son époque (choix artistique d’Onnou), ou plus classiques (orientation de Halleux). Ils interprètent Schönberg, Berg, Roussel, Honegger, Absil… et reçoivent des compositions spécifiques de Bartok, Milhaud, Stravinsky, qui sont autant de témoignages de la qualité du groupe. À travers les États-Unis, les tournées du quatuor d’Onnou sont appréciées, mais fatigantes : en 1939, Robert Maas déclare forfait. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, Onnou et ses compagnons musiciens (dont le violoncelliste anglais Warwick-Evans pour remplacer Maas) se retrouvent coincés Outre-Atlantique. Ils décident alors de continuer à se produire sur place. Le responsable de l’Université du Wisconsin, leur offre l’hospitalité, sur le campus, en tant que « quatuor-en-résidence ».
Frappé d’une leucémie, aux États-Unis, en 1940, Onnou est le premier à disparaître. Il est remplacé par le catalan Antonio Brosa (1894-1979), formé à Barcelone à l’école verviétoise du violon par Mathieu Crickboom. En 1943, c’est Laurent Halleux qui décide de démissionner. Dernier représentant du groupe originel, l’altiste Prevost décide à son tour de jeter le gant en juin 1947, cédant la place à des Américains qui perpétuent durablement le Pro Arte Quartet of the University of Wisconsin, puisque le quatuor fête ses cent ans d’existence en 2013, avant d’entreprendre une courte tournée en Wallonie et à Bruxelles.
En 1944, Igor Stravinsky avait dédicacé à Germain Prevost l’Élégie pour alto solo, qui se joue entièrement en sourdine, pour honorer la mémoire d’Alphonse Onnou le fondateur du Quatuor Pro Arte. Si Prevost renonce au quatuor Pro Arte, ce n’est pas pour rentrer au pays. Appréciant particulièrement le mode de vie de la société américaine, il a été rejoint par sa famille en 1945 et il retrouve Laurent Halleux à Hollywood. Engagé comme musicien dans les studios de la Metro Goldwyn Mayer, il s’installe à Eagle Rock, un faubourg de Los Angeles, où il se lie d’amitié avec le pianiste André Previn, émigré juif allemand, qui fait carrière à Hollywood, puis comme chef d’orchestre et compositeur. Membre du New Art String Quartet (fin des années 1940), alto dans le San Francisco Symphony Orchestra (1960-1963), Prevost tient la partition de premier alto à l’Orchestre d’Oakland, et donne quelques récitals avec Previn, à San Francisco, avant de s’éteindre, loin de Tournai, à 96 ans.
Sources
Anne VAN MALDEREN, Historique et réception des diverses formations Pro Arte (1912-1947) : apport au répertoire de la musique contemporaine, thèse, Louvain-la-Neuve, 2012, p. 518
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, en particulier Le Jour Verviers du 2 mai 2014, La Libre Culture du 21 mai 2014
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 394
http://proartequartet.org/about.html (s.v. mai 2016)
Anne VAN MALDEREN, Le quatuor Pro Arte (1912-1947), dans Revue de la Société liégeoise de musicologie, Liège, 2002, n°19, p. 25-45 sur http://popups.ulg.ac.be/1371-6735/index.php?id=480&file=1 (s.v. mai 2016)
Eric Walter WHITE, Stravinsky : A critical Survey 1882-1946, Toronto, 1997, p. 180

Plomteux Clément
Culture, Edition
Liège 20/04/1737, Liège 1792 (supposé)
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le secteur de l’imprimerie est un secteur prospère de l’économie des provinces wallonnes, singulièrement en principauté de Liège et dans le duché de Bouillon. Profitant du statut particulier de ces contrées, des maîtres-imprimeurs y publient des ouvrages condamnés dans d’autres pays, y contournent la censure ecclésiastique ou, au contraire, éditent des libelles de catholiques opposés aux réformes de l’empereur d’Autriche. Il est aussi des imprimeurs, moins scrupuleux encore, qui n’hésitent pas à reproduire les succès du moment sans disposer des droits, en toute impunité, puisque les privilèges protégeant les livres français, par exemple, ne concernent pas les terres wallonnes. À la veille de la Révolution de 1789, le secteur de la « réimpression » se porte par conséquent très bien et, parmi les imprimeurs et éditeurs wallons de renommée européenne – comme Bassompierre ou Boubers –, figure l’atelier de Clément Plomteux. Comme l’a bien montré Daniel Droixhe, c’est cet atelier que représente si finement le peintre Léonard Defrance, au début des années 1780, dans ses « visites de l’imprimerie ».
Par son mariage, en 1766, avec Marie-Elisabeth Kints (1740-1790), la fille du libraire-bibliothécaire Everard Kints, Clément Plomteux fait son entrée dans le monde de l’imprimerie liégeoise au milieu du XVIIIe siècle. L’entreprise de Kints est déjà prospère quand Plomteux en reprend la direction (1767). Puissant imprimeur officiel des États de Liège, il dispose, depuis 1764, du privilège d’imprimer tous les ouvrages religieux à l’usage du diocèse de Liège ; il est aussi le bibliothécaire de la cité de Liège (1766-1792). Parallèlement à ce statut enviable, Plomteux n’hésite pas à utiliser ses presses pour des publications nettement plus profanes. Imprimeur des œuvres de Voltaire en 30 volumes (1771-1777), des écrits d’Helvétius (4 volumes, 1776) ou de la Révolution de l’Amérique de Raynal (1781), Plomteux ne recule pas devant les grands projets éditoriaux : à partir de 1777, avec d’autres imprimeurs européens, il entreprend la publication du Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique et diplomatique de Jean-Baptiste Robinet. Au début des années 1780, Plomteux rejoint le libraire-philosophe lillois Charles-Joseph Panckoucke dans son ambitieux projet d’Encyclopédie méthodique ; en l’occurrence, il s’agissait de compléter et d’améliorer l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. À cette œuvre gigantesque et financièrement aventureuse, qui s’étendra jusqu’en 1832, Plomteux apporte sa contribution de 1782 à 1788.
Imprimeur des mandements épiscopaux, Plomteux a fait fortune en exportant vers l’Espagne de nombreux livres d’église, tout en offrant sur le marché européen un choix judicieux de livres philosophiques, mais aussi antiphilosophiques, et en n’hésitant pas à se livrer à la contrefaçon. Il n’est pas rare en effet de rencontrer des ouvrages de cette époque, indiquant Genève, Londres, Cologne ou Paris comme lieux d’édition, alors qu’ils ont été réalisés à Liège, sur les nombreuses presses qu’il y possède.
Lié à la franc-maçonnerie – il occupe l’un des rangs les plus élevés de la loge de la Parfaite Intelligence, apparue vers 1770 –, Clément Plomteux a continué d’entretenir avec le prince-évêque Hoensbroeck les bonnes relations qu’il avait nouées avec son prédécesseur Velbrück ; celui-ci en avait fait l’un de ses proches conseillers. De 1787 à 1788, Plomteux est choisi pour exercer l’une des deux fonctions de bourgmestre de la cité de Liège. Il est ainsi l’un des tout derniers magistrats de l’Ancien Régime, dont il ne conteste guère le fonctionnement ; opposé aux réformes, il est notamment l’une des parties intéressées au bon fonctionnement des Jeux de Spa. En 1792, on perd complètement sa trace.
Sources
Henri FRANCOTTE, La propagande des encyclopédistes français au pays de Liège (1750-1790), Bruxelles, 1880, p. 96-97, 182-183
La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. II, p. 82
Daniel DROIXHE, Une histoire des Lumières au pays de Liège. Livre, idées, société, Liège, Cefal-éd. ULg, 2007, p. 91-300
Joseph BRASSINNE, L’imprimerie à Liège jusqu’à la fin de l’ancien régime, dans Histoire du livre et de l’imprimerie en Belgique, des origines à nos jours, Bruxelles, Musée du livre, 1929, V, p. 35 et ssv.
Michel HANNOTTE (dir.), Journaux et journalistes liégeois au temps de l’Heureuse Révolution, catalogue de l’exposition La Plume et le Plomb, Liège, 1989, p. 60-
Eugène DE SEYN, Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des arts en Belgique, Bruxelles, 1935, t. II, p. 828
Joseph BRASSINNE, L’imprimerie à Liège jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, dans L’Histoire du livre et de l’imprimerie en Belgique, Bruxelles, Musée du livre, 1929, p. 35-37
Maurice DES OMBIAUX, dans La Meuse, 21 février 1902
Jacques LIÉNARD, Autour d’une relation inédite des journées révolutionnaires des 16, 17 et 18 août 1789, dans Le Vieux Liège, janvier-mars 1995, n°268, p. 251-264
Daniel DROIXHE, Deux chansons relatives à des imprimeries liégeoises du XVIIIe siècle, dans Bulletin de la Société Le Vieux-Liège, 1995, n°268, p. 245
http://gw.geneanet.org/olisein?lang=fr&pz=olivier+jean+pierre&nz=lisein&ocz=0&p=clement&n=plomteux (s.v. mai 2016)

Piron Louis-Marie
Socio-économique, Entreprise
Opont 15/02/1956
En décernant le prix 2014 de Manager de l’Année à Louis-Marie Piron, le magazine Trends Tendance salue une success story bien ancrée dans le paysage wallon et qui a également pris une dimension internationale, et met en évidence le parcours d’un self made man, gradué en sylviculture devenu administrateur-délégué d’une holding familiale prospère. Se présentant, en 2015, comme le n°1 dans la construction de maisons clé sur porte en Wallonie, ainsi qu’au grand-duché de Luxembourg, la SPRL Thomas & Piron est en effet une société familiale, créée en 1976, et qui a grandi de façon fulgurante.
À l’origine, en 1974, Charles Thomas est un maçon professionnel qui aide le jeune Louis-Marie Piron à rénover une ancienne maison familiale ; deux ans plus tard, ils s’associent au sein d’une SPRL qui limite ses activités au cœur du Luxembourg (10 février 1976) ; aux deux fondateurs s’adjoint un nombre de plus en plus considérable de collaborateurs : ils sont 500 vingt ans plus tard pour faire face aux demandes émanant de tout le Luxembourg – la province mais aussi le grand-duché –, ainsi que du Brabant wallon ; ce chiffre triplera au terme d’une nouvelle période de vingt ans.
En 1981, fraîchement diplômé ingénieur civil, le frère de Louis-Marie Piron rejoint la SPRL dont le siège historique demeure à Our (Paliseul) : Bernard Piron prend en main le contrôle de la gestion d’activités déjà fructueuses. Informatisant les services dès le milieu des années 1980, il contribue à la transformation de la SPRL en société anonyme, en 1988, moment où est présentée la première d’une série de maisons témoins ; de la rénovation, T&P évolue vers la maison unifamiliale, « sur-mesure » et « clé sur porte ». Avec un chiffre d’affaires qui dépassent les 25 millions d’€, Thomas&Piron diversifie et professionnalise ses départements (1992). En 1995, après une aide à l’investissement de la Région wallonne, le plan « cap 2002 » fixe les objectifs. « TP Rénovation » voit le jour (1996), tandis que T&P est certifiée ISO 9001 (1997), et s’ouvre à l’international avec « TP International » (1999) : l’Europe et l’Afrique contribuent à l’expansion de T&P qui construit 500 maisons sur la seule année 2003 et dépasse les 100 millions d’€ de chiffres d’affaires. En 1999, se met en place « Thomas et Piron Finances » pour placer sous un même pavillon un ensemble d’activités fort diversifiées ; même si Charles Thomas a quitté l’actionnariat depuis longtemps, la société conserve sa dénomination originelle et un ancrage familial.
Des immeubles à appartements, des bâtiments à usage commercial, administratif ou industriel s’ajoutent notamment à un carnet de commandes qui s’étendent à l’ensemble de la Wallonie. Prix spécial du jury « Entreprise la plus performante » depuis la création du trophée Entreprise de l’Année (2005), Thomas & Piron se singularise encore sur un marché difficile en inaugurant un « centre de compétences » (2007), en construisant le tout premier bâtiment de bureaux passif de Wallonie (2008), en mettant l’accent sur des produits accessibles et peu énergivores, voire en dépassant le cap des 1.000 logements construits sur la seule année 2010. En 2013 et 2014, après le rachat de la société française Castelord, l’entreprise de construction wallonne se transforme profondément ; cinq entités juridiques distinctes sont constituées et chapeautées par « Thomas & Piron Holding » ; le nouveau siège de « Thomas & Piron Bâtiment » s’ouvre à Wierde, tandis que le « home » reste à Paliseul, et que la « Rénovation » siège à Maissin.
Au-delà de son activité à la tête de T&P, Louis-Marie Piron s’est associé dans les années 1990 à un groupe d’hommes d’affaires qui investissent dans des projets novateurs. Par ailleurs, il contribue aussi au maintien d’activités de proximité et de qualité, dans la région de Paliseul, dans le secteur Horeca, tout en aidant de jeunes talents wallons.
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
Sébastien LAMBOTTE, dans WAW, http://www.wawmagazine.be/fr/louis-marie-piron-le-constructeur-gastronome
http://www.thomas-piron.eu/fr/groupe-thomas-piron/historique
http://www.tvlux.be/video/louis-marie-piron-co-fondateur-de-thomas-et-piron_12110.html (s.v. mai 2016)

Parisse Jacques
Culture, Journalisme
Seraing 30/09/1934, Liège 19/01/2011
Critique d’art, historien et biographe, Jacques Parisse a exercé une influence considérable sur le monde des arts plastiques pendant plus de trente ans. Professeur de français puis d’histoire de l’art, il transforme sa passion pour l’art en une activité débordante, comme critique d’abord, comme biographe ensuite, faisant découvrir ou redécouvrir, non sans passion, plusieurs artistes wallons de renom.
Après s’être brièvement essayé au Droit, Jacques Parisse s’oriente vers les Romanes et décroche sa licence à l’Université de Liège (1956). À peine diplômé, il entame une carrière d’enseignant qu’il mènera pendant 35 ans (novembre 1959-juin 1994). Dans un premier temps, il est professeur de français dans l’enseignement secondaire supérieur. À sa passion première pour la lecture, il ajoute une curiosité toujours plus grande pour les beaux-arts. En 1953, il était entré pour la première fois dans la galerie de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie et c’est là qu’il va découvrir les artistes invités par Fernand Graindorge et Marcel Florkin. Dans les revues étudiantes auxquelles il avait collaboré, il avait signé quelques papiers sur ces expositions. En janvier 1961, il reçoit, d’André Renard, la chance de tenir une rubrique à la fois dans La Wallonie et dans Combat. Usant d’abord du pseudonyme « Un de Troie » avant de recourir à son patronyme, le successeur de Frenay-Cid restera le chroniqueur artistique (livres et expositions) du quotidien jusqu’en novembre 1986, soit 26 saisons et plusieurs milliers de chroniques. « Victime d’une restructuration économique », il est ensuite accueilli par La Dernière Heure (1987-1993), puis par La Meuse (1993-1998).
Parallèlement, engagé par Robert Stéphane, il devient chroniqueur sur les ondes de la RTB-Liège radio à partir de janvier 1964. Jusqu’en janvier 2000, son intervention dans le décrochage matinal du Centre de production régional de Liège de la RTBf est un moment craint ou attendu, comme le sont ses articles de presse écrite, pour tous les créateurs ou organisateurs d’événements artistiques. Un avis de Jacques Parisse avait valeur de succès ou de Bérézina. Depuis le début des années soixante, encore, Jacques Parisse a ajouté à ses multiples tâches celle du secrétariat de l’APIAW. Officiel bras droit de Graindorge et de Florkin, Parisse était par conséquent en contact permanent avec tous les acteurs culturels. À une grande maîtrise de tous les courants artistiques « anciens », il ajoutait une connaissance de la création et des nouvelles influences qui se nourrissait des milliers de visites qu’il rendait aux peintres, graveurs, photographes, en exposition ou dans leur atelier. Cette expérience lui servira de sésame quand lui sont confiés les cours d’histoire de l’Art dans un établissement liégeois d’enseignement supérieur non universitaire, au milieu des années 1970, second temps de sa carrière d’enseignant.
Auteur d’un monumental ouvrage sur La peinture à Liège au XXe siècle (1975), Jacques Parisse signe plusieurs ouvrages qui font référence. Entouré de quelques amis pour sélectionner plusieurs dizaines d’artistes représentant les courants les plus variés, il s’appuie sur une belle maîtrise de la production artistique récente pour mener cette première investigation ambitieuse, complétée par une série de fortes monographies approfondissant ou réhabilitant des peintres wallons : Zabeau (1977), Jean Donnay (1980), Richard Heintz (1982), Auguste Mambour (1984), Auguste Donnay (1991), Gangolf (1991), Édouard Masson (2000), Ernest Marneffe (2001), Guy Horenbach (2007). Il fait aussi connaître Marcel Caron, Georges Collignon, Frédérick Beunckens, Jacques Charlier ou encore Jacques Lizène.
Après avoir rassemblé un certain nombre de ses chroniques RTB Liège en deux volumes, il publiera, en 2000, des mémoires, les siennes, qui sont bien davantage que celles d’un critique de province. Il rappelle notamment qu’en tant que secrétaire de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie depuis le début des années 1960, il a apporté une contribution permanente à l’organisation des expositions de cette association ; il mentionne aussi qu’il fut l’éphémère président fondateur de la Maison des Artistes au milieu des années 1980. Auteur d’articles et de préfaces dans des ouvrages de référence, il fut aussi conseiller artistique pour les acquisitions auprès de la Banque nationale de Belgique de 1981 à 2000, président de la commission des arts plastiques de la Communauté française et membre du conseil d’administration de La Chataigneraie.
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. III, p. 386
Jacques PARISSE, Situation critique. Mémoires d’un critique d’art de province, Liège, Adamm éd., 2000
L’art a la parole : Jacques Parisse, chroniques artistiques à la RTB Liège de 1964 à 1977, Liège, Mardaga, 1978
De bec et de plume, L’art a la parole II, Chroniques des arts plastiques à la RTBf Liège, 1977-1984, Liège, 1985

Moutschen Joseph
Culture, Architecture
Jupille 18/03/1895, Jupille 22/12/1977
Au milieu du XXe siècle, deux frères, Joseph (l’aîné) et Jean Moutschen marquent de leur empreinte l’architecture de la région liégeoise. L’initiale de leur prénom étant identique, il est parfois malaisé de restituer à l’un ou à l’autre sa contribution, d’autant que certains projets les ont réunis. Néanmoins, Joseph, l’aîné, apparaît comme celui qui impose le plus sa signature et influence, par ses fonctions à l’Académie, la formation des futurs architectes.
Entré très jeune à l’Académie des Beaux-Arts de Liège, Joseph Moutschen dessine en journée pour le compte du bureau de l’architecte Arthur Snyers à partir de 1911 et continue de suivre des cours en soirée ; grâce à une bourse et au soutien de l’Union coopérative (socialiste), il prépare aussi les examens d’entrée au génie civil qu’il compte mener à l’Université de Gand ; après plusieurs mois passés à l’Université de Bonn, il se trouve à Gand quand éclate la Grande Guerre. En raison des circonstances, c’est à Liège qu’il est diplômé avec grande distinction par l’Académie, en juin 1917, avant d’être choisi comme répétiteur, et professeur intérimaire (1917-1919). Il s’implique alors dans les discussions autour d’un projet de réforme complète de l’enseignement de l’architecture, déposé avant 1914, et qui est resté en suspens sous l’occupation allemande : nouveau programme, nouveau contenu, nouveau cursus, cours du jour au lieu de cours du soir… En 1920, la réforme est finalement définie et introduite. C’est dans ce cadre nouveau qu’il entre en fonction comme professeur, après avoir suivi à Paris, grâce à une Bourse, les cours de l’École nationale des Beaux-Arts (1919).
Dès le début des années 1920, Moutschen est attiré par les constructions en hauteur ; les gratte-ciels le fascinent ; lors d’un séjour aux États-Unis, il rencontre Franck Lloyd Wright et Cass Gilbert ; par ailleurs, il soutient fortement le manifeste du groupe l’Équerre, dont son frère, Jean, est l’un des initiateurs. Architecte s’inscrivant dans la veine fonctionnaliste, il compte à son actif plusieurs cités d’habitations (Thier à Liège en 1922, cité des Cortils à Jupille entre 1925 et 1935), de même que des monuments (Wauters à Waremme, celui de Grâce-Berleur) ou des bâtiments emblématiques (le siège du journal La Wallonie, des Maisons du Peuple à Montegnée et Herstal). Émanant du secteur public, plusieurs commandes marquent le paysage de l’est wallon : des écoles communales (par ex. rue Saint-Gilles en 1935, à Wandre, à Romsée en 1959), le pont barrage à Monsin (1930) et, au Val Benoît l’Institut de Mécanique (1932) et l’Institut du génie civil (1937), ce dernier reflétant bien l’application des principes chers à Walter Gropius. La contribution de Joseph Moutschen au Mémorial Albert Ier et à la préparation des Palais pour l’Exposition de l’Eau de 1939 est aussi à souligner, de même que l’aérogare 58 à « Bruxelles national » (1954-1958).
Dès 1922, Joseph Moutschen avait été nommé professeur, en charge des cours d’histoire de l’architecture et de l’urbanisme, des cours de théorie architecturale, ainsi que de géométrie descriptive. Il consacre ainsi une partie de sa carrière à l’enseignement ; Georges Dedoyard sera l’un de ses disciples. Entre 1942 et 1945, quand Jacques Ochs est fait prisonnier par les Allemands, Moutschen assure la direction par intérim de l’Académie de Liège. De 1948 à 1960, il devient le directeur effectif de l’Académie et de l’Institut supérieur d’Architecture de Liège, cessant ses activités de professeur en 1959.
Parallèlement, Moutschen milite dans les rangs du POB. En 1921, il est élu conseiller communal à Jupille et devient échevin des Travaux publics, ainsi que de l’Instruction publique à partir de 1926. Membre de l’Association des Architectes de Liège (1923), membre-correspondant de l’Institut archéologique liégeois (1930), de la Société nationale des Habitations à Bon marché et de la Commission centrale de l’Urbanisme (1938), ce proche de Georges Truffaut dont il conçut les plans de la maison figure parmi les membres du Grand Liège (délégué à la Commission d’urbanisme). Résistant au sein du réseau Bayard (1943-1944), arrêté et fait prisonnier, Moutschen est reconnu comme résistant et prisonnier politique.
Après la Seconde Guerre mondiale, celui qui est appelé à siéger dans de nombreux jurys assume à deux reprises la présidence de la Fédération des Architectes de Belgique (1948-1950, 1958-1960) et est membre effectif du Conseil de l’ordre des Architectes de la province de Liège. De nombreux prix et récompenses saluent la carrière d’un architecte fort pris par son enseignement, mais dont les réalisations reflètent la personnalité et les engagements.
Sources
Coline CAPRASSE, Les Moutschen architectes modernistes liégeois, Université de Liège, 2014, mémoire inédit Histoire de l’Art et archéologie
Sébastien CHARLIER et Thomas MOOR, dans Anne VAN LOO (dir.), Dictionnaire de l’architecture en Belgique, de 1830 à nos jours, Bruxelles, Fonds Mercator, 2003, p. 428-429
La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. III, p. 370, 372
Émile PARENT, La réorganisation de l’enseignement de l’architecture, dans L’Equerre, décembre 1933, p. 542
Liège : Guide d’architecture moderne et contemporaine 1895-2014, Liège, Mardaga, 2015, notamment p. 244

Moutschen Jean
Culture, Architecture
Jupille 02/07/1907, Liège 07/01/1965
Au milieu du XXe siècle, deux frères, Joseph (l’aîné) et Jean Moutschen marquent de leur empreinte l’architecture de la région liégeoise. L’initiale de leur prénom étant identique, il est parfois malaisé de restituer à l’un ou à l’autre sa contribution, d’autant que certains projets les ont réunis. Néanmoins, Jean se démarque de son aîné, professeur et directeur de l’Académie de Liège, par ses réalisations en tant qu’architecte de la ville de Liège, notamment le Lycée de Waha, grand bâtiment public construit avec des matériaux régionaux. En 1939, la grande Exposition Internationale de l’Eau donne à Jean Moutschen l’occasion de s’exprimer, sous la conduite d’Yvon Falise : vraie prouesse technique, le grand palais (destiné dès l’origine à devenir une patinoire) porte sa signature. Au début des années 1960, l’Institut Hazinelle porte aussi sa griffe, de même que l’Institut polytechnique.
Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Liège (1923-1931) où son frère est professeur, Jean se destine lui aussi à l’architecture. Jeune diplômé, adepte d’une « architecture rationnelle », il est membre du Groupe l’Équerre, dès 1930, et de son Comité directeur (1931). Parmi les revendications exprimées par Victor Rogister, Jean Moutschen, Émile Parent, Edgard Klutz et autre Albert Tibaux, l’Équerre demande un enseignement où la formation technique et pratique tienne davantage compte des nécessités professionnelle et sociale de l’époque. Rationalité, confort, ensoleillement, hygiène sont des principes prioritaires pour ces architectes ; quant aux matériaux, nouveaux, ils doivent présenter de nombreux avantages, dont celui de l’économie financière.
S’il est marqué par l’esprit de ce groupe, Jean Moutschen s’en démarque cependant quelque peu à partir de 1933, quand il est engagé au sein du Service d’architecture de la ville de Liège, même si l’Équerre a le soutien de Georges Truffaut, l’échevin des Travaux publics, et peut s’exprimer assez librement à Liège. Les architectes du Groupe sont identifiés parmi les « modernistes belges » de leur temps. En 1936, grâce au soutien de Georges Truffaut qui cherche à donner un nouveau souffle à la ville de Liège, Jean Moutschen est nommé « architecte de la ville » par le conseil communal (deux tiers des voix) ; il cesse alors totalement ses activités en tant qu’indépendant pour se consacrer exclusivement aux grands chantiers communaux ; inaugurée en 1937, l’école communale André Bensberg, dans le quartier Saint-Gilles, à Liège, est considérée comme la première œuvre significative de Jean Moutschen ; en 1951, il est nommé architecte-directeur. Après la Libération, il siègera à Commission des Monuments et des Sites (1949), sera membre effectif de l’Association des Architectes de Liège (1962), et membre de jury de nombreux concours.
Sources
Émile PARENT, La réorganisation de l’enseignement de l’architecture, dans L’Equerre, décembre 1933, p. 542
Coline CAPRASSE, Les Moutschen architectes modernistes liégeois, Université de Liège, 2014, mémoire inédit Histoire de l’Art et archéologie
Sébastien CHARLIER et Thomas MOOR, dans Anne VAN LOO (dir.), Dictionnaire de l’architecture en Belgique, de 1830 à nos jours, Bruxelles, Fonds Mercator, 2003, p. 428-429
La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. III, p. 370, 372
Liège : Guide d’architecture moderne et contemporaine 1895-2014, Liège, Mardaga, 2015, notamment p. 244
L’Équerre. Réédition intégrale, 1928-1939, Liège, 2012

Moureau Paul
Culture, Lettres wallonnes, Littérature
Jodoigne 01/06/1887, Louvain 17/11/1939
Entre Jodoigne, sa ville natale, et Châtelet, sa ville d’adoption, Paul Moureau établit une étonnante fusion, certes par passion pour le dessin et l’écriture, mais aussi parce qu’il nourrit le projet d’illustrer et de défendre la langue wallonne, objectifs que s’est fixés le cercle des Rèlîs namurwès. La collaboration de Paul Moureau avec Eugène Gillain, le père de JiJé, le futur dessinateur de bandes dessinées, donnera par ailleurs naissance à la première série éditoriale de la revue des Cahiers wallons.
Diplômé de l’École moyenne de Nivelles (1909), instituteur à l’École moyenne de l’État de Châtelet à partir de 1912, Paul Moureau s’établit dans cette localité peu avant la Grande Guerre. Il s’y investira dans la vie culturelle locale (vice-président du Club artistique La Sambre, membre des Amis de Châtelet, président du comité de commémoration du centenaire d’Octave Pirmez), en étudiera l’histoire et le folklore (plusieurs articles paraissent dans les journaux et revues du pays de Charleroi) et sera un membre actif du Comité de restauration de la Chapelle Saint-Roch.
En 1924, il suit une formation complémentaire, en passant l’examen devant le Jury central, qui lui permet de devenir professeur de dessin et de travail manuel, toujours à l’École moyenne de Châtelet. À cette passion tardive, le dessin, il en ajoute une seconde, l’écriture. C’est à ce moment-là, vers 1927, que Moureau rencontre Eugène Gillain qui vient d’emménager à Châtelet. Les deux hommes deviennent des amis inséparables.
Comme Gillain, Moureau admire Edmond Étienne, et il rédige justement une biographie à son sujet. Il l’illustre de ses dessins réalisés à la plume et qui sont autant de vues de Jodoigne et de souvenirs d’enfance. Par l’intermédiaire d’un Gillain insistant, Moureau est reçu comme membre du cercle des Rèlîs namurwès, association consacrée à l’illustration et à la défense de la langue wallonne… Moureau s’essaye en effet au wallon de Jodoigne et il est un membre assidu des réunions des Rèlis. Le résultat de sa production wallonne est convainquant : rassemblés dans un recueil lui aussi richement illustré en noir et blanc, ses premiers contes et poèmes paraissent en 1932 (Lès contes d’a-prandjêre), préfacés par Jean Haust. Son écriture s’affirme de plus en plus et, en 1936, Fleûrs d’al Vièspréye (Fleurs du crépuscule) est accueilli avec beaucoup de faveur ; le Prix du Brabant 1936 est décerné à ce recueil de poèmes dédiés à sa mère, qui comprend six gravures de Joseph Gillain. Par ailleurs, il se lance dans une pièce de théâtre en vers (Pa d’zos l’tiyou, Sous le tilleul, créée en 1933 et publiée en 1934), plus littéraire que dramatique, très bien accueillie. Li drwète vôye (1935) et Djan Burdou (1939) n’auront pas le même succès.
Avec Eugène Gillain, Paul Moureau relève encore le défi de donner naissance à la revue Cahiers wallons (1937-1939). Le premier numéro de l’organe des Rèlîs namurwès s’ouvre d’ailleurs sur une fable de Paul Moureau ; de cette revue, ils voulaient faire une sorte d’anthologie des meilleurs textes en wallon, chaque numéro couvrant une région. L’ambition première ne sera que partiellement rencontrée. En février 1938, témoignage de la place qu’il occupe désormais dans la littérature wallonne, Paul Moureau est élu membre titulaire de la Société de Littérature wallonne. Il ne profitera guère de cette reconnaissance, emporté par la maladie un an plus tard.
Sources
La Vie wallonne, 15 décembre 1939, CCXXXI, p. 127-128
Jacques TOUSSAINT et Joseph DEWEZ (dir.), Les Cahiers wallons ont 75 ans. Les Rèlîs namurwès au service de l’identité wallonne, Namur, 2012, p. 20-31, 35-52, 86-88
Maurice PIRON, Anthologie de la littérature dialectale de Wallonie, poètes et prosateurs, Liège (Mardaga), 1979, p. 434-436
Émile Lempereur, À Paul Moureau (Jodoigne 1887 – Louvain 1939) écrivain, artiste-peintre, animateur de la vie culturelle, professeur. Hommage de Châtelet sa ville adoptive 1912-1939, Châtelet, éd. Cercle d’art et de littérature du Canton de Châtelet, 1967
J-J. Gaziaux, Paul Moureau, dans Wallonnes, 4, 1994
Les Cahiers wallons, n° spécial Paul Moureau, n°30, janvier 1940
La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. III, p. 227
Œuvres principales
Une belle figure wallonne : Edmond Étienne, sa vie, son œuvre, 1930
Une petite sainte de chez nous : Sainte Ragenufle d’Incourt, 1936
La Marche Saint Eloi à Châtelet, s.d.
Poésie
Lès contes d’a-prandjêre, 1932
Fleûrs d’al Vièspréye, 1936
Les gayes d’a Batisse de l’Abîye, 1936
E sûvant li stwèle, 1936
Théâtre
Pa d’zos l’tiyou, 1934
Li drwète vôye, 1935
Djan Burdou, 1939
Jeu dramatique de ND de Soûye, inédit

Moremans Victor
Culture, Journalisme
Saint-Nicolas-lez-Liège 01/04/1890, Liège 17/12/1973
C’est au lendemain de la Grande Guerre que Victor Moremans entre comme journaliste à la Gazette de Liège et y accomplit la totalité de sa carrière. Cette Grande Guerre est le facteur qui détermine sa destinée. En effet, après des humanités chez les Jésuites du collège Saint-Servais, le jeune Liégeois s’est orienté vers le monde de l’industrie et des sciences en obtenant un diplôme d’ingénieur à l’Institut Gramme ; quand l’armée allemande franchit la frontière et s’attaque à la cité liégeoise, en âge de mobilisation, Moremans participe aux combats contre l’envahisseur. Après le siège d’Anvers, il est fait prisonnier de guerre. De novembre 1914 à novembre 1918, il est interné au camp d’Alten-Grabow et ne rentre au pays qu’après un séjour de soins en Suisse. Dès ce moment, il a choisi de se destiner au journalisme.
Après avoir proposé ses services à des revues et des gazettes, il finit par être engagé comme rédacteur stagiaire à la Gazette de Liège, en même temps que Georges Simenon. Il y accomplira toute sa carrière. S’intéressant à la politique communale de 1923 à 1938, il se charge du feuilleton littéraire hebdomadaire, avant de se révéler en critique apprécié. Chargé de la page littéraire, « il se livre, avec un égal bonheur, à la critique d’art et de musique, et s’intéressera activement au théâtre » (LINZE). Sa curiosité, sa finesse d’analyse et son ouverture d’esprit le font apprécier des milieux intellectuels de son temps avec lesquels il échange une abondante correspondance et noue des liens d’amitié : Francis Jammes, Max Jacob, Henry de Montherlant, Georges Bernanos, André Billy, Henry Bordeaux, Jean Cassou, Jacques Chaban-Delmas, Henry Poulaille, Colette, Jacques Copeau, Tristan Derême, André Gide, Yvette Guilbert, le maréchal Lyautey, Maurice Maeterlinck, Marcel Arland et son ami Georges Simenon.
Auteur de trois essais et de trois traductions de romans du Hongrois Làszló Dormandi, il est surtout le rédacteur de deux mille cinq cents articles parus dans la presse quotidienne, de 1923 à 1940 et de 1944 à 1973, puisque, sous la seconde occupation allemande, il a fait partie des journalistes qui brisèrent leur plume. Au-delà de la quantité, il y a une qualité particulière dans la critique militante de Moremans. Ami des peintres liégeois Richard Heintz, Robert Crommelynck, Jean Donnay, Joseph Verhaeghe, révélateur perspicace du talent de Nathalie Sarraute à ses débuts littéraires (Tropismes, 1939), le découvreur de pépites qu’était Victor Moremans a élargi l’horizon artistique des lecteurs wallons à la production internationale. Membre du comité des Beaux-Arts de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie (dès 1945), il fait partie du comité général du deuxième Congrès culturel wallon (Liège, 1955), et se charge, à cette occasion, du rapport de la section qui traite de La situation du théâtre en Wallonie. Membre de la commission des Arts et des Lettres de la province de Liège, il présidera aussi la commission du théâtre du centre culturel wallon (1956) et sera vice-président de l’Association générale de la Presse belge.
Son influence est incontestable sur l’ouverture du théâtre liégeois à d’autres compagnies, notamment françaises. Membre du Conseil national de l’Art dramatique d’expression française (1953-1973), il peut être considéré comme l’un des pères du Festival du Jeune Théâtre de Liège qui, pendant vingt ans, à partir de 1958, s’est ouvert aux formes du théâtre contemporain.
Sources
Jacques-Gérard LINZE, Victor Moremans, un demi-siècle de littérature, communication à l’Académie de Langue et de Littérature françaises de Belgique, 10 octobre 1992, http://www.arllfb.be/ebibliotheque/communications/linze101092.pdf
La Vie wallonne, I, 1974, n°345, p. 44
Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 1121
Jacques PARISSE, Situation critique. Mémoires d’un critique d’art de province, Liège, Adamm éd., 2000, p. 127
Œuvres principales
Trois essais
Les poètes du prix Verhaeren, 1930
Pyramides et gratte-ciel, 1951
Léopold Levaux et son œuvre d’écrivain, 1956
Trois traductions de romans du Hongrois Làszló Dormandi
La fée maléfique, 1944
Fièvre tropicale, 1944
Deux hommes sans importance, 1945
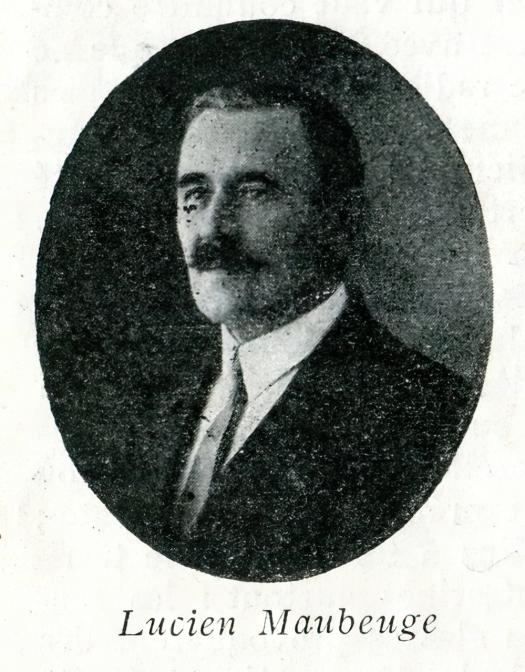 © Sofam
© Sofam
Maubeuge Lucien
Culture, Lettres wallonnes
Avernas-le-Bauduin 08/04/1878, Seraing 31/08/1968
Bien que ses premiers écrits datent du début du siècle, c’est tardivement que Lucien Maubeuge signe sa meilleure œuvre, avec Lès djins dèl basse classe (1939). Fort apprécié par ses contemporains, le dramaturge donne ainsi au théâtre wallon de Liège une de ses meilleures pièces de l’Entre-deux-Guerres. S’il était aussi poète, Lucien Maubeuge ne consacrait que ses loisirs à l’écriture, même si son activité de machiniste dans un charbonnage lui permettait de donner libre cours à son imagination.
Toute son existence, Lucien Maubeuge restera partagé entre sa Hesbaye natale, patrie maternelle, et la ville industrielle de Seraing où son père, un Ardennais, installa la famille : ayant abandonné la gendarmerie, ce dernier y exerce comme cordonnier. Au terme de l’école primaire, Lucien Maubeuge est rapidement plongé dans le monde du travail : les cristalleries du Val Saint-Lambert d’abord comme apprenti tailleur de cristaux (1891-1894), la mine de Marihaye et le charbonnage du Thier Polet ensuite, à Seraing ; hiercheur, il exercera ensuite toute sa vie la fonction de machiniste.
Trouvant à s’évader dans l’écriture, il compose des chansons poétiques en wallon qui sont remarquées dès les premières années du XXe siècle. Encouragé par Théophile Bovy et Édouard Plenus, Maubeuge connaît un succès certain avec plusieurs recueils en wallon publiés avant la Grande Guerre, et inspirés à la fois par le travail de la mine et les paysages de Hesbaye. Plusieurs revues et gazettes se disputent la publication de ses textes, dont son sonnet Li Mouhagne (La Mehaigne), ainsi que la très appréciée chanson Li Niyêye (La nichée).
D’autre part, le discret Maubeuge rencontre une réelle reconnaissance populaire quand il se met à l’écriture de pièces de théâtre, elles aussi en wallon. Mêlant drôlerie et observations psychologiques des travers de ses contemporains, parfois anonymes, parfois clairement identifiés, les pièces de Maubeuge sont des tableaux des mœurs populaires ou de plaisants croquis villageois qui sont fort attendus depuis Li musique d’à Dj’han-Noyé (1910) ; régulièrement, elles sont à l’affiche du Théâtre communal wallon de Liège. Mais Maubeuge se fait plus rare après la Grande Guerre. Peut-être pour concentrer dans une seule pièce le meilleur de son talent : Lès djins dèl basse classe, créée au Trianon en 1939, est saluée de toutes parts. Récompensée par le prix biennal de Littérature wallonne de la ville de Liège (décembre 1939), cette pièce consacre le retour du théâtre wallon à la tradition de la seule évocation de la vie du terroir. En 1924, le prix Jean Lamoureux lui avait déjà été décerné et en 1930, la section liégeoise de la Société des Arts wallons lui avait consacré une séance d’hommage spéciale, à l’hôtel de ville de Seraing, sous les auspices de Joseph Merlot.
Sources
Oscar PECQUEUR, dans La Vie wallonne, LXI, 15 juillet 1925, p. 443-445
La Vie wallonne CXV, mars 1930, p. 253-254 ; CCXXXII, 15 janvier 1940, p. 149-154
Œuvres principales
Violètes èt Pinsêyes, 1904 (poésie)
So Tchamps so Vôyes... Poésèyes wallones, 1906 (poésie)
Béguinette è Sizet, 1908
Feumes al pompe (Femmes au puits), 1908
Tchansons di m’vyèdje, 1909 (poésie)
Li Discandje
Li musique d’à Dj’han-Noyé, 1910
Moncheû Grignac, 1911
Lès feumes de cazêre, 1912
Bèguinète èt Sizèt
Li Marchâ dè Trô-Botin
Li Discandje, 1924
Lon dé pays, 1924
Pasquêyes èt rîmès, 1924 (poésie)
Les Coqs, 1926
Li Pansa, 1928
Lès djins dèl basse classe, 1939
