

Gendebien Alexandre Jr
Révolutions, Socio-économique, Entreprise
Bruxelles 11/10/1812, Charleroi 22/02/1865
Alexandre Gendebien ne doit pas être confondu avec son père qui porte le même prénom (1789-1869), l’actif révolutionnaire des Journées de Septembre 1830 et défenseur d’une Belgique conservant tout le Limbourg et tout le Luxembourg. Le jeune Alexandre, troisième de la dynastie des Gendebien fondée par Jean François (1753-1838), est davantage tourné vers l’industrie, à l’instar de son grand-père et de son oncle, Jean Baptiste (1791-1865).
Le jeune Alexandre n’a pas dix-huit ans quand il est mêlé aux Journées de Septembre 1830. Son impétuosité suscite la crainte de ses proches ; capitaine d’artillerie, il se distingue par sa conduite à l’armée de la Meuse et pendant la retraite d’Hasselt, le 8 août 1831. Par conséquent, celui qui fut décoré de la Croix de fer peut ajouter son nom à ceux de sa famille dans l’établissement du nouveau royaume de Belgique. Il s’écarte cependant du sillon paternel pour se consacrer totalement à des activités industrielles.
Directeur des concessions du Mambourg et de Belle-Vue, dans le pays de Charleroi (1837), responsable des Charbonnages de Piéton, il devient le directeur-gérant des Charbonnages réunis de Char¬leroi (1er janvier 1851), soit des anciennes sociétés charbonnières de Mambourg et Bawette, Belle-Vue, Sablonnière, Lodelinsart et Sacré-Français. Avec le soutien de la Société générale, toutes les exploitations des Gendebien sont rassemblées au sein de la « Société anonyme des Charbonnages réunis, à Charleroi » (juin 1851), qui, avec un capital de près de 7 millions de francs de l’époque, constitue l’une des plus grandes fusions de la région.
En tant que membre (1843) de la Chambre de commerce de Charleroi, il s’intéresse particulièrement à la question des péages sur les canaux, les rivières et le chemin de fer de l’État (1848-1849) ; il publie une étude à ce sujet et interpelle les autorités belges à diverses reprises. Par ailleurs, à titre personnel, il n’hésite pas à investir dans la construction de chaussées ou de lignes ferroviaires.
Devenu vice-président de la Chambre de commerce de Charleroi (1860-1865) et membre du Conseil supérieur de l’Industrie, Alexandre Gendebien s’est aussi occupé de l’Asso¬ciation charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre : fondé en 1832, ce syndic de patrons charbonniers entre en crise à l’entame des années 1850, au moment où ses statuts sont révisés. Secrétaire puis président (1850-1852), Gendebien démissionne de la présidence et jusqu’en 1863, l’association fonctionne en mode provisoire ; c’est dans ces conditions qu’elle examine le dossier de ses propres statuts, ainsi que des questions aussi importantes que la loi sur le travail des enfants (1859) ou le projet de traité de commerce avec la France (1860). Finalement, fin 1863, l’Association est reconstituée et Gendebien la préside jusqu’à son décès (1863-1865).
Sans jamais s’être mêlé de politique, Alexandre Gendebien ne cachait pas ses sentiments républicains ; par ailleurs, après s’être montré favorable au mouvement catholique en politique, réclamant des candidats se revendiquant des thèses cléricales (manifeste du Mambour), il est devenu libre-penseur et a exigé que son enterrement soit purement civil.
Sources
Journal de Charleroi, 1851-1853 ; Le Bien Public, 24 février 1865 ; Journal de Bruxelles, 27 février 1865 ; Indépendance belge, 3 mars 1865 ; Gazette de Charleroi, 12 décembre 1893, p. 2
Jules GARSOU, Alexandre Gendebien. Sa vie. Ses mémoires, Bruxelles, René Van Sulper, 1930
Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 304-306
La Wallonie. Le Pays et les hommes (Economies, Sociétés), t. II, p. 30, 37, 57

Gendebien Jean Baptiste
Socio-économique, Entreprise
Mons 17/05/1791, Bruxelles 07/08/1865
Second fils de Jean François Gendebien (1753-1838), Jean Baptiste a poursuivi les activités industrielles de son père, tandis que son frère aîné, Alexandre (1789-1869), s’est consacré davantage à la politique.
Né à Mons en pleine première restauration autrichienne, Jean Baptiste Gendebien mène d’abord une carrière d’officier. Son père, intendant de la famille des d’Arenberg, lui ouvre la porte : en 1804, Jean Baptiste est officier dans le régiment d’Arenberg et, en 1815, il fait partie du 27e chasseurs à cheval. Initié aux affaires commerciales et financières par son père qui est propriétaire, en 1817, d’une douzaine de mines dans le Namurois et les bassins de Charleroi, du Centre et du Borinage, il se destine à gérer les avoirs familiaux ; dès 1822, il reçoit la propriété et la direction du charbonnage du Gouffre à Châtelineau. Un mariage avec la fille d’une famille de banquiers montois, les Hennekinne-Briard (1824) favorise le développement de ses activités. Ouvert aux innovations techniques, il n’hésite pas à prendre en charge la construction de nouvelles voies de communication (comme la route de Châtelineau à Farciennes).
S’il ne partage pas le même intérêt que son père et son frère à l’égard de la politique, et s’il ne monte pas aux barricades lors des Journées de Septembre 1830, Jean Baptiste Gendebien se laisse cependant élire, en novembre 1830, dans l’arrondissement de Charleroi. Au Congrès national (1830-1831), il siège par conséquent aux côtés de son père et de son frère, et s’il prend part à une série de votes, il ne monte guère à la tribune.
Davantage attiré par le monde de l’industrie et de la finance, Jean Baptiste rachète la totalité des parts d’Alexandre dans les entreprises familiales, ainsi que celles de ses sœurs (1831) ; il se retrouve ainsi à la tête d’un nombre impressionnant d’exploitations. En 1835, le charbonnage de Châtelineau constitue sa part dans la constitution, avec la Société générale, de la SA des Hauts Fourneaux, Usines et Charbonnages de Châtelineau, où l’on retrouve aussi notamment John Cockerill et Gustave Pastor. En juin 1851, avec le soutien de la Société générale, toutes les exploitations des Gendebien dans le pays de Charleroi sont rassemblées au sein de la « Société anonyme des Charbonnages réunis, à Charleroi », qui, avec un capital de près de 7 millions de francs de l’époque, constitue l’une des plus grandes fusions de la région (sont ainsi réunies les anciennes sociétés charbonnières de Mambourg et Bawette, Belle-Vue, Sablonnière, Lodelinsart et Sacré-Français).
Administrateur de cette société, Jean-Baptiste Gendebien l’est également des Charbonnages d’Oignies-Aiseau, des Char¬bonnages belges, des Charbonnages d’Agrappe et Grisoeuil. Installé d’abord à Farciennes, puis à Bruxelles rue Neuve, il diversifie ses activités en étant également partie prenante dans le Chemin de Fer de Dendre et Waes, la Sucrerie de Farciennes et de Tergnée, dans des Moulins bruxellois, les Galeries Saint-Hubert à Bruxelles ou dans le secteur du bois. Il préside aussi quelques années la Chambre de commerce de l’arrondissement de Charleroi.
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
Jules GARSOU, Alexandre Gendebien. Sa vie. Ses mémoires, Bruxelles, René Van Sulper, 1930
Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 304-306
Gendebien Alexandre
Politique
Mons 04/05/1789, Bruxelles 06/12/1869
Le nom d’Alexandre Gendebien est étroitement lié aux Journées de Septembre 1830. Avocat inscrit au barreau de Bruxelles (1811), jurisconsulte, opposant de Guillaume d’Orange et partisan d’une union des catholiques et des libéraux, ce Montois prend d’ailleurs une part active dans les événements qui donnent naissance à la Belgique, d’août 1830 à juillet 1831. Rêvant d’une réunion à la France depuis la Révolution de Juillet, partisan d’une formule de séparation administrative lorsqu’il rencontre Guillaume d’Orange en tant que représentant des provinces du sud (fin août), il se rallie à la formule de l’indépendance à partir du 26 septembre, au moment où il devient l’un des ministres du gouvernement belge provisoire, avec Charles Rogier, Sylvain Van de Weyer et Emmanuel d’Hooghvorst. À plusieurs reprises, il est envoyé en mission à Paris pour négocier le nouveau statut de la Belgique, sans obtenir le résultat qu’il espérait.
Président du Comité Justice, Alexandre Gendebien est élu pour le Congrès tant par les électeurs de Bruxelles que par ceux de Mons (3 novembre). Celui qui a étudié à Tournai et à Bruxelles choisit les suffrages de Mons, sa ville natale, et retrouve au Parlement tant son père Jean-François, élu de Soignies, que son frère Jean-Baptiste, élu de Charleroi, et son beau-père, le Tournaisien Antoine Barthélemy, élu de Bruxelles.
Ralliant des formules dites réalistes en dépit de certains de ses principes, Alexandre Gendebien vote tour à tour pour l’indépendance de la Belgique, pour la monarchie, pour l’exclusion perpétuelle des Orange-Nassau du pouvoir en Belgique, contre la création d’un Sénat, contre l’élection à vie des parlementaires, en faveur du duc de Nemours comme roi des Belges, ainsi que pour tous les articles de la nouvelle Constitution, à la rédaction de laquelle il prit une part minime en raison de ses missions diplomatiques.
Éphémère ministre de la Justice sous la Régence de Surlet de Chockier, et premier président de la Cour supérieure de Bruxelles (1831), il fonde, anime et préside l’Association nationale belge, groupement destiné à faire pression sur les négociations internationales (conférence de Londres) : Gendebien est un farouche opposant à la formule de rétrocession des territoires du Limbourg et du Luxembourg. Dans un discours célèbre (juillet 1831), il s’oppose fermement au Traité des XVIII articles et il prend une part active comme volontaire présent sur le terrain durant la brève campagne militaire d’août 1831.
Député de Mons (1831-1839), chef d’un courant qualifié de gauche à la Chambre, il refuse obstinément que le Limbourg et le Luxembourg soient sacrifiés sur l’autel des négociations internationales ; il entre aussi en conflit, parfois violent, avec ses anciens amis des Journées de Septembre 1830 et finit par se brouiller avec Devaux (après un duel), Lebeau (après le dépôt d’un acte d’accusation), mais aussi avec de Brouckère, de Gerlache, Nothomb et Rogier. Lors de la discussion de la loi communale (juillet 1834-mai 1835), Gendebien se montre favorable à accorder la plus large liberté municipale possible, plaide pour la publicité obligatoire des séances, pour la suppression de tout cens d’éligibilité, et pour l’élection directe du bourgmestre et des échevins. Rarement, faut-il le dire, il est suivi dans ses choix les plus radicaux.
Refusant les nominations dans la magistrature qui lui sont proposées, Alexandre Gendebien finit par se lasser des débats parlementaires et, surtout, il ne peut supporter l’imposition du Traité des XXIV Articles contre lequel il n’a cessé de combattre : « il est déplorable qu’au moment d’abandonner 400.000 Belges on ne veuille pas nous donner le moyen de justifier cet abandon qu’on a appelé à juste titre un fratricide (…) ». À l’heure du vote (19 mars 1839), faisant allusion au nombre d’habitants « sacrifiés » du Limbourg et du Luxembourg, Gendebien s’écrie : « Non, trois cent quatre-vingt mille fois non, pour trois cent quatre-vingt mille Belges que vous sacrifiez à la peur ». Avec fracas, il donne sa démission de député et quitte définitivement l’assemblée ; il renoncera aussi à son mandat de conseiller communal de Bruxelles (1830-1848) et de bâtonnier de l’ordre des avocats.
Succédant à Antoine Barthélémy comme receveur général, il se consacre alors à l’administration des hospices et à quelques exercices d’écriture afin de laisser une trace de ses mémoires. Sa fortune était en partie assurée par les participations que sa famille possède dans une série de charbonnages à la suite des acquisitions de Jean François Gendebien (1753-1838), le père d’Alexandre et de Jean-Baptiste, et fondateur de la dynastie des Gendebien.
Sources
Théodore JUSTE, dans Biographie nationale, t. 7, col. 577-586
Jules GARSOU, Alexandre Gendebien. Sa vie. Ses mémoires, Bruxelles, René Van Sulper, 1930
Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 304-306
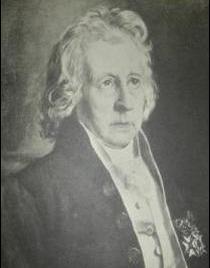
Gendebien Jean Francois
Politique, Révolutions, Socio-économique, Entreprise
Givet 21/02/1753, Mons 04/03/1838
Considéré comme le fondateur de la dynastie familiale, Jean François Genbebien s’est distingué au tournant des XVIIIe et XIXe siècles tant par ses activités politiques que dans le monde de l’industrie charbonnière. Père d’Alexandre et de Jean Baptiste, il a contribué à la transformation des institutions politiques de son temps et, investisseur averti, n’a pas manqué de contribuer au démarrage de la révolution industrielle en pays wallon.
À l’instar de son père, qui exerce comme avocat en principauté de Liège, Jean François Gendebien se destine au Droit qu’il étudie à Liège, à Vienne ainsi qu’à Paris et à Louvain (1777), avant de se fixer à Mons. Avocat auprès du Conseil souverain du Hainaut (1779), occupé à la défense des intérêts de la maison d’Arenberg, il se mêle des affaires de la cité dès qu’il obtient le droit de nationalité du Hainaut. Tour à tour greffier échevinal du magistrat de Mons et membre des États de Hainaut (1786), le beau-fils du lieutenant-châtelain de la ville de Mons exprime clairement son opinion sur les efforts de modernisation à introduire pour améliorer l’administration du comté, soumis aux Habsbourg d’Autriche.
En désaccord avec les réformes de Joseph II, il est destitué et emprisonné au moment où éclate la Révolution brabançonne. À peine libéré (fin 1789), il est choisi comme l’un des neuf délégués du Hainaut au Congrès des États-généraux et il participe à la rédaction de la Proclamation des États-Belgiques-Unis, créant un nouvel état indépendant sous la forme d’une république fédérale (11 janvier 1790). En raison de la modération de ses idées, il préside le Congrès à diverses reprises et est chargé de négocier les conditions d’une réconciliation avec Vienne (fin 1790). Jouant la carte autrichienne contre les Français, il ne s’enthousiasme pas lors de la venue des troupes de Dumouriez et, au moment de la seconde restauration autrichienne, il est nommé membre du Conseil communal de Mons et conseiller-pensionnaire des États de Hainaut (juin 1793-juin 1794). Par conséquent, après Fleurus, Gendebien juge prudent de s’exiler en Allemagne (1794-1796), avant, finalement, de reprendre son activité d’avocat dans le chef-lieu du département de Jemmapes et d’intendant auprès de la famille d’Arenberg.
De plus en plus, il s’intéresse au commerce et à l’industrie, en particulier à un secteur qui lui semble promis à un bel avenir : les houillères. Progressivement, il acquiert des participations ou devient seul propriétaire : à la fin de sa vie, il sera à la tête d’une quinzaine de charbonnages dans le Namurois et les bassins de Charleroi, du Centre et du Borinage, se montrant particulièrement satisfait de disposer dans son portefeuille les sites du Gouffre, du Roton et de Monceau-Fontaine. Patron éclairé, il n’hésite pas à investir quand les machines à vapeur deviennent indispensables.
Pour défendre les intérêts d’un secteur nouveau et en expansion, J-Fr. Gendebien remet le pied à l’étrier de la politique : nommé membre du Conseil général du Département de Jemmapes (1800), il entre aussi au conseil municipal de Mons, avant d’être élu à la présidence du Tribunal de Ière Instance de Mons. De 1804 à 1813, il siège au Corps Législatif de France, où il ne se signale que dans la défense des intérêts du secteur des houillères de son département (co-auteur de la loi de 1810 sur les mines). Il publie alors plusieurs brochures juridiques sur le sujet.
Attentif à l’évolution du monde, Gendebien entretient de longue date des contacts avec les « Hollandais » ; dès lors, en 1815, il est invité à prendre part aux travaux de la Commission chargée de préparer la Loi fondamentale du nouveau Royaume-Uni des Pays-Bas, avant d’être désigné par Guillaume Ier comme membre de sa « Deuxième Chambre » (1815). Esprit indépendant, Gendebien s’avère cependant un parlementaire critique à l’égard de la politique royale et, en 1821, son siège lui est retiré.
L’attitude de ses deux fils dans les Journées de Septembre 1830 le ramène, à 77 ans, aux affaires publiques. Membre de la Société de la Constitution, à Mons (octobre 1830), désigné à la présidence du Tribunal de Ière instance par le gouvernement provisoire, il est plébiscité par les électeurs de l’arrondissement de Soignies pour les représenter au Congrès national (novembre) ; il y rejoint ses deux fils. Il s’y montre en faveur de l’indépendance de la Belgique, pour la monarchie, pour l’exclusion perpétuelle des Orange-Nassau du pouvoir en Belgique, contre la création d’un Sénat, contre l’élection à vie des parlementaires, en faveur du duc de Nemours comme roi des Belges, ainsi que pour tous les articles de la nouvelle Constitution, à la rédaction de laquelle il ne prend qu’une part minime.
Au moment de la dissolution du Congrès national, J-Fr. Gendebien ne brigue pas le renouvellement de son mandat parlementaire. Rentré à Mons, il siège au Conseil communal et préside le Tribunal de Ière Instance jusqu’à son décès, tout en dirigeant le Comité de secours des réfugiés politiques (jusqu’en 1834). Quant à ses charbonnages, ils sont désormais entre les mains de son fils, Jean-Baptiste.
Sources
A. ALVIN, dans Biographie nationale, t. 7, col. 576-577
Luc FRANÇOIS, dans Nouvelle Biographie nationale, t. II, p. 188-190
Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 304-306
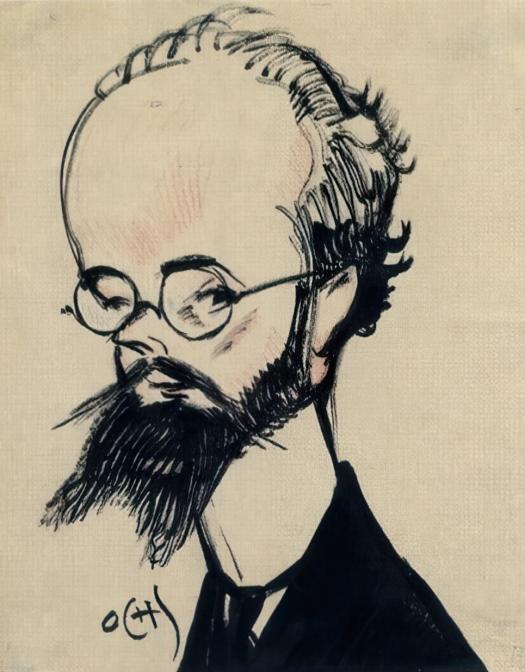 © Sofam
© Sofam
Gavage Louis
Socio-économique, Entreprise
Liège 1885, Esneux 00/04/1965
En Wallonie, Louis Gavage peut sans conteste être rangé parmi les pionniers de la protection de la nature. Son engagement remonte aux années vingt et, pendant plus de quarante ans, il ne va jamais cesser sa contribution à la préservation de sites naturels exceptionnels, tout en nourrissant un mouvement d’idées beaucoup plus large, sensible à la préservation de l’environnement.
Avant la Grande Guerre, ce Liégeois développe des activités professionnelles dans le secteur de l’industrie du zinc. Soucieux d’étendre vers l’extérieur les marchés des industriels du pays de Liège, il crée, avec d’autres jeunes patrons liégeois pratiquant l’espagnol, ainsi qu’avec un ressortissant espagnol et un Équatorien, « l’Espagnol Club », dont il est le secrétaire (1908). L’association organise des conférences afin de mieux faire connaître la langue de Cervantès, ainsi que tous les pays où elle est pratiquée dans une perspective économique.
À partir du printemps 1910, le club se transforme et devient la Société d’Expansion belge vers l’Espagne et l’Amérique du Sud. Tout en poursuivant des cycles de conférences en espagnol, cet organisme de diffusion économique vise à favoriser les relations avec ces pays dans les domaines scientifique, commercial et industriel (par exemple, par l’envoi ou l’accueil d’étudiants) ; en 1912, quand Gavage accède à la présidence de la SEBEAS, elle compte 800 membres dont « tous les Ministres des républiques sud-américaines à Bruxelles ».
Afin de pouvoir commercer aussi avec le Brésil, Gavage multiplie les démarches pour ouvrir un cours de portugais à Liège, haut lieu de la révolution industrielle.
Chargé du consulat de Colombie à Liège (1914-1930), co-fondateur du Cercle consulaire du pays de Liège sous l’occupation allemande, Louis Gavage possède une résidence d’été à Ham, près d’Esneux, au cœur de la boucle de l’Ourthe.
Après l’Armistice, il s’inquiète des projets immobiliers et des menaces qui pèsent sur la vallée de l’Ourthe et sur celle de l’Amblève. Se souvenant des Fêtes de l’Arbre des années 1905 à 1910, il alerte le journaliste Léon Souguenet, qui lui conseille de prendre contact avec René Stevens, animateur de la Ligue des Amis de la Forêt de Soignes. Prenant exemple sur le groupement brabançon créé en 1909, Gavage donne naissance au Comité pour la Défense de l’Ourthe (esneutoise) (24 septembre 1924) ; un rapport est envoyé dans le même temps à la Commission royale des Monuments et des Sites. Président de l’Association pour la Défense de l’Ourthe, appellation définitivement adoptée (ADO), Gavage va mener pendant plus de quarante ans un combat incessant pour la défense de la nature.
Sans jamais ménager son temps, il envoie des milliers de lettres, rédige des rapports, organise des pétitions et surtout mobilise les journalistes. Son ADO bénéficie constamment du patronage de l’ensemble de la presse belge, toujours prompte à relayer un avis ou une alerte de ce dynamique président. Sans se mêler de politique, mais sensible au discours de l’auteur de La colline inspirée, Louis Gavage dispose de relais dans divers partis et parvient également à mobiliser de très nombreuses communes autour de Tilff-Esneux quand le besoin s’en fait sentir. Durant près de 200 numéros entre 1928 et 1963, il assure aussi la publication d’un bulletin trimestriel fort bien documenté et où il développe l’argumentaire de ses dossiers.
Régulièrement traité de farfelu, d’idéaliste et d’autres compliments soulignant la naïveté de son combat en faveur de la nature, Louis Gavage rappelle volontiers son statut d’industriel – dans l’Entre-deux-Guerres, la société de Gavage est devenue le concessionnaire exclusif d’une marque d’aspirateur pour cheminées. De ce fait, il souligne que son combat ne néglige nullement les considérations économiques. Chacune de ses réfutations s’appuient systématiquement sur des avis formulés par des spécialistes (urbanistes, agents des eaux et forêts, ingénieurs, etc.) qu’il sollicite personnellement.
Dès 1928, il émet l’idée de faire de la région de l’Ourthe liégeoise un parc naturel à proximité de Liège, à l’instar du bois de la Cambre ou de la forêt de Soignes pour Bruxelles, les domaines de Wilrijck et Deurne pour Anvers. Réclamant la reconnaissance du parc naturel Esneux-Tilff, notamment pour protéger la boucle de l’Ourthe, il s’oppose à l’extension de fours à chaux, à l’installation d’une laiterie industrielle, à un projet immobilier, à plusieurs projets de construction de barrages, à l’établissement de pylônes électriques, etc. Sa réputation est telle qu’en 1948 il est l’un des membres fondateurs de l’Union internationale pour la protection de la nature (Congrès de Fontainebleau). Quant au Conseil économique wallon, créé par des militants wallons au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il sollicite Gavage pour son expertise sur les questions des routes, des chemins de fer, des canaux, des chemins de fer vicinaux et de l’économie régionale.
En 1933, sur une idée lancée par Souguenet un an plus tôt, Gavage relance le projet d’une fête annuelle de l’arbre à Esneux. Après quelques éditions, l’élan est interrompu ; la Fête sera relancée en 1947, connaîtra des éditions épisodiques jusqu’en 1955, avant que décision soit prise d’une organisation tous les 5 ans. Après la Libération, Gavage contribue à faire émerger le projet d’un code de l’urbanisme applicable à l’ensemble du territoire de la Belgique ; une loi est adoptée en 1962. Avec la régionalisation introduite en 1980, la loi de 1962 deviendra le CWATU, tandis que la loi de 1931 sur le patrimoine est abrogée au profit du décret de 1987 sur la protection du patrimoine culturel immobilier, lui-même remplacé en 1991 par un décret intégré dans le CWATUP. En 1936, Gavage avait obtenu que le bois de Beaumont (Esneux) soit classé comme site national intangible. En 1993, la Boucle de l’Ourthe est classée au Patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
Benjamin STASSEN, La Fête des Arbres. L’Album du Centenaire. 100 ans de protection des arbres et des paysages à Esneux et en Wallonie (1905-2005), Liège, éd. Antoine Degive, 2005, p. 77-178
Paul DELFORGE, Aux origines du Corps consulaire de la Province de Liège. Histoire des consulats établis à Liège de 1845 à 2015, Liège, 2015
Bulletin de l’Association pour la Défense de l’Ourthe, juillet 1928, n°1 – mars 1963, n°191

Gauchez Maurice
Culture, Littérature
Chimay 31/07/1884, Saint-Gilles 24/11/1957
Auteur fécond, à la fois comme poète au début de sa vie, romancier régionaliste à partir des années 1920 et essayiste, Maurice Gauchez doit faire face à plusieurs clichés concernant son parcours littéraire. Le roman du grand veneur (inspiré par le pays de Chimay) est le livre le plus souvent attaché à son nom, tandis que l’étiquette d’écrivain de guerre lui est régulièrement accolée. Émile Lempereur retient pourtant Cacao (inspiré par Anvers) comme le meilleur d’une œuvre où il signe plusieurs « romans-frontières ». Comme dans Le roman du grand veneur, le pays de Chimay a inspiré Le Baron des Robaux, Tignasse, Timothée Flouque et L’Aventurier sans envergure. Avec Au cœur des Fagnes et La Grange au Bois (situé en Gaume), Gauchez visitera aussi d’autres régions du pays wallon.
Né Maurice Gilles, à Chimay en 1884, Maurice Gauchez restera toute sa vie fortement attaché à sa ville natale, bien qu’Anvers puis Bruxelles se soient imposées comme ses principaux lieux de vie. En effet, en 1890, le père de Maurice est désigné à l’Athénée d’Anvers en tant que professeur de mathématiques et c’est dans la métropole portuaire que Gauchez accomplit ses études ; à l’Athénée, le jeune étudiant publie ses premiers poèmes dans le journal de l’école (1899), avant que le quotidien Le Matin accueille ses premiers articles. Fondateur de La Jeune Revue avec Fernand Paul (1903), il publie son premier essai, La Poésie symboliste en choisissant son nom de plume définitif, Maurice Gauchez (1906). Secrétaire de la revue Le Thyrse, il est décidément davantage attiré par les lettres que par les chiffres ; engagé à la Caisse d’Épargne, il n’y fait pas long feu : seule l’écriture l’intéresse.
Quand survient la Grande Guerre, il se porte volontaire dans les rangs des autocanons, mais dans les combats de l’été 1914, il est fait prisonnier, et condamné à mort. Il parvient cependant à s’évader et à rejoindre le front de l’Yser. Durant les quatre années passées dans les tranchées, il se révèle un soldat résolu au combat, blessé à plusieurs reprises et même intoxiqué par les effets du gaz moutarde. Son expérience de vie nourrira certaines de ses œuvres littéraires publiées après l’Armistice (De la Meuse à l’Yser, ce que j’ai vu) : cette production ne doit cependant pas le réduire au seul statut d’« écrivain de guerre », même si, rattrapé par la Seconde Guerre mondiale, il y puisera le sujet d’autres livres.
Critique littéraire au Matin, professeur de français à Anvers, Gauchez collabore progressivement au Soir et, à la fin des années 1920, décide de s’installer à Bruxelles (Saint-Gilles), où il poursuit sa carrière de journaliste et d’enseignant, tout en animant la vie littéraire. En 1922, son Histoire des lettres françaises de Belgique des origines à nos jours est plusieurs fois primée. Ses préfaces, critiques et biographies des gens de lettres sont innombrables, autant que ses conférences ; peut-être ces exercices accaparent-ils le temps que le poète et l’écrivain aurait dû davantage consacrer à construire sa propre œuvre littéraire. D’autant que, responsable de la revue La Renaissance d’Occident, il anime aussi une maison d’édition et une troupe théâtrale qui compte à son répertoire de nombreuses œuvres d’avant-garde. Il fonde encore l’Association des écrivains belges anciens combattants.
Depuis 1994, un Prix littéraire Maurice et Gisèle Gauchez-Philippot est décerné à de jeunes écrivains belges ou étrangers de langue française. Lui-même avait obtenu le Prix Davaine de l’Académie française en 1918 pour Les Rafales, le Prix des Indépendants pour son poème Ainsi chantait Thyl (1919), les Prix De Kein et Prix Michaut pour son Histoire des lettres française de Belgique et le Prix Bouvier-Parvillez pour son roman Le Baron des Robaux.
Sources
Roger FOULON, Maurice Gauchez, Dossiers L, Marche-en-Famenne, Service du livre luxembourgeois, 2e trimestre 2000, 28 p.
Fernand DEMANY, Un poète belge : Maurice Gauchez, Bruxelles, La Renaissance d’Occident, 1923
Georges DOPAGNE, Maurice Gauchez, Bruxelles, 1937
Préface de Jean-Marie HOREMANS à la réédition du Roman du grand veneur, Mons, Tourisme et Culture-Hainaut. 1970
Œuvres principales
Simples croquis, poèmes, Éd. Lamertin, Bruxelles, 1907
Jardin d’adolescent, poèmes, Éd. Sansot, Paris, 1907
Émile Verhaeren, monographie, Éd. Le Thyrse, Bruxelles, 1908
Symphonies voluptueuses, poèmes, Éd. Larcier, col. La Belgique artistique et littéraire, Bruxelles, 1908
Le livre des masques belges, gloses et documents sur quelques écrivains d’hier, d’aujourd’hui et de demain, Éd. La Société nouvelle, Mons, t.1 : 1909, t.2 : 1911 (masques de Franz Gaillard, préface de J. Ernest-Charles)
Images de Hollande. La louange de la terre, poèmes, Éd. Lamberty, Bruxelles, 1911 (Ill. De Fons Van Beurden)
Paysages de Suisse. La louange de la terre, poèmes, Éd. Lamberty, Bruxelles, 1912 (Ill. D’Amédée Lynen et de G. Van Den Broeck)
Les poètes des gueux, anthologie du XIIe siècle à nos jours, Éd. Michaud, Paris, 1912 (choix et préface de Maurice Gauchez)
De la Meuse à l’Yser : ce que j’ai vu, témoignage, Éd. A. Fayard, Paris, 1914 (préface de Henri de Régnier)
Les rafales, poèmes, Éd. E. Figuière, Paris, 1917. Prix Davaine de l’Académie française
Ainsi chantait Thyl, poèmes, Éd. G. Crès, Paris-Zurich, 1918. Prix des Indépendants 1919
L’hymne à la vie, poèmes, Éd. La Renaissance d’Occident, Bruxelles, 1920
Histoire des lettres françaises de Belgique des origines à nos jours, Éd. La Renaissance d’Occident, Bruxelles, 1922. Prix De Kein et Prix Michaut
Romantiques d’aujourd’hui, essai, Éd. La Renaissance d’Occident, Bruxelles, 1924
Tous mes désirs sont les tiens, poèmes, Éd. de la Fourmi, Bruxelles, 1925
Chansons humaines, poèmes, Éd. Buschmann, Anvers, 1925
Cacao, roman, Éd. La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1925
La maison sur l’eau, roman, Éd. La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1926
Thyl, comédie en quatre actes, en vers et en prose, Éd. La Renaissance d’Occident, Bruxelles, 1927
À la recherche d’une personnalité, vingt-cinq essais sur des écrivains belges, Éd. La Renaissance d’Occident, Bruxelles, 1927
Le réformateur d’Anvers, roman, Éd. Burton, Anvers, 1928
Le roman du grand veneur, roman, Éd. La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1929
Les muscles d’or, poèmes, Éd. La Renaissance d’Occident, Bruxelles, 1930
La servante au grand cœur, roman, Éd. La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1931
L’Émigrant, roman et contes, Éd. La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1933
Le Baron des Robaux, roman, Éd. Labor, Bruxelles, 1933. Prix Bouvier-Parvillez
Tanchelin, légende historique, Éd.. Imcomin, Anvers, 1935 (Ill. D’Ernest Heylens)
Marées de Flandre, roman, Éd. La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1935
Au cœur des Fagnes, roman, Éd. Les Cahiers ardennais, Spa, 1935 (Préface d’Albert Bonjean et un portrait d’Ernest Heylens)
V.D.G. volontaire de guerre, roman, Éd. Union des Fraternelles de l’Arme de Campagne, Bruxelles, 1936
Tristontout, nouvelles, Éd. Lovanis, Louvain, 1937
Le démon, roman, Éd. La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1937
Tignasse, roman, Éd. Neggor, Louvain, 1938
Par-dessus les moulins, roman, Éd. Neggor, Louvain, 1938
Hôtel de la paix, roman, Éd. Labor, Bruxelles, 1938
La grange-au-bois, roman, Éd. Braconnier, Florenville, 1939
Max Harry, vedette, roman, Librairie des Combattants, Bruxelles, 1940 (Ill. De J. M. Canneel)
Les espions du ciel, roman, Éd. de l’Étoile, Bruxelles, 1942
L’Entre-Sambre-et-Meuse, essai, Éd. Office de Publicité, Bruxelles, 1941
Camille Lemonnier, essai, Éd. Office de Publicité, Bruxelles, 1943
L’aventure sans envergure, roman, Éd. Les Auteurs associés, Bruxelles, 1943
La tempête, poèmes, Éd. Office de Publicité, Bruxelles, 1944
Quand soufflait l’ouragan, 5 tomes :
1. La ville nue
2. La geôle sous le soleil
3. L’armée du maquis
4. V. V. V.
5. On les a eus, romans, Éd. Wallens-Pay, Bruxelles, 1948
Le Zwin, poèmes, Éd. La Renaissance d’Occident, Bruxelles, 1951
Brume sur la vie, poèmes, Éd. La Renaissance d’Occident, Bruxelles, s.d.

Fourmy Auguste
Culture, Lettres wallonnes
Mons 25/05/1881, Mons 1936
Avant la Grande Guerre, Mons a rejoint Liège, Namur et Charleroi parmi les villes wallonnes qui comptent un théâtre dialectal dynamique. Les deux Delmotte avaient donné ses premières lettres de noblesse à la langue wallonne dans la région de Mons, au début du XIXe siècle, et l’abbé Letellier avait été, au milieu du siècle, le seul continuateur de grande qualité. Au tournant des XIXe et XXe siècles, une nouvelle génération émerge, avec notamment Jean-Baptiste Descamps, Pierre Montrieux, Maximilien Vanolande, Fernand Dessart, Gaston Talaupe, Fernand Maréchal ou Émile Friart qui, au théâtre de Mons, animent le Cabaret wallon. À ses pionniers s’ajoute rapidement Auguste Fourmy qui se distingue par un ton bien personnel et, de ce fait, est souvent considéré comme le précurseur du théâtre wallon montois.
Dès ses premières productions, Auguste Fourmy use du pseudonyme « de la Fourmilière ». Il se fait alors chansonnier et poète, avant de privilégier l’écriture de pièces de théâtre, d’opérettes et de drames lyriques. Dans le pays de Mons, il rencontre un succès certain. Maniant la rime autant que la prose, ce défenseur de la langue wallonne se consacre aussi à l’écriture de nouvelles, de contes et de romans. Après la Grande Guerre, avec Fernand Maréchal et Marcel Gillis, Auguste Fourny décide de lancer une revue en patois, El Dragon, qui vivra de 1920 à 1926. Peut-être affecté par l’échec de cette initiative à laquelle il donna beaucoup de lui-même, Fourmy se retira dans sa tour d’ivoire sans plus toucher sa plume.
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
Ouais : le dictionnaire montois-français suivi du glossaire français-montois, Mons, Association des Montois Cayaux et les Amis de Marcel Gillis, 1998, p. IX-XIV et 104
Oscar LACROIX, Nous sous le casque d’acier, Essais d’anthologie, Liège, 1929, p. 59
Robert WANGERMÉE, Dictionnaire de la chanson en Wallonie et à Bruxelles, Liège, Mardaga, 1995, p. 97
Œuvres principales
Les R’culots, 1908, mélanges de chansons et poésies (avec F. Maréchal)
Les Fourmiches, 1910, mélanges de poésies
Tirâche au Sort, 1910, théâtre
El coucou, 1911, drame lyrique (avec E. Dame)
Ramint d’vances, 1910, opéra-comique (avec Ed. Depret)
Gille dé chin. saint georges montois. Poème wallon
La Brute, drame lyrique
Christus, 1920
Trouïe-la-la, 1920
Mon premier duel, 1920
Trouïe-la-la revue, 1921
Queue d’sorite, 1921, roman de mœurs
Bal populaire, 1923, opérette
Les nouviaux riches, 1924, opérette
Charles Simonet, 1925, comédie
Répétition générale, 1925, comédie
Bayonnette, 1926
El fieu del tambour-Major, 1926

Fauconnier Jean-Luc
Culture, Lettres wallonnes
Charleroi 18/01/1941
Se présentant comme un défenseur d’une culture traditionnelle dont la langue est le vecteur privilégié, Jean-Luc Fauconnier a fait des langues dialectales de la Belgique romane le cœur de ses préoccupations. De son passage au Cabinet de Valmy Féaux (1988-1992), est né notamment le décret des langues régionales endogènes qui apporte désormais une protection aux différents parlers de Wallonie. Animateur, conférencier, écrivain, professeur, Jean-Luc Fauconnier réunit toutes ses activités autour d’un seul point commun : préserver le plus longtemps possible les parlers locaux de Wallonie.
Licencié en Philologie romane de l’Université libre de Bruxelles (1963), Jean-Luc Fauconnier exerce comme professeur de français et de wallon à l’Institut supérieur provincial des Sciences sociales et pédagogiques de Marcinelle pendant 25 années (1963-1988). Ses activités d’auteur et d’animateur en langue wallonne lui ouvrent les portes de la Société de Langue et de Littérature wallonnes, dont il est membre titulaire depuis 1986 et où il occupera la présidence de 1992 à 1995. En 1987, succédant à Émile Lempereur, il accède la présidence de l’Association littéraire wallonne de Charleroi et devient l’éditeur du mensuel èl Bourdon et de plusieurs monographies parues sous le label des éditions du Bourdon, relancées en 1993.
Dès cette époque, il milite en faveur de l’instauration « d’un cours basé sur l’étude de la vie régionale qui comprendrait une partie historique et géographique et une partie consacrée à l’étude du dialecte et de sa littérature ». Il réclame aussi des médias davantage d’ouverture aux dialectes (retransmission de pièces de théâtre en wallon, par exemple). Avec le professeur Willy Bal, il a aussi entrepris l’édition du Dictionnaire de l’ouest-wallon d’Arille Carlier (1985-1992), avant de piloter l’équipe éditoriale du Dictionnaire français–ouest-wallon carolorégien en chantier depuis 1996.
Son entrée au Cabinet de Valmy Féaux, en mai 1988, au moment de la formation des nouvelles coalitions PS-PSC en Wallonie et en Communauté française, marque une nouvelle étape dans la reconnaissance du statut des langues régionales. Attaché de Cabinet auprès du Ministre-Président de la Communauté (1988-1992), Jean-Luc Fauconnier apporte son expertise dans la rédaction du court décret adopté le 24 décembre 1990, qui assure protection et promotion aux langues régionales endogènes. Dans le même temps, il représente la Belgique au sein du comité d’experts du Conseil de l’Europe chargé de la rédaction de la Charte européenne pour les langues moins répandues (1988-1992). Président du comité belge du Bureau européen pour les Langues moins répandues (1990), il a la satisfaction de constater que la Charte européenne finalement adoptée le 5 novembre 1992 partage la même philosophie que le décret francophone. Néanmoins, il devra encore mener bataille pendant de nombreuses années pour que la Belgique accepte de ratifier une Charte européenne que la Communauté française s’est empressée d’approuver, tout en étant tributaire d’une ratification officielle belge qui n’était pas encore effective au début de l’année 2016.
Administrateur et vice-président du Bureau européen pour les Langues moins répandues (1992-2005), Jean-Luc Fauconnier s’emploie par conséquent à dresser un argumentaire en faveur de la ratification, tout en menant des missions aux langues régionales pour le Ministère de la Communauté/Fédération Wallonie-Bruxelles (1992-2006) et en présidant le Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté/Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 1993. Parallèlement, Jean-Luc Fauconnier continue d’assumer, à titre bénévole, les cours de wallon à Charleroi (1989-2001). Depuis 2004, vice-président d’Èl Mojo dès Walons, il est le responsable des cours de wallon de la Maison carolorégienne des Traditions (institution créée en 1997).
Prix du Hainaut de Littérature en Langues régionales pour le récit en prose Li djoû qu’i ploûra dès pupes di têre (1992), Fauconnier signe de rares compositions littéraires, en raison d’autres activités éditoriales accaparantes : il est l’animateur de la revue MicRomania consacrée à la mise en valeur des littératures contemporaines en langues régionales romanes (depuis 1992) ; en 2002, il tente de lancer Walons, fusion expérimentale de textes des Cahiers wallons (Namur), du Mouchon d’Aunia (la Louvière) du Bourdon (Charleroi), du Sauverdiat et de Singuliers (Luxembourg) ; mais en 2004, ce sont El Mouchon d’Aunia et El Bourdon qui se rapprochent, avant de donner naissance à A no boutique (2006). Collaborateur du projet de dictionnaire rassemblant jurons et expressions populaires (2000), il se fait aussi le traducteur en wallon de Charleroi de livres pour enfants bien connus : des contes d’Hoffmann, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, Li P’tit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, voire Les bijoux de la Castafiore d’Hergé (2008).
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
Jean-Luc FAUCONNIER, Quelques remarques concernant les langues dialectales de Wallonie à l’aube du XXIe siècle, 1987, http://www.wallonie-en-ligne.net/Wallonie-Futur-1_1987/WF1-80_Fauconnier-J-L.htm https://www.toponymie-dialectologie.be/fr/jean-luc-fauconnier/

Fabry Marcel
Culture, Lettres wallonnes
Liège 02/02/1891, Liège 07/11/1953
Pionnier du wallon à l’école, Marcel Fabry consacre son existence à la défense du parler dialectal et à l’émancipation politique de la Wallonie, sans jamais souhaiter que le wallon se substitue à la langue française. Son recueil de contes, Li Hatche di bronze (1937) fut « un moment important dans l’effort du wallon pour émanciper sa littérature » (MAQUET).
Employé administratif à l’Échevinat de l’Instruction publique de Liège, Marcel Fabry accomplit toute sa carrière à la ville, accédant à la retraite avec le grade de directeur. Cette activité professionnelle lui procure une situation préférentielle pour défendre l’utilisation de la langue wallonne, sa principale préoccupation. Celui qui est l’un des premiers étudiants du nouveau cours de dialectologie wallonne donné par Jean Haust à l’Université de Liège va multiplier les articles en faveur de la langue wallonne et être à l’origine de plusieurs initiatives concrètes afin de faciliter la transmission du wallon auprès des jeunes générations, sur base volontaire. L’exemple occitan inspire nombre de ses initiatives.
À la suite du Congrès de langue et de littérature wallonnes qui se déroule à Charleroi en 1933, se constitue l’Action littéraire interprovinciale wallonne, avec Émile Lempereur, Fernand Stévart, Michel Duchatto, Franz Dewandelaer, Gabrielle Bernard et Marcel Fabry notamment. Les premières manifestations de cette Action sont des adaptations réciproques de textes, principalement des poèmes, et des expositions de livres et de revues. Le rapprochement entre les multiples initiatives dialectales du pays wallon sera une des constantes de l’activité de Fabry. Une autre sera de développer des outils pédagogiques.
Auteur du premier livre de Lectures wallonnes (1933), Fabry contribue à mettre à la disposition des enseignants un ensemble de textes rimés ou en prose, spécialement adaptés pour les enfants et les adolescents. À partir de 1934, Fabry est parmi les initiateurs d’un concours de rédactions wallonnes qui se perpétue d’année en année dans l’enseignement primaire communal liégeois. Littérateur épris de formules originales, auteur de poésies françaises et de contes wallons, il fait aussi partie de ceux qui encouragent les concours de diction, de récitation, d’illustration des proverbes wallons. S’adressant aux élèves de rhétorique, un autre concours consistera à traduire en wallon des textes grecs et latins. Quant à son recueil de contes, Li Hatche di bronze (La hache de bronze) publié chez Thone en 1937 et qu’il écrit en wallon liégeois, il étonne ses contemporains par sa prétention à traiter en langue wallonne de thématiques historiques fort variées. Sans doute, cet ouvrage contribue-t-il à sa désignation comme membre titulaire de la Société de Littérature wallonne (1939).
Militant wallon actif dans les années 1930, Marcel Fabry apporte plusieurs articles à L’Action wallonne, généralement consacrés à l’emploi des langues. Il y dénonce toute imposition de bilinguisme français-néerlandais et se veut un défenseur du wallon comme langue auxiliaire idéale pour une meilleure connaissance du français. Résistant durant la seconde occupation allemande, il participe aux travaux du Rassemblement démocratique et socialiste wallon (1942-1943), mais la promotion de la langue wallonne reste sa seule passion après la Libération.
Son œuvre dramatique Orne d’afêres (1946), d’après Mirbeau, est accueillie avec faveur. D’un séjour d’étude en Provence (1948), il réunit des informations permettant la rencontre occitano-wallonne organisée en mai 1952, par Robert Grafé. En mai 1948, Paris accueille Au temps où Berthe filait..., un spectacle de marionnettes que Fabry a écrit en franco-wallon de la fin du XIXe siècle ; la demande datait de 1942 et émanait de Gaston Baty, le meneur de théâtre français ; tout en donnant un rôle à Tchantchès et Nanèsse, Fabry s’est inspiré du récit légendaire d’Adenet le Roi (XIIIe siècle) sur la reine Berthe au Grand Pied. En 1951, enfin, il publie une Grammaire pratique du wallon liégeois qui s’inspire fortement des cours de wallon qu’il dispense à l’École provinciale de Service social de Liège.
Sources
Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 599-600
L’Action wallonne, 1933-1940
Paul COPPÉ et Léon PIRSOUL, Dictionnaire bio-bibliographiques des littérateurs d’expression wallonne (1622-1950), Gembloux, Duculot, 1951, p. 155
Fonds d'histoire du Mouvement wallon, Fonds Andrien
Maurice PIRON, Un nouveau conteur liégeois, dans La Vie wallonne, mars 1939, n°223, p. 168-177 ; Maurice PIRON, In Memoriam, dans La Vie wallonne, 1953, n°264, p. 312-313
Au temps où Berthe filait..., dans La Vie wallonne, 1963, 1ère partie, n°301, p. 44-68, 2e partie, n°302, p. 95-132
La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. 3, p. 217
Le choix de la seconde langue dans l’enseignement, publiée par la Ligue d’Action wallonne de Liège, Liège, 1934, 28 p.
La Nouvelle Revue wallonne, t. 2, n° 4, 1950, p. 263
La Wallonie nouvelle, 3 avril 1938, n° 14
Albert MAQUET, dans Nouvelle Biographie nationale, t. VI, p. 200-201
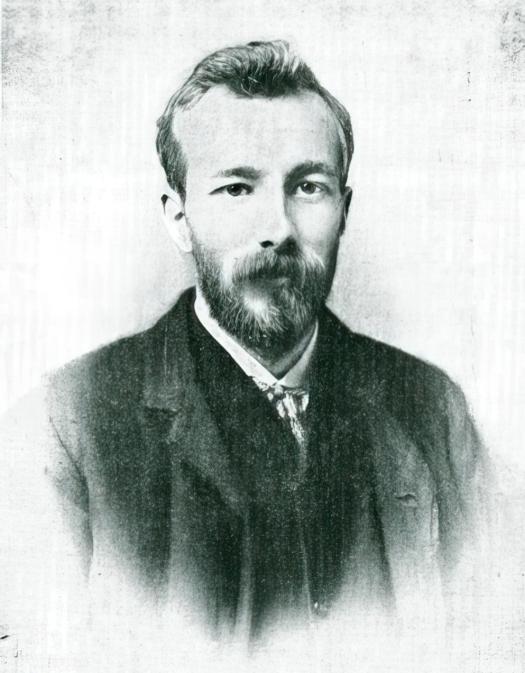 © Sofam
© Sofam
Étienne Edmond-Jacques
Culture, Lettres wallonnes
Jodoigne 07 ou 08/04/1862, Jodoigne 11/04/1895
En composant, en 1888, son premier vaudeville en wallon de Jodoigne, Edmond Étienne a mis un pied, de fort heureuse façon, dans l’étrier de la littérature dramatique wallonne. D’autres œuvres suivront, apportant à son auteur une réputation débordant largement le roman païs de Brabant.
Bon élève à l’École moyenne de Jodoigne, Edmond Étienne brille surtout par ses résultats en « rédaction française ». La disparition de son père (1867) l’oblige cependant à accélérer le processus de reprise de l’activité familiale : un court apprentissage à Bruxelles, une initiation à Anvers, et voici Edmond Étienne relieur. Rentré à Jodoigne, où sa mère tient commerce de papeterie et de mercerie, il y installe son atelier de reliure et passe autant de temps à lire le contenu des ouvrages qu’à réaliser le travail demandé. Dans un premier temps, son seul passe-temps est la politique. Sa plume s’escrime volontiers contre ses adversaires ; elle est acerbe et le journal, Le Jodoignois, qu’il fonde alors, sert de tribune à ses humeurs.
Peu enclin à se porter lui-même candidat, il oriente son imagination vers un autre style d’écriture : en 1883, il compose un drame en trois actes, intitulé L’usurier, inspiré d’un roman de Francis Tesson, mais de piètre qualité. L’expérience lui est cependant utile : il se convainc que le seul vrai langage du pays est le wallon et il se lance dans la traduction libre et personnelle de quelques pièces du théâtre français qui sont jouées à l’initiative du cercle dramatique L’Emulation, qu’il a créé à Jodoigne, en 1886, et qu’il va présider jusqu’à son décès en 1895. Séduit par la saveur toute particulière du wallon de Jodoigne, il écrit sa première chanson wallonne en 1884 et, quatre ans plus tard, ils sont plusieurs acteurs à interpréter On pîd dins le strevire, comédie-vaudeville en trois actes, qui connaît un franc succès et où l’on retrouve le goût d’Étienne pour la politique, cette fois traitée avec humour.
Très vite, il est sollicité pour de nouvelles pièces de théâtre en wallon ; il publie dans les gazettes locales une série de scènes populaires qui forment Nos marians Cadie. Il signe ensuite La rose de Roux-Miroir (1890) : racontant les mésaventures d’un horticulteur réputé, créateur d’une nouvelle variété de poires et qui cherche à marier sa fille, la pièce dont il existe une version en wallon brabançon et une version en français, toute deux de la main d’Étienne, est jouée en 1891 et publiée en 1893. Cette œuvre vaut à son auteur d’être admis comme membre correspondant de la Société liégeoise de Littérature wallonne.
En 1891, une médaille d’argent, décernée par la Société liégeoise de Littérature wallonne a récompensé sa chanson On cèke wallon au Villadge ; ce n’est qu’un début : l’année suivante, deux pièces, Le Marchau ou Maujone piedroue (sur le thème du tirage au sort des soldats) et Po l’bouse et po l’cœur, reçoivent respectivement une médaille d’argent et une médaille de vermeil. Membre de la Société des Auteurs wallons, il lance un journal bimensuel, Le Sauverdia, consacré à l’illustration dialectale de Jodoigne, mais qui connaît le succès dans la Wallonie toute entière, car Étienne souhaite ardemment un instrument de liaison entre les différents dialectes du pays wallon. À l’époque, l’orthographe n’est pas fixée et Étienne, partisan de la plus grande liberté et de la phonétique, s’oppose, avec amitié, à Julien Delaite, « champion de l’orthographe analogique (avec le français) la plus complète ». Contraint par manque de moyen de cesser la publication de Sauverdia, Étienne en prendra ombrage dans les derniers temps de son existence.
La collaboration d’Étienne est sollicitée par des gazettes Aclots, ainsi que par Wallonia. Passionné par le folklore, il a entrepris d’explorer les traditions de son roman païs de Brabant ; il s’intéresse aux anciennes pratiques et à leur vocabulaire. Il nourrit d’exemples le Dictionnaire des Spots wallons de Joseph Dejardin, président de la Société liégeoise de Littérature wallonne et, consécration suprême, ses trois premières comédies sont traduites en wallon de Liège, tandis qu’une adaptation de son premier vaudeville paraît à Tournai. C’était là le souhait le plus cher du Brabançon wallon : éviter à des œuvres intéressantes de garder un caractère trop local et leur permettre de voyager dans tout l’espace wallon. Sans aucun doute, Étienne apporte sa contribution au mouvement pour une reconnaissance officielle de la littérature dramatique wallonne : les premiers subsides du gouvernement sont accordés en 1892.
Edmond Étienne était promis à une belle carrière littéraire en langue wallonne, mais sa santé chancelante depuis qu’un accident l’avait rendu infirme des jambes dans sa jeunesse l’empêchera de mener à bien ses nombreux projets.
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
Paul MOUREAU, Une belle figure wallonne. Edmond Étienne (1862-1895). Sa vie et son œuvre, Bruxelles, Service de Recherches historiques et folkloriques du Brabant, Bruxelles, 1930
Charles DEFRECHEUX, Joseph DEFRECHEUX, Charles GOTHIER, Anthologie des poètes wallons (…), Liège, Gothier, 1895, p. 301-303
L’Indépendance belge, 14 avril 1895
