

Dubois Abel
Politique
Erbisoeul 5/01/1921, Mons 18/10/1989
Longtemps dans l’ombre de Léo Collard, Abel Dubois s’est imposé comme une forte personnalité socialiste, un partisan acharné de l’enseignement public, un réformateur majeur du monde de l’éducation et un défenseur attentif des intérêts et du rôle de la ville de Mons dans le paysage institutionnel en pleine évolution. En 1968, Abel Dubois était devenu le premier ministre de l’Éducation nationale à s’occuper exclusivement de l’enseignement « francophone ».
Fils de cheminot militant syndical, diplômé de l’École normale de l’État à Mons (1939), il entame sa carrière dans l’enseignement communal juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ayant suivi une formation à Nivelles comme régent en éducation physique, il devient professeur à l’Athénée de Mons à partir de 1948. Pédagogue comme militant socialiste, Abel Dubois considère que la question de l’enseignement est primordiale. Secrétaire puis président des Jeunes Gardes socialistes montoises (1939), secrétaire de la section locale du PSB de Mons (1945), Dubois s’est présenté au scrutin communal d’octobre 1952 et a été élu conseiller communal. Il entre à l’hôtel de ville de Mons au moment où, pour la première fois, en la personne de Léo Collard, la cité du Doudou est dirigée par un socialiste. Forte personnalité, Léo Collard est choisi comme ministre de l’Instruction publique (1954-1958) et s’entoure d’un cabinet où Abel Dubois devient le secrétaire particulier du ministre. C’est dire s’il soutient les mesures vilipendées par le PSC qui ranime la guerre scolaire. Le pacte scolaire est signé en novembre 1958, mais les socialistes ne sont plus au gouvernement.
Nommé inspecteur de l’Enseignement technique (1957-1965), Abel Dubois est désigné, après le scrutin d’octobre 1958, comme échevin en charge des Travaux publics (1959-1965). Il héritera plus tard de l’Instruction publique et de la Culture (1965-1969, janvier 1972-mars 1973), avant de remplacer Léo Collard comme bourgmestre de Mons (mai 1974-mars 1989). Entre-temps, Dubois a exercé à plusieurs reprises responsable de cabinets ministériels (auprès de Marcel Busieau de 1961 à 1963, de Henri Deruelles de 1963 à 1965). Fort d’une telle expérience, et alors que Léo Collard préside le PSB, Dubois est choisi comme sénateur provincial du Hainaut (1965-1968), avant d’être élu au scrutin dans l’arrondissement de Mons-Soignies (1968-1974).
Ses compétences en matière d’enseignement le désignent immanquablement comme ministre de l’Éducation nationale dans les gouvernements Eyskens (de juin 1968 à janvier 1972) ; il aura à régler définitivement les conséquences du Walen buiten dont la première est sans conteste sa désignation en tant que premier ministre de l’Éducation nationale uniquement responsable de l’enseignement francophone ; à ses côtés, Pierre Vermeylen est en charge de l’enseignement néerlandophone. Durant son mandat ministériel, Abel Dubois entreprend une profonde réforme dans un but de démocratisation, dont les principaux éléments sont l’instauration de l’enseignement rénové dans le secondaire, la création de l’enseignement spécial, le lancement de l’enseignement de promotion sociale, l’établissement d’un statut pour les enseignants, l’instauration de la semaine des cinq jours, ainsi que les fameuses lois universitaires de 1971, dont celle sur l’expansion universitaire qui crée une troisième université d’État, à Mons, et celle sur le mode de financement fondé sur le nombre d’étudiants.
Partisan de la décentralisation administrative, il installe à Mons le Fonds de Constructions scolaires, ainsi que le Centre technique de l’Education nationale. Secrétaire d’État dans le gouvernement Leburton Ier (janvier-octobre 1973), en charge de l’Aménagement du Territoire et au Logement, adjoint du ministre des Travaux publics, il démissionne de sa fonction et se consacre entièrement à « sa » ville de Mons. S’il a voté en faveur de l’inscription d’une réforme de l’État dans la Constitution en décembre 1970, il ne siégera qu’au sein du seul Conseil culturel de la Communauté culturelle française de Belgique (1971-1974). Les institutions wallonnes ne sont pas encore nées lorsqu’il décide, en mars 1974, de ne plus se représenter au Sénat.
Devenu principalement maïeur de Mons, Abel Dubois y développe une politique ambitieuse de rénovation urbaine, de développement d’infrastructures (hôpitaux, routes, studio RTB, musées), de valorisation culturelle et de restauration architecturale, affirmant le rôle de sa ville à l’échelle wallonne, et pas seulement en tant que cité universitaire. En juin 1976, il figurait parmi les 143 signataires de la Nouvelle Lettre au roi (29 juin 1976), destinée à dénoncer l’extrême lenteur mise dans l’application de l’article 107 quater de la Constitution et à plaider en faveur d’un fédéralisme fondé sur trois Régions : Bruxelles, Flandre et Wallonie. En 1978, Abel Dubois avait anticipé la mise en place du futur paysage institutionnel wallon en s’accordant avec les autres bourgmestres des grandes villes wallonnes, pour reconnaître à Namur le statut de capitale politique de la Wallonie, pour attribuer à Liège les fonctions économiques, à Charleroi les administrations sociales, et à Mons les organismes culturels.
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
Marie ARNOULD, dans Nouvelle Biographie nationale, t. VI, p. 178-180
Mark VAN DEN WIJNGAERT (dir.), D’une Belgique unitaire à une Belgique fédérale. 40 ans d’évolution politique des communautés et des régions (1971-2011). Étude à l’occasion du 40e anniversaire du Parlement flamand, Bruxelles, ASP, décembre 2011, p. 21
Histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. IV, p. 267, 271, 293-295, 298
Mandats politiques
Conseiller communal de Mons (1953-
Echevin (1959-1974)
Sénateur provincial du Hainaut (1965-1968)
Sénateur (1968-1974)
Ministre (1968-1972)
Secrétaire d’État (1973)
Bourgmestre (1974-1989)
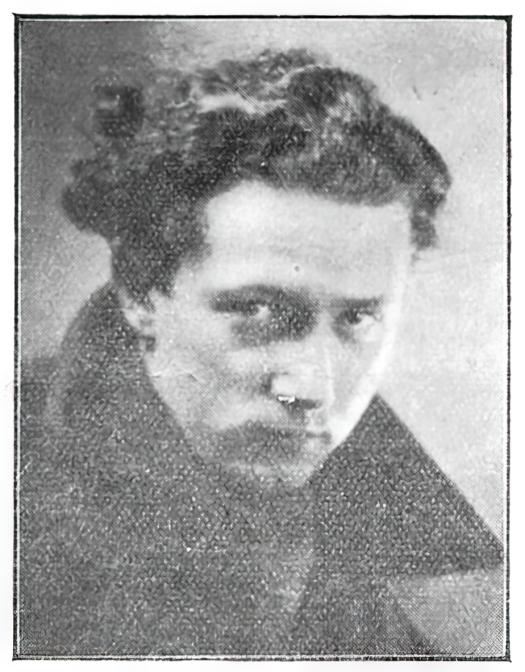
Dewandelaer Franz
Culture, Lettres wallonnes, Poésie, Militantisme wallon
Nivelles 20/05/1909, Bruges 23/08/1952
Les admirateurs du poète Franz Dewandelaer affirment que « son œuvre est une des plus fortes et des plus pathétiques de la poésie wallonne ». Nivelles, sa ville natale, est le thème central de ses nombreux écrits, où il utilise souvent des images fortes, parfois violentes.
Ayant exercé divers métiers avant de se fixer comme employé à l’administration communale de Nivelles (1934), Franz Dewandelaer s’est lancé très tôt dans l’écriture poétique, en langue française comme en langue wallonne, avant de s’essayer à la composition de pièces de théâtre, d’avant-garde et au contenu politique engagé ; la satire sociale est virulente, la critique du capitalisme mordante et l’attention à l’égard des conditions de vie des mineurs sincère. Il se met aussi à l’écriture de sketches radiophoniques, de contes, voire de chroniques pour des journaux et revues. Puisant son inspiration dans des sources identiques à celles des surréalistes wallons, Dewandelaer compose la plupart de ses poèmes entre 1930 et 1936, mais beaucoup ne seront publiés que bien plus tard.
« Avec Gabrielle Bernard et Henri Collette, Franz Dewandelaer est considéré comme l’une des trois figures de proue de la poésie wallonne des années 1930. Dans des styles très différents, ils ont cependant plusieurs traits communs : anticonformisme, sincérité intransigeante, haine de l'hypocrisie et de la bonne conscience bourgeoise, mais aussi goût de l'éloquence, de l'exagération, des images frappantes, voire du macabre, recours fréquent à la narration ou à la description... Postromantiques ou symbolistes, marqués par Baudelaire et Verhaeren plus que par Hugo ou Lamartine, ils se détachent nettement, par la primauté accordée à l'émotion, des auteurs de la génération précédente ». Dewandelaer est d’ailleurs un précurseur d’une nouvelle tendance pour la génération suivante.
Mobilisé en 1939, le soldat Dewandelaer est arrêté au soir de la Campagne des Dix-Huit Jours, fait prisonnier et emprisonné en Bavière. Rapatrié malade en 1941, il conservera toujours des séquelles de sa captivité et elles ne sont pas étrangères à son décès survenu, en clinique, en 1952. Après la Libération, il milite très activement dans le Mouvement wallon : mêlant ses convictions politiques à ses talents littéraires, il propose un hymne wallon en composant deux chœurs parlés, Bloc et Il était une fois, d’après la Lettre au roi de Jules Destrée. Membre du Congrès national wallon, candidat du Parti d’Unité wallonne aux législatives de 1946 et de 1949, il a été membre de Radio-Wallonie et écrit dans Échos de Wallonie. Il tient aussi des chroniques régulières à Radio-Namur et Radio-Hainaut.
Sources
Paul DELFORGE, Franz Dewandelaer, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 498
La Vie wallonne, 1952, p. 220 ; 1953, p. 118-140
Le Gaulois, n° 245, 30 août 1952, p. 6
Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, p. 186-187
Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon, Ces écrivains qui ont aimé, honoré et raconté Nivelles, Nivelles, 2011, p. 28-30
L’œuvre poétique wallonne de Franz Dewandelaer (1909-1952), Liège, Société de Langue et de Littérature wallonnes, 2003, coll. Mémoire wallonne, n°7
Maurice PIRON, Anthologie de la littérature wallonne, Liège, Mardaga, 1979, p. 520
Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 477
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 192, 197-198, 227
Poèmes
Bouquet tout fèt, 1933 (recueil, prix du Brabant, Prix du Centenaire)
Les tchautès rûwes, 1934 (prix de la Fédération littéraire wallonne de Liège)
L’aveûle, 1938
El Moncha qui crèch, 1948 (recueil)
El bribeu, 1948
El fou, 1950
Théâtre
Pârti, 1928 (prix des Cercles littéraires et artistiques du Brabant)
Le lâche, 1929 (deuxième prix d'honneur à l'Académie des Jeux floraux de Constantine)
Lès deûs rêves (1932-1933) (pièce de théâtre en wallon créée par des marionnettes, pour la télévision, en décembre 1976)
Baquets dèl nute, 1935 (prix du roi Albert)
L' tchanson du grisou, 1934/5

Dethier (ou De Thier) Laurent-François
Révolutions
Spixhe-Theux 14/09/1757, Theux 01/07/1843
À la suite de la Prise de la Bastille, Laurent-François Dethier prend la tête d’un mouvement révolutionnaire et républicain ; à son initiative, le Congrès de Polleur adopte, dès le 16 septembre 1789, une Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Si l’on considère généralement que cette œuvre fut collective, force est de reconnaître le rôle prépondérant joué par l’avocat Dethier, par ailleurs bourgmestre de Theux. Tour à tour Liégeois, Autrichien, Français, Hollandais et Belge, bourgmestre, représentant du Tiers, député de l’Ourthe et membre du Congrès national, L-Fr. Dethier contribue à la transformation des institutions qui l’entourent en restant fidèle à un seul principe : il est républicain. Au-delà de son activité politique, l’avocat Dethier a consacré une partie de son existence à l’étude des sciences naturelles, du folklore et de l’archéologie. Plus d’un siècle après sa disparition, son premier biographe (J. Meunier) fait ressurgir une personnalité marquante qu’avaient révélé les événements de 1789.
Formé à Saint-Trond, puis aux universités de Louvain et de Reims, diplômé en Droit (1780), avocat, particulièrement intéressé aux affaires publiques, le jeune Laurent François Dethier est d’abord le chef de la faction opposée à la famille des « de Limbourg » dans le dernier quart du XVIIIe siècle. En 1788, il est choisi bourgmestre de Theux (avril-novembre). Défenseur farouche des idées des Lumières, il prend une part active aux événements révolutionnaires qui se déroulent en principauté de Liège et en particulier dans le marquisat de Franchimont, à partir de l’été 1789. Dès le 9 août, il convoque en Congrès à Polleur, tous les représentants des cinq bans du Marquisat (Jalhay, Sart, Spa, Theux et Verviers) ; la première réunion se tient le 26 août et Dethier prononce le discours inaugural ; dès la 5e séance, le 16 septembre, le « Congrès de Polleur » rend publique une Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, plus radicale que la déclaration française. Approuvée à l’unanimité, elle est jugée plus radicale parce que le texte wallon ne reprend pas l’article XVII français et ne reconnaît donc pas, en la propriété, un droit inviolable et sacré, même s’il la range dans les droits naturels et imprescriptibles. Aux côtés de Dethier qui est l’homme fort du Congrès, le spadois Jean-Guillaume Brixhe joue un rôle important, en tant que secrétaire.
Lors des premières élections liégeoises (juin 1790), L-Fr. Dethier devient le premier représentant du marquisat de Franchimont à l’État Tiers. En juillet, avec Fyon notamment, il constitue une « Société des Amis de la Liberté à Theux » qui, par pétition, réclame un local. Dès le 16 août, est élaboré un projet de constitution franchimontoise. Jugeant les décisions liégeoises trop timorées, Dethier et ses partisans tiennent à un modèle ressemblant à la France ; ils sont même décidés à se battre contre les Liégeois pour imposer leurs idées. Mais à l’heure où les troupes autrichiennes se rapprochent dangereusement pour restaurer l’Ancien Régime, le Congrès de Polleur cesse de se réunir (janvier 1791) et L-Fr. Dethier part trouver refuge en France. Il n’a de cesse de défendre le rattachement à la France de la principauté de Liège, ou du moins « des pays de Franchimont, de Stavelot et de Logne » dont il imagine l’organisation politique et sociale. Il est aidé par Brixhe qui rédige le Code du Droit public des pays réunis de Franchimont, Logne et Stavelot, où se trouvent les procès-verbaux des séances de l’assemblée de Polleur.
De retour à Theux dans les pas de Dumouriez, il incite ses compatriotes à voter la réunion (26 décembre 1792) et, en 1793, se montre partisan d’une distinction claire entre Liégeois et Franchimontois quand commence la seconde Restauration. Réfugié à nouveau à Paris, Dethier est admis au Club des Jacobins (juin 1793) et revient définitivement à Theux en 1795. Agent au service de la République dans l’arrondissement de Spa, juge au tribunal de Spa (1795), juge de paix du canton de Spa (1796-1797), juge au tribunal civil de Liège (1797-1798), Dethier est élu député au Conseil des Cinq Cents, la chambre législative qui se réunit à Paris, mais il en démissionne à la suite du coup d’État de Bonaparte, le « despote usurpateur ». En 1800, il rentre au pays où il se consacre à l’écriture.
En l’an VII, il avait rédigé un mémoire dédié à la « grande république une et indivisible ». Ce goût de l’écriture, il le met à profit durant la période où il se retire de la politique, non sans militer en faveur de l’instruction publique. Comme il s’intéresse à l’archéologie, à la linguistique et aux sciences naturelles, il rédige plusieurs traités et ouvrages dans ces divers domaines, sans systématiquement les publier. Il est en contacts épistolaires avec de nombreux savants de son temps. Minéralogiste et géologue, il est connu pour plusieurs découvertes de minéraux anciens et pour l’établissement de la première carte géologique couvrant tout le département de l’Ourthe. En 1817, il est candidat à la chaire de minéralogie de l’Université de Liège. Outre un Calendrier perpétuel wallon-français, il signe aussi Origines wallonnes ouvrage (inédit) où se manifeste son intérêt pour le passé et le « folklore » wallons, comme en témoigne le long sous-titre « recherches archéologiques sur l’histoire et les antiquités du pays wallon Belgique, son idiome, sa mythologie, ses lois et usages primitifs les plus remarquables ».
Au moment de la Révolution de 1830, Laurent-François Dethier revient sur la scène politique. À Theux d’abord comme bourgmestre, comme député ensuite : membre du Corps législatif, il est député suppléant au Congrès national en 1830. Il y plaide en faveur d’un régime républicain pour l’État qui vient de faire sa révolution contre les Pays-Bas. Quand une majorité de députés opte pour un système monarchique, L-Fr. Dethier remet immédiatement sa démission. Après les événements de 1830, il est décoré de la Croix de fer.
Sources
http://www.wallonie2010.eu/DroitsHomme.htm
Paul HARSIN, La Révolution liégeoise de 1789, Bruxelles, Renaissance du Livre, 1954, coll. Notre Passé, p. 97-98, 119-120
Élisée LEGROS, dans La Vie wallonne, III, 1960, n°291, p. 197-202
Gustave DEWALQUE, dans Biographie nationale, t. 5, col. 824-826
Joseph MEUNIER, La personnalité attachante de l’avocat theutois L. F. Dethier, dans Fédération archéologique et historique de Belgique, Annales. XXXIVe session, Congrès de Verviers, 22-25 juillet 1951. Programme du congrès et résumé des communications - textes des mémoires, 1954, p. 57-66
Joseph MEUNIER, Un acteur de la Révolution liégeoise : l’avocat Laurent-François Dethier, 1757-1843, géologue et publiciste, représentant du peuple au Conseil des 500, membre du Congrès national de Belgique et ses correspondants, dans Bulletin de la Société verviétoise d’archéologie et d’histoire, Verviers, Gérard, 1959, vol. 46, p. 7-144
Joël BAUM, Le Theutois Laurent-François Dethier et le Spadois Jean-Guillaume Brixhe, acteurs majeurs de la révolution et de lapériode française dans le pays de Franchimont (1789-1805), Université de Liège, mémoire inédit en Histoire, 2010-2011
Mandats politiques
Echevin de la Cour de Justice de Theux
Bourgmestre de Theux (1788)
Représentant au Tiers (1790)
Député de l’Ourthe au Conseil des Cinq Cents (1799-1800)
Membre suppléant du Congrès national (1830-1831)
Paul Delforge

Deprez Gérard
Politique
Noville 13/08/1943
Président du PSC puis du MCC, eurodéputé et sénateur, Gérard Deprez est un acteur politique wallon majeur sur la scène belge depuis la fin des années 1970. Les étapes de son histoire personnelle se mêlent d’ailleurs étroitement aux faits principaux de l’histoire récente.
Né en pleine Seconde Guerre mondiale, non loin de Bastogne, il se retrouve orphelin de son père fusillé par des troupes irrégulières de l’armée allemande lors de l’offensive Von Rundstedt (1944). Après des études secondaires classiques au Petit Séminaire de Bastogne, Gérard Deprez arrive à Leuven au moment des revendications flamandes en faveur de la flamandisation intégrale de l’Université. C’est par conséquent dans l’atmosphère des Walen buiten qu’il réussit ses licences en Sociologie (1963-1967), devient assistant puis docteur en Sociologie (1974), tout en exerçant comme professeur à l’ISCO (1966-1974). Entre une carrière universitaire et la politique, le virus du second s’avère le plus déterminant. Conseiller au Cabinet du Ministre de la Culture française (1974-1975), il devient Chef de Cabinet du Vice-Premier ministre (1979-1981), tout en exerçant des fonctions de plus en plus importantes au sein du PSC. Conseiller politique auprès des présidents du PSC, Charles-Ferdinand Nothomb et Georges Gramme (1975-1978), il devient secrétaire politique général du PSC-CVP (1978-1979) avant la rupture définitive entre les deux ailes communautaires du parti catholique. Candidat à la présidence du PSC en 1979 face à Paul Vanden Boeynants, le jeune Gérard Deprez est battu par celui qui vient d’exercer pour la dernière fois la charge de Premier ministre (65,5%-34,5%). Mais deux ans plus tard, quand VDB démissionne de la présidence du PSC en même temps que tombe le gouvernement (décembre 1981), le comité directeur du PSC désigne Deprez pour assurer l’intérim, avant qu’une élection interne ne confirme ce choix.
De 1981 à 1996, Gérard Deprez est le porte-parole d’un PSC qui est associé à tous les gouvernements qui se succèdent. Il apporte ainsi sa contribution décisive lors des réformes institutionnelles de 1988-1989 et surtout de 1992-1993. Durant tout ce temps, il exerce un mandat européen, ayant été élu pour la première fois en 1984. Il siègera au Parlement européen sans interruption jusqu’en 2009, refusant d’exercer le mandat de sénateur pour lequel il avait été élu en 1995.
Après quatorze années passées à la tête du PSC, Gérard Deprez annonce son départ anticipé (fin 1995) ; élu avec 51,1% des suffrages exprimés en juillet 1994, il soutient la candidature de Joëlle Milquet à sa succession. La candidature de Ch-F. Nothomb (janvier) perturbe un scénario trop bien monté. Fin mars, l’élection qui mobilise plus de 20.000 adhérents du PSC fait émerger Ch-F. Nothomb (47,93%) pour un dixième de pourcent, face à Joëlle Milquet (47,82%). Refusant de remplacer Guy Lutgen comme ministre wallon à Namur (1996), Deprez lance l’idée d’un mouvement de centre droit, wallon, s’orientant vers le PRL. En opposition avec les instances dirigeantes du PSC, Gérard Deprez crée le MCC, est exclu du PSC en janvier 1998 et transforme le « Mouvement des Citoyens pour le Changement » en parti.
En novembre 1998, la fédération PRL-FDF s’étend au MCC : à partir de 1999, le chemin politique de Gérard Deprez est étroitement associé à celui du parti libéral, au sein du MR à partir de 2002. Conservant son autonomie et son droit à la différence en tant que président d’une structure politique constituante du MR, Gérard Deprez est premier suppléant lors du scrutin européen de 2009 (60.336 vp.). Alimentant la campagne électorale par un livre coécrit avec Louis Michel, 100 raisons d’aimer l’Europe, il ne retrouve pas son mandat à l’Europe. En mai 2010, premier suppléant MR au Sénat (43.148 vp.), il entre à la Haute Assemblée dans la mesure où Louis Michel (dernier de liste et élu avec 127.878 vp.) poursuit son parcours européen. Membre du Groupe Renaissance au sein du MR, Gérard Deprez retrouve les bancs du Parlement européen en 2014 : 3e candidat effectif (55.270 vp.), il est le principal bénéficiaire du gain d’un siège enregistré par le MR.
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
http://www.gdeprez.be/histoire/02-cv.php
http://www.gdeprez.be/histoire/01-mon-histoire.php (s.v. décembre 2014)
Mandats politiques
Député européen (1984-2009)
Ministre d’État (1995)
Sénateur (2010-2014)
Député européen (2014-)
Paul Delforge

Delvaux Laurent
Culture, Sculpture
Gand 1696, Nivelles 24/02/1778
Pendant plus de quarante ans, le sculpteur Laurent Delvaux exerce son talent à Nivelles. Souvent considéré comme le représentant du baroque parce que les chaires de vérité sont une des pièces les plus significatives de ce style, « maître-sculpteur de la Cour » sous Charles de Lorraine, il a appris le métier à Bruxelles, à Londres et à Rome. Mais c’est dans la cité de son épouse et de sa famille qu’il donne le plein de sa créativité dans l’exécution de commandes destinées, pour une bonne part, à la collégiale Sainte-Gertrude.
Natif de Gand, ayant eu pour maître l’Anversois Pierre-Denis Plumier, Laurent Delvaux est issu d’une famille wallonne et les historiens de l’art s’accordent à considérer que « du XVIIe siècle « flamand », il ne porte guère l’empreinte » (Marguerite Devigne). Durant son apprentissage à Bruxelles, il s’est familiarisé à la sculpture de chaires de vérité, de monuments funéraires et de figures allégoriques et il a l’occasion de démontrer son savoir-faire lors d’un séjour en Angleterre (1717-1726), notamment à l’abbaye de Westminster. Réalisant également quelques bustes et statues, il travaille aussi bien le bois que la pierre quand il fait le voyage en Italie (1726-1733) ; à Rome, la sérénité des antiques le séduit, davantage que le Bernin, et influence son style du moment. Malgré le succès qu’il rencontre notamment auprès du Vatican, il rentre au pays. Nommé sculpteur de la Cour à Bruxelles, auprès de l’archiduchesse Marie-Élisabeth puis de Charles de Lorraine, il se fixe définitivement à Nivelles, où il retrouve son père. Plus personnel, son style se fait alors « de mesure, d’équilibre, de force contenue et de lyrisme décoratif ». Si les cours européennes et les abbayes sont ses commanditaires, il consacre une attention particulière à la décoration de la collégiale de Nivelles, dont le chantier de réaménagement s’étend de 1735 à 1772.
En 1770, Laurent Delvaux dote la collégiale Sainte-Gertrude d’une chaire de vérité, en marbre, représentant la rencontre de Jésus et de la Samaritaine au puits. Dans cette œuvre se mêlent plusieurs styles : les escaliers et la cuve sont d’un style Louis XV et Louis XVI, tandis que la scène du pied, par la sobriété des gestes et des drapés des personnages, annonce le néo-classicisme. Plusieurs statues de la collégiale nivelloise portent aussi la signature de Delvaux, dont un groupe appelé Conversion de saint Paul. Si Nivelles est privilégiée (un groupe de la Conversion de l’Apôtre, sculpté dans le bois et destiné au maître-autel, trouve place dans l’église Saint-Paul), la cathédrale Saint-Aubain à Namur abrite pour sa part les statues des quatre docteurs de l’Église latine et l’église Notre-Dame dispose d’un saint Antoine. L’abbaye de Floreffe compte aussi trois statues de saint. À Gand, il sculpte la chaire de Saint-Bavon et, dans le marbre, l’effigie de saint Liévin à l’église Saint-Michel. Enfin, à Bruxelles, où il dispose aussi d’un atelier, Laurent Delvaux décore principalement la façade du palais du Gouverneur général (deux bas-reliefs et neuf statues, dont un monumental Hercule, datant de 1770), entre 1767 et 1772, et l’on peut y percevoir ici aussi les prémisses du néo-classicisme.
Sources
Edmond DE BUSSCHER, dans Biographie nationale, t. 5, col. 498-503
Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 243-244
Alain JACOBS, Laurent Delvaux, Paris, Arthema, 1999
Paul Delforge
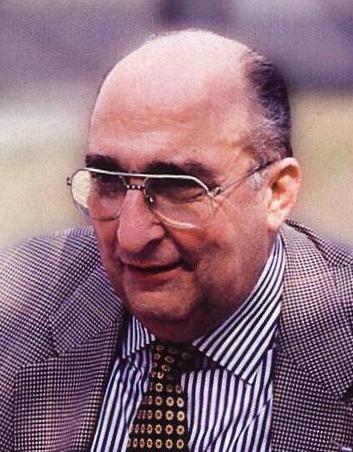
Delcroix Roger
Politique
Chercq 19/08/1928, Tournai 07/10/2010
Bourgmestre de Tournai de 1992 à 2001, Roger Delcroix avait entamé sa carrière politique tardivement, après avoir exercé une importante activité syndicale. À la tête de la Cité aux Cinq Clochers comme échevin puis comme bourgmestre durant le dernier quart du XXe siècle, il a été le moteur du renouveau touristique de Tournai.
Né dans l’Entre-deux-Guerres, dans un milieu ouvrier déjà actif dans le mouvement syndical, Roger Delcroix grandit dans l’atmosphère de la Maison du Peuple de Tournai, dont ses parents sont les tenanciers, avant de connaître la guerre et les destructions importantes subies par Tournai lors du second conflit mondial.
À la Libération, le tout jeune Delcroix travaille à la caisse du service chômage de la FGTB où il est agent payeur. Dans le sillage de Henri Castel principalement, Roger Delcroix remplit plusieurs fonctions au sein de l’organisation syndicale socialiste : chef de service administratif, responsable de la réorganisation des régionales de Namur et Luxembourg en matière de services chômage, permanent de la section tournaisienne de la CGSP, il est successivement secrétaire régional, secrétaire général et finalement président de la CGSP Tournai. Président de la régionale FGTB Tournai-Ath-Lessines (jusqu’en 1992), il accorde beaucoup d’attention à la construction du Panoramique (au Mont-Saint-Aubert).
Sollicité par le PSB en raison de son activité et de sa popularité, il finit par accepter de se présenter au suffrage des électeurs. En octobre 1976, au moment de la fusion des communes et de l’émergence du « grand Tournai », il est élu conseiller communal et d’emblée est propulsé à un échevinat aux côtés de Raoul Van Spitael. En charge des Finances communales, du Tourisme et des Fêtes publiques, Roger Delcroix est particulièrement complémentaire au bourgmestre. Quand ce dernier décide de se consacrer exclusivement à sa charge maïorale, il laisse à Roger Delcroix son fauteuil au Sénat.
Sénateur provincial du Hainaut, Delcroix siège à la Haute Assemblée de 1981 à 1986, période durant laquelle le PS est dans l’opposition. En tant que sénateur provincial, il n’a pas le droit de siéger dans les assemblées fédérées. De surcroît, en 1986, les statuts du PS lui interdisent de cumuler son mandat d’échevin de grande ville et mandat parlementaire. Optant pour Tournai, il contribue à consolider les résultats socialistes (1982 et 1988) et, en tant qu’échevin, puis Premier échevin (à partir de 1989), s’occupe essentiellement du Tourisme et des Fêtes publiques.
Au décès de Raoul Van Spitael (28 août 1992), il lui succède dans le fauteuil maïoral, obtenant la confirmation de l’électeur en octobre 1994 (7.502 vp., soit davantage que son devancier) ; la coalition entre socialistes et libéraux est encore reconduite. Président de l’Intercommunale de Développement économique Ideta, Roger Delcroix s’efforce de développer une politique pragmatique et sociale à Tournai comme à l’ensemble du territoire qui prendra le nom de Wallonie picarde. Son empreinte se marque surtout dans la mise en valeur du patrimoine et dans la mise en place d’infrastructures permettant au tourisme d’être aussi un acteur économique. En 2001, Christian Massy lui succède, au moment où il se retire de la vie politique active.
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
http://www.tournai.be/fr/actu/index.php?page=356 (s.v. décembre 2014)
L'Histoire du Sénat de Belgique, Bruxelles, Racine, 1999, p. 394
Memento politique 1985, Bruxelles, Le Vif, 1985
Mandats politiques
Conseiller communal de Tournai (1976-
Echevin (1977-1992)
Sénateur provincial (1981-1986)
Bourgmestre (1992-2001)
Paul Delforge
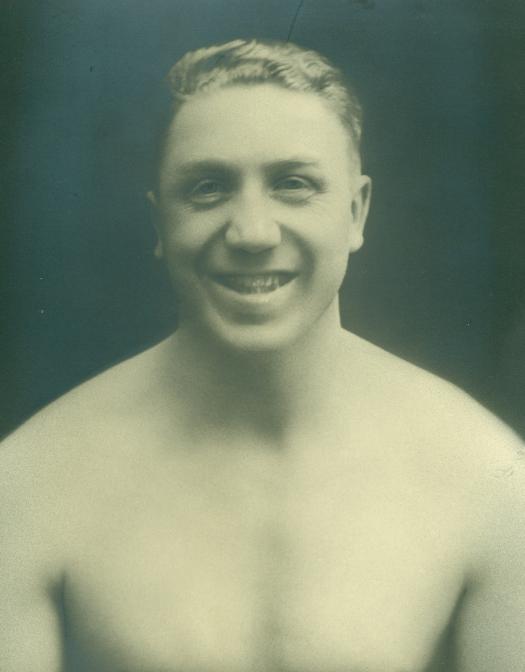
Delarge Jean
Sport, Boxe, Olympisme
Liège 27/01/1906, Liège 1977
Le monde de la boxe en Wallonie connaît une période faste dans l’Entre-deux-Guerres. Plusieurs titres de champions d’Europe sont décrochés chez les professionnels ; les noms de Henri Hebrans, Fernand Delarge, Alfred Genon, François Sybille, Pierre Charles, Nicolas Petit-Biquet, Phil Dolhem sont alors aussi connus que celui de Kid Dussart. Mais c’est un jeune amateur qui retient toute l’attention : déjà champion de Belgique 1923 et 1924, le jeune Jean Delarge s’impose en finale des Jeux olympiques de Paris, dans la catégorie des poids Welter, et décroche ainsi une médaille d’or (juillet 1924). Il est ainsi l’un des quatre Wallons, en épreuve individuelle, à avoir inscrit ce résultat à son palmarès.
Passé professionnel dès 1925, comme son frère Fernand (1903-1960), Jean Delarge ne parviendra cependant pas à confirmer sa performance olympique. Quand il raccroche ses gants en 1930, après une défaite par KO devant Larry Gains, il n’a pas réussi à ajouter de nouveaux titres significatifs à son palmarès (6 victoires en 12 combats). Mais sa médaille d’or ne se suffit-elle pas à elle-même ?
Sources
Théo MATHY, Dictionnaire des sports et des sportifs belges, Bruxelles, 1982, p. 70
http://boxrec.com/media/index.php?title=Human:53295
http://boxrec.com/list_bouts.php?human_id=53295&cat=boxer
Paul Delforge

Dejardin Joseph
Politique
Grivegnée 21/03/1873, Beyne-Heusay 28/10/1932
Député, président de la Centrale nationale des Mineurs et président de la Fédération internationale des Mineurs, Joseph Dejardin est une figure marquante du mouvement ouvrier au tournant des XIXe et XXe siècle.
Septième d’une famille ouvrière de onze enfants, Joseph Dejardin a sa destinée toute tracée ; son père et sa mère travaillent à la mine ; comme ses frères et ses sœurs (dont Lucie, futur députée), il sera aussi mineur. À peine scolarisé, il veut cependant les conditions de vie qui leur sont imposées et s’engage résolument dans l’action syndicale et politique en train de se structurer avec difficultés ; les réticences à vaincre sont autant chez les ouvriers que du côté du pouvoir en place. En 1889, alors qu’il distribue le journal Le Populaire, Joseph Dejardin est arrêté et accusé de fomenter des troubles. Avec détermination, il œuvre à la structuration du mouvement ouvrier socialiste, tant par la création et l’animation de structures syndicales, politiques, coopératives que mutuellistes.
S’appuyant sur la Charte de Quaregnon, il fait du suffrage universel l’objectif prioritaire, tout en menant des luttes pour l’amélioration des conditions de travail (salaire, temps de travail, sécurité). En 1904, il se présente au suffrage universel tempéré par le vote plural des hommes de l’arrondissement de Liège et est élu au conseil provincial de Liège. Il quitte cette assemblée en décembre 1909, pour remplacer à la Chambre le député P. Smeets décédé. Il sera par la suite régulièrement élu à la Chambre jusqu’en 1932. En octobre 1912, Joseph Dejardin figure parmi les membres-fondateurs de l’Assemblée wallonne créée à l’initiative de Jules Destrée quelques semaines après sa Lettre au roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre. Il y représente l’arrondissement de Liège, mais ne développe pas d’action particulière au sein de ce Parlement wallon informel.
Conseiller communal élu à Beyne-Heusay en 1903, échevin à partir de janvier 1908, Dejardin fait fonction de bourgmestre au lendemain du scrutin d’octobre 1911. Comme de nombreux autres « candidats » bourgmestres socialistes en Wallonie, il se heurte au refus du ministre de l’Intérieur de nommer des mandataires qui professent des opinions républicaines. Il reste par conséquent échevin, faisant fonction de bourgmestre. Mais son comportement déterminé lors de l’invasion allemande d’août 1914 élimine les querelles « politiciennes » et le gouvernement belge s’empresse de le nommer officiellement le 20 septembre 1914. Il exercera ses fonctions maïorales jusqu’en 1921. Durant les années allemandes de 14-18, il veilla au ravitaillement et à la sécurité des habitants de sa commune et de Liège. Sa résistance larvée lui est reprochée par les autorités d’occupation : appelé à comparaître devant le Tribunal militaire de Liège, il lui est reproché un mot injurieux en allemand sur une affiche publique. Plaidant ne pas connaître la langue de Goethe, Dejardin est condamné à deux ans de travaux forcés par le président Rauh, et il est déporté en Allemagne entre décembre 1916 et mars 1917 (Mallieux).
Ces succès électoraux, Joseph Dejardin les doit en grande partie à son intense activité syndicale. Multipliant les initiatives (réunions, meetings, publications, etc.) pour rassembler les travailleurs au sein de structures défendant leurs intérêts, il met en place un syndicat des mineurs dont la puissance dépasse le bassin houiller liégeois. De responsable liégeois (président du syndicat des Mineurs avant 14), il devient, en 1919, le leader national de la Centrale des Mineurs qu’il avait contribué à faire naître. Internationaliste – il exerça la présidence de l’Internationale des Mineurs –, il plaide très tôt (un congrès syndical en 1901) en faveur d’une action syndicale concertée au plan international : l’objectif est alors la conquête de la journée de huit heures. Son expertise est appréciée et reconnue. Elle est notamment saluée lors des Conférences internationales du Travail de 1930 et 1931 où ses interventions contribuent à l’élaboration des textes définitifs (durée du travail dans les mines). Vice-président de la Fédération internationale des Mineurs, il venait d’être désigné à la présidence lors du congrès de Londres, en septembre 1932, quand la maladie a raison de lui. Ses funérailles furent quasiment nationales.
Sources
Paul DELFORGE, L’Assemblée wallonne 1912-1923. Premier Parlement de la Wallonie ?, Namur, Institut Destrée, janvier 2013, coll. Notre Histoire, p. 234
Paul VAN MOLLE, Le Parlement belge 1894-1972, Ledeberg-Gand, Erasme, 1972, p. 80
Le mouvement syndical belge, 20 novembre 1932, p. 259
À la mémoire de Joseph Dejardin, Député…, Cuesmes, imp. fédérale, s.d.
Moniteur belge, 20-21-22 septembre 1914, p. 5297
Archives Fernand Mallieux, récit, p. 14
Mandats politiques
Conseiller communal de Beyne-Heusay (1903-1932)
Conseil provincial de Liège (1904-1909)
Echevin (1908-1912)
Député (1909-1932)
Bourgmestre faisant fonction (1912-1914)
Délégué de Liège à l’Assemblée wallonne (1912-1921)
Bourgmestre (1914-1921)
Paul Delforge

Dejardin Georges
Politique
Liège 14/06/1914, Liège 0/02/1993
Journaliste, militant socialiste, très tôt intéressé aux questions d’éducation et de culture, Georges Dejardin devient, le 7 décembre 1971, le premier président du Conseil culturel de la Communauté culturelle française de Belgique. Après la révision de la Constitution de décembre 1970, il s’agit de l’une des premières nouvelles assemblées politiques à se mettre en place.
Issu d’une famille plongée dans le mouvement socialiste, Georges Dejardin y fait rapidement ses armes en tant que secrétaire national adjoint des Jeunes Gardes socialistes (1938-1940). Mobilisé au début de la Seconde Guerre mondiale, il se retrouve, comme de nombreux jeunes Wallons de sa génération, captif pendant les cinq années de guerre. À la Libération, il devient secrétaire national de la Centrale d'Éducation ouvrière (1945-1950), exerce comme journaliste et fait ses premiers pas en politique : conseiller communal de Liège (1946-1964), conseiller provincial (1946-1950), il est élu député de Liège en pleine Question royale. Non réélu en 1965, il est désigné comme sénateur provincial (1965-1968) puis est élu sénateur direct (1968-1974). C’est à ce titre qu’il est appelé à siéger au sein du Conseil culturel et qu’il est présenté par le PSB à la présidence (7 décembre 1971 - 15 octobre 1973). En 1976, il est l'un des 143 signataires de la Nouvelle Lettre au roi (29 juin), destinée à dénoncer l'extrême lenteur mise dans l'application de l'article 107 quater de la Constitution ; il plaide ainsi en faveur d'un fédéralisme fondé sur trois Régions : Bruxelles, Flandre et Wallonie.
Sources
Paul DELFORGE, Georges Dejardin, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 428
Paul VAN MOLLE, Le Parlement belge 1894-1972, Ledeberg-Gand, Erasme, 1972, p. 80
Mandats politiques
Conseiller communal de Liège (1946-1964)
Conseiller provincial de Liège (1946-1950)
Député (1950-1965)
Sénateur provincial (1965-1968)
Sénateur (1968-1974)
Paul Delforge
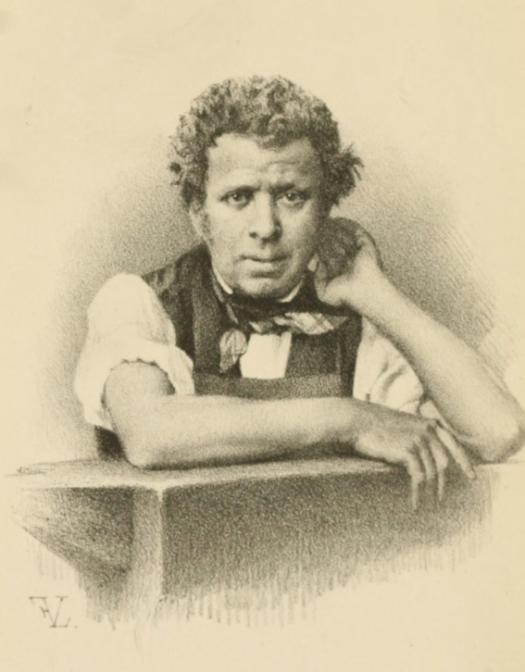
Dehin Jean-Joseph
Culture, Lettres wallonnes
Liège 21/10/1809, Liège 9/01/1871
« Type du poète-ouvrier » du XIXe siècle, Jean-Joseph Dehin est parvenu à améliorer sa condition sociale par son courage d’une part, par son talent d’écrivain d’autre part. Initié au métier de chaudronnier par son père, il s’applique dans le métier, avant de se lancer dans la ferronnerie/dinanderie dont il devient maître-artisan. Avec ses fils, il intervient sur de nombreux bâtiments de Liège, notamment la cathédrale, et il laisse quelques marques en wallon qui sont autant de signatures du maître Dehin.
Séduit très tôt par le prolifique chansonnier parisien Béranger (1780-1857), il enchante ses familiers par diverses chansons, avant d’élargir son auditoire : ses pasqueyes séduisent par leur bonne humeur, leur humour, voire surtout leur esprit gaulois. À la suite de Charles Duvivier de Streel, de Charles-Nicolas Simonon et de Henri Forir, Dehin devient au milieu du XIXe siècle le chansonnier liégeois le plus prisé. Sur des airs repris à Béranger, il apporte ses p’tits moumints d’plaisir dès 1845, où alternent cramignons gaillards, chants politiques, où déjà se dégage son talent de description des scènes populaires. Attaché à l’histoire liégeoise et se sentant le besoin de défendre des idées politiques, il dédie un poème historique au drame de Sébastien La Ruelle et dénonce l’exploitation des ouvriers (Les Rawettes, 1846).
S’il perdra quelque peu le ton incisif de ses premiers écrits, li mêsse tchödronî ainsi que Dehin signait ses premières publications reste marqué par la période liégeoise où s’affrontaient Chiroux et Grignoux et commet aussi une satire contre le flamand. Avec Fâves de Lafontaine, Dehin se lance dans d’excellentes adaptations wallonnes de l’écrivain français, transformant par exemple La cigale et la fourmi en un coq d’awous’ qu’aveût tchanté tot long l’osté. Poète dialectal, il apporte sa contribution à l’Almanach de Mathieu Laensberg dans les années 1850. En 1856, il fait partie des fondateurs de la Société de littérature wallonne et, parmi les nombreux bourgeois, il fait figure d’homme du peuple.
Sources
Maurice PIRON, Anthologie de la littérature dialectale (poètes et prosateurs), Liège, 1979, p. 132-141
Maurice PIRON, dans Biographie Nationale, t. 29, col. 525-530
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 125, 467-468
Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 64-65
Oeuvres principales
Les p’tits moumints d’plaisir, 1845
Les Rawettes, 1846
Châre et panâhe, 1850
Oûves complettes, 1850
Fâves de Lafontaine, 1850
Paul Delforge
