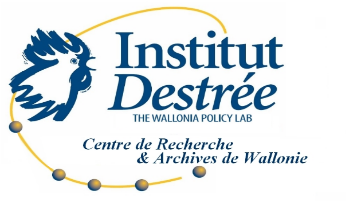Bia Lucien
Militaires
Liège 02/12/1852, Tenke 30/08/1892
Le nom de Lucien Bia est associé à l’histoire coloniale de la Belgique. Chef de l’expédition dite Bia-Francqui, il contribue à la découverte de l’immensité des richesses concentrées au Katanga et à la soumission de cette province au domaine de l’État indépendant, puis au Congo, jusqu’au bassin du Zambèze.
Natif de Liège, il n’a pas encore 18 ans quand éclate la guerre franco-prussienne de 1870. Dès la déclaration de guerre, il décide de s’engager au sein de l’armée belge, où il va accomplir toute sa carrière. Embrigadé dans la Cavalerie, il est en garnison à Liège, à Tournai, puis à Bruxelles. Lieutenant au 2e régiment des Guides, il s’engage pour l’Afrique le 15 mars 1887, destination Boma, avec la brigade topographique du Bas-Congo. La mission confiée à Lucien Bia consiste à marquer clairement la frontière Nord du Congo. Adjoint auprès de Van Kerchoven à Bangala, le militaire combat des bandes de trafiquants que l’on désigne habituellement comme arabes, commande les postes d’Issala, d’Upoto, puis de Yambinga et contribue à la mise sous tutelle belge de la région, notamment le commandant Pierre Ponthier. Agent politique auprès de Tippo-Tip (1889), Bia rentre en Europe (mars 1890), après cette première expédition réussie.
À Bruxelles, il attire l’attention du roi Léopold II sur les richesses que paraît renfermer la région du Katanga. Rapidement, à l’initiative de la « Compagnie du Katanga », société créée par la Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie, trois expéditions sont organisées, dont l’une est placée sous le commandement de Bia : cette fois, il doit s’employer au marquage de la frontière Sud. Surtout, son objectif est d’arriver avant les expéditions anglaises. Responsable de l’opération qui part de Lussambo le 10 novembre 1891, avec près de 600 « porteurs » africains, Lucien Bia est entouré d’Émile Francqui, son second, du professeur Jules Cornet, du docteur Eugène Derscheid et du médecin gantois Jules Amerlinck. L’expédition longe la rivière Sankuru, traverse le Lomami, le Kilubilui, le Lofoi et atteint le Lualaba, au lac Kabele qui est alors découvert. De Kalenga, l’expédition traverse la chaîne de la Mamika et fonce sur le Katanga, faisant son entrée à Bunkeia, le 30 janvier 1892. Les conditions de vie – privations, maladies, affrontements avec les tribus locales – déciment les rangs de l’expédition. En avril, afin de précéder une expédition rivale potentielle, Bia et Francqui entreprennent un raid vers le lac Moero, traversent la chaîne des Kundelungu à travers de vastes étendues de marais, et arrivent à Mogamba. Début juillet, le duo Bia-Francqui arrive au lac Bangwelo, avant de filer vers Chitambo (village où Livingstone trouva la mort). Fixant ainsi les frontières méridionales de l’État indépendant du Congo, l’avant-garde de l’expédition soumet les chefs locaux et arrive à Tenke le 4 août.
Malade depuis plusieurs semaines, exténué, Lucien Bia décède à hauteur de Tenke à la fin août 1892, alors qu’il s’apprêtait à repartir pour reconnaître la frontière orientale, le long du Luapula. L’officier wallon est enterré sur place (sur la colline Ditakata) et « sa tombe marque le point extrême atteint en Afrique par une expédition belge », écrira son second, Émile Francqui, appelé quant à lui à devenir Ministre d’État. À l’initiative de Jules Cornet, le nom de l’explorateur a été attribué à des monts ; Bia a aussi donné son nom à une chute d’eau, propriété de l’Union minière du Haut Katanga dans les années 1930. Son nom a aussi été attribué à la bialite, un minéral du Katanga (1949).
Sources
Musée de Tervueren, Archives Cornet
Henri BUTTGENBACH, dans Biographie coloniale belge, Bruxelles, 1951, t. II, col. 58-62

Behr Frédéric-Louis
Socio-économique, Entreprise
Maastricht 1805, Liège 09/02/1863
L’existence d’une extraction de charbon à hauteur de Seraing est attestée depuis le XVIe siècle ; son propriétaire abandonne cependant le site à la suite des événements de 1789 et on enregistre une reprise sous le régime français vers 1795. Le 25 juillet 1811, est créée la Société charbonnière de la Nouvelle Espérance, détentrice de la concession de Hinchamps.
En 1825, un important investissement est consenti avec l’installation d’une pompe à vapeur afin de favoriser l’exhaure des eaux, tandis qu’une autre machine sert à l’extraction : dès 1829, la cote de -400 mètres est dépassée. C’est à cette époque, en 1828 précisément, que Frédéric-Louis Behr – couramment appelé Fritz Behr par ses contemporains – entre dans la société, avec son frère Charles (1799-1853), en apportant un important capital ; rapidement, il va en prendre le contrôle. Ainsi commence une ère de prospérité exceptionnelle pour une des plus importantes sociétés métallurgiques wallonnes, l’Espérance-Longdoz.
Présenté comme un « (…) descendant de la ligne directe du baron Adam Behr (1629), chambellan de Gustave-Adolphe, roi de Suède », fils du général Frédéric-Louis Behr, de religion protestante, ce natif de Maastricht, alors chef-lieu du département français de la Meuse inférieure, accomplit de brillantes études à l’Université de Liège. Bien qu’il se voit offrir une chaire de professeur au terme de son doctorat en Droit, Fr-L. Behr est davantage attiré par l’industrie et la politique, décline l’offre du gouvernement et se lance dans les affaires.
Co-fondateur de la Société du Charbonnage d’Ougrée avec ses deux frères, Jacques-Louis et Charles-Frédéric (1829), Frédéric-Louis Behr acquiert, toujours en 1829 et avec son frère Jacques et les frères Michiels, la moitié des parts d’un des concessionnaires de l’Espérance (soit près de 15%), tandis que la société ouvre un nouveau siège, celui de Morchamps ; il sera bientôt relié par une voie ferrée au site d’Hinchamps. Les circonstances sont cependant défavorables : la Révolution de 1830 a comme conséquence la fermeture du marché « hollandais », tandis que la concurrence des charbons anglais et prussiens s’accentue. Prenant exemple sur leurs voisins, les Cockerill, les dirigeants de l’Espérance décident de valoriser leur charbon en faisant construire un four à coke (1834). Avec John Cockerill d’ailleurs, les frères Behr fondent la SA des Charbonnages et Hauts Fourneaux d’Ougrée (1835), mais surtout, le 27 juillet 1836, avec le concours de la Banque de Belgique, Fritz Behr franchit une nouvelle étape dans le développement de ses activités : en transformant le charbonnage liégeois en Société anonyme des Charbonnages et Hauts-fourneaux de l’Espérance, il se place sur les marchés de l’exploitation charbonnière, de la production de coke et de fonte, et de la fabrication métallique.
Sous la direction de Frédéric-Louis Behr, la nouvelle société ouvre deux hauts fourneaux en 1838 et 1839 et introduit d’importantes innovations. Les besoins en charbon nécessitent une extension de la concession que refusent les concurrents de Marihaye et des Six-Bonniers ; en 1840, une importante concession est accordée sous les communes d’Alleur, Rocourt et Voroux-les-Liers ; en 1853, un troisième site d’extraction est ouvert, baptisé « Fanny », le prénom de l’épouse de Fr-L. Behr. Au milieu du XIXe siècle, la société de l’Espérance s’est imposée comme l’un des principaux fournisseurs de coke. En rachetant la fabrique de fer blanc Dothée et Cie, elle développe le secteur de l’affinage de fonte produite en masse. Effectué quelque mois avant la disparition de Fr-L. Behr, cet investissement permettra à la Société de pallier l’épuisement des veines carbonifères et de se positionner, par la suite, dans la fabrication exclusive de produits laminés. Au moment de sa disparition, Behr laisse à ses successeurs une unité de production totalement intégrée et un véritable complexe sidérurgique en devenir : en 1877, la Société anonyme métallurgique d’Espérance-Longdoz voit le jour, après avoir vendu tous ses charbonnages à la Société anonyme des Charbonnages de Marihaye.
À côté des importantes activités industrielles qui l’ont vraisemblablement épuisé, Fritz Behr s’est investi en politique, tout en siégeant activement à la Chambre de commerce de Liège (1848-1859). Installé à Seraing en 1837, il entre au conseil communal deux ans plus tard et y siège jusqu’en 1848, contribuant – notamment de ses deniers personnels – à l’amélioration de la voirie et à la création de l’école industrielle, bien qu’il ne partageât pas les idées de la majorité en place. Pendant une douzaine d’années, il préside aussi le Comité d’inspection des enfants trouvés et abandonnés du canton de Seraing. Co-fondateur et président de l’Association libérale de Seraing (1838-1863), il est aussi élu au Conseil provincial de Liège dès 1842 et reste en charge jusqu’à son décès, tout en étant membre de la Députation permanente depuis 1860. Apprécié pour ses connaissances, son esprit d’entreprise et commercial, pour son aisance oratoire et ses qualités d’écriture, Fr-L. Behr est désigné par le gouvernement belge lorsque les négociations du traité de commerce avec le Zollverein entrent dans une phase décisive. La contribution du « chargé d’affaires » est appréciée par les deux parties, car Behr est nommé Chevalier de l’ordre par Léopold, tandis que le roi de Prusse lui confère l’Aigle rouge.
Co-fondateur et premier président du « Comité de l’Association des Charbonnages de la province de Liège », aussi appelée « Union des Charbonnages liégeois » (1847-1860), vice-président de l’Association des maîtres de forges (1850-1863), vice-président de l’Association pour la défense du travail national (1856-1863), il prend également une part prépondérante dans la création du canal Liège-Bois-le-Duc via Maastricht sa ville natale ; au-delà du rapport qu’il rédige en 1845, il participe personnellement à toutes les réunions nécessaires pour promouvoir un projet qui lui tient autant à cœur que le développement des voies ferroviaires.
Ses funérailles, organisées conjointement par les autorités communales de Liège et de Seraing, furent suivies par une foule particulièrement nombreuse, composée des ouvriers de ses usines et de badauds, en présence de la plupart des financiers et industriels, des principales personnalités politiques de la province et de la ville, ainsi que par le gouverneur de la Banque nationale. Le cortège a conduit le défunt du quartier de Longdoz jusqu’au cimetière communal de Seraing.
Sources
La Meuse, 12 février 1863
Suzy PASLEAU, Industries et populations : l’enchaînement des deux croissances à Seraing au XIXe siècle, Genève, Droz, 1998, coll. Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, fasc. CCLXXV, p. 72
Mémorial de la Province de Liège, 1836-1986, Liège, 1987, p. 173
Arrêté royal du 13 janvier 1840, dans Pasinomie, Bruxelles, 1840, p. 105-106.
Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 218
Claude GAIER, Huit siècles de houillerie liégeoise, p. 205
Léon WILLEM, 450 ans d’Espérance. La S.A. métallurgique d’Espérance-Longdoz de 1519 à 1969, Liège, éd. du Perron, 1990, Technologie et tradition industrielle, p. 26-46
Hervé DOUXCHAMPS, La famille Lamarche. Des Xhendremael-Coninxheim à l’industrie liégeoise, Bruxelles, Office généalogique et héraldique de Belgique, 1974, p. 148
Annuaire statistique et historique belge, Bruxelles-Leipzig-Gand, 1864, p. 317
https://www.industrie.lu/SocieteMetallurgiqueEsperanceLongdoz.html (s.v. décembre 2023)
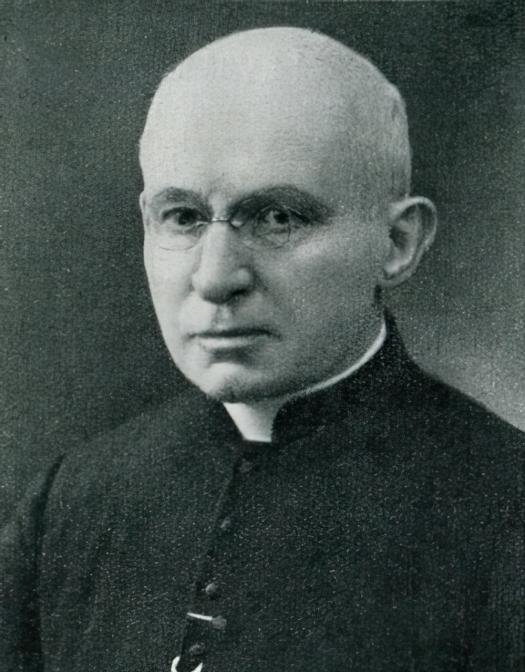
Bastin Joseph
Eglises, Militantisme wallon
Faymonville 08/12/1870, Malmedy 05/08/1939
« Il aimait avec fougue sa petite patrie. Il en étudiait passionnément la langue, l’histoire et les traditions, le sol, la flore et la faune, en un mot toutes les faces de la vie. Je ne puis énumérer ici ses nombreuses et très diverses publications. J’en rappellerai seulement deux. L’une a marqué son début magistral dans les études de dialectologie : le vocabulaire et la morphologie du parler de Faymonville ont illustré le nom de sa commune natale, que l’on trouve aujourd’hui maintes fois cité dans les revues savantes de France, d’Allemagne et de Suisse. L’autre marque le terme d’une carrière, hélas !, trop courte ; c’est un beau volume, paru (en 1939), sur les Plantes dans le parler, l’histoire et les usages de la Wallonie malmédienne ». Ainsi commence l’hommage prononcé par Jean Haust, lors des funérailles de l’abbé Joseph Bastin. Ce n’est là qu’un aspect de la vie mouvementée de celui qui fut prêtre, historien, dialectologue, archéologue, folkloriste, botaniste et un défenseur acharné de l’identité wallonne du pays de Malmedy.
Toujours le pays de Malmedy est au cœur de ses activités. Né à Faymonville, alors village prussien, il grandit dans un climat marqué par le Kulturkampf et la politique de germanisation du chancelier Bismarck. C’est dans le petit village de Rodt (près de Saint-Vith) que Bastin apprend le français, à l’abri des regards, auprès de l’instituteur Jules Koch. À partir de 1884, il franchit la frontière pour effectuer ses études secondaires à Stavelot, à l’Institut Saint-Remacle, avant d’achever ses humanités à Saint-Trond (1889), où il suit ensuite les cours du petit séminaire (1889-1891). De 1891 à 1894, il termine sa formation au Grand Séminaire de Liège et, le 15 avril 1895, il est ordonné prêtre. Professeur à l’Institut Saint-Remacle de Stavelot (1894-1907), il y dispense les cours de latin et de grec, d’histoire, de français, d’allemand et de botanique ; en 1906, il devient le préfet de l’externat.
Parallèlement, Joseph Bastin se passionne pour la nature – il constituera toute sa vie des herbiers de qualité –, ainsi que pour la littérature française et les parlers de l’est-wallon. La politique de germanisation du pouvoir prussien renforce ses centres d’intérêt. Dans la maison familiale, à Faymonville, il constitue une bibliothèque de livres en français ; d’autre part, il offre ses services à Jean Haust, lorsque la Société liégeoise de Littérature wallonne entreprend son projet de Dictionnaire général de la Langue wallonne (1904). Correspondant pour la Société liégeoise dans la région de Stavelot, l’abbé Bastin est récompensé pour son premier Glossaire de Faymonville-Weismes (Médaille d’or, 1907), publié par la suite dans le Dictionnaire, ce qui l’encourage dans ses recherches.
Mais l’abbé de Faymonville puis de Burnenville (1897-1907) connaît des problèmes avec l’évêché de Liège : en raison de son refus d’appliquer une nouvelle grammaire française, il est destitué de ses fonctions d’enseignant (1907). Franchissant à nouveau la frontière, il obtient, de l’évêché de Cologne, d’être désigné dans une cure à Thirimont (Ondenval). Ses nouvelles fonctions lui donnent davantage de temps pour ses recherches, ainsi que pour mener une action en justice, côté belge, contre sa destitution : au tribunal, il obtient gain de cause. La décision est heureuse car, cette fois, c’est en Wallonie prussienne qu’il connaît des problèmes en raison de son catéchisme en langue française ; contesté par quelques paroissiens, il est contraint de quitter la cure d’Ondenval ; il apporte son aide au curé de Waimes (1909), tout en poursuivant ses enquêtes dialectologiques, mais surtout, il est désigné comme professeur au Collège Saint-Joseph à Dolhain-Limbourg (1909). Il est vrai que les difficultés rencontrées par l’abbé trouvent aussi leur origine dans son engagement en faveur de l’identité wallonne du pays de Malmedy.
Chroniqueur pour l’hebdomadaire malmédien La Semaine (1904-1914), il signe volontiers d’un pseudonyme provocateur, Pol Wallon (trad. : pour le wallon). À partir de 1908 et jusqu’en 1914, il contribue aussi à l’Armonac wallon do l’Samène. Ce sont là des occasions de publier des articles sur le dialecte ou l’histoire locale, notamment sur les paroisses de la Wallonie prussienne. À travers eux, l’abbé développe un discours et adopte des attitudes qui sont autant de protestation à l’égard du régime impérial. Le fait de hisser le tout nouveau coq wallon, rouge sur fond jaune, lors de la consécration de la nouvelle église de Faymonville par l’évêque auxiliaire de Cologne (août 1913), n’a rien d’anodin.
Son influence dans la région de à Malmedy n’a pas échappé aux autorités prussiennes ; dès les premiers jours de la Grande Guerre, le 26 août 1914, il est arrêté à Stavelot, emmené à Malmedy, avant d’être envoyé en résidence surveillée à Düsseldorf, avec le statut de personne politiquement dangereuse. Dans la ville rhénane, il profite de ses « loisirs » forcés pour compulser les archives relatives à la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy. Libéré au printemps 1915, il retourne dans la région de Waimes. Ses recherches, des promenades, les messes et des rencontres avec l’abbé Pietkin constituent « ses journées d’occupation ». Dès la proclamation de l’Armistice, il retrouve Henri Bragard à Malmedy et, ensemble, ils militent pour la réintégration de la Wallonie malmédienne dans le pays roman : Adresse au roi Albert, articles de presse, conférences, interventions multiples. Les Wallons de Malmedy sont soutenus tant par les partisans d’une « Grande Belgique » que par l’Assemblée wallonne, mais aussi par le « Comité des Malmédiens et Liégeois réunis », voire par les voisins de Stavelot, les membres des cercles culturels, comme la Société liégeoise de Littérature wallonne.
Dès le 1er mars 1919 paraît, en français, La Warchenne, hebdomadaire portant en sous-titre « La Wallonie aux Wallons ». Membre suppléant (de Henri Bragard) à l’Assemblée wallonne, en tant que représentant de Malmedy (1919), l’abbé Bastin – auquel on a interdit de célébrer la messe dans le diocèse de Cologne – repasse du côté belge de la frontière : à Stavelot, il prend la direction de la rédaction du journal La Warchenne, tout en retrouvant une place de professeur à l’Institut Saint-Remacle. Sa contribution au mouvement « irrédentiste » est déterminante. Le traité signé à Versailles le 28 juin attribue à la Belgique les cercles d’Eupen et de Malmedy, sous réserve du résultat d’un référendum à organiser dans les six mois. Sous le Haut-Commissariat du général Baltia, le « référendum négatif » entérine l’article 34 de Versailles. Avec Henri Bragard et l’abbé Pietkin, l’abbé Joseph Bastin apparaît alors comme l’un des principaux protagonistes de l’annexion du canton roman de Malmedy à la Wallonie.
Sollicité de toutes parts, il donne des conférences et publie maints articles dans les revues amies. Éphémère éditeur de La Warche (mai à octobre 1920), il continuera d’écrire dans Warche et Amblève, qui paraît jusqu’à la fin du gouvernement Baltia (1923-1925), défendant notamment le nouveau statut face aux critiques de la presse germanophile. Entre-temps, l’abbé Bastin a reçu de nouvelles responsabilités : l’ancien progymnase allemand est devenu l’Athénée de Malmedy. Chargé de la direction de l’internat (1920-1933), l’abbé Bastin est ensuite nommé, par le ministre Jules Destrée, professeur de religion catholique, fonction qu’il exerce jusqu’à son décès (1920-1939).
Membre du Club wallon de Malmedy (1901), membre de l’Assemblée wallonne (1919-1939), délégué de Malmedy au Comité de la Ligue wallonne de Verviers (1919), membre du comité d’honneur du premier Congrès culturel wallon (Charleroi 1938), membre de la Société de Littérature wallonne depuis 1911, membre correspondant de la Commission des Monuments et des Sites (1921), vice-président de la Commission du Folklore (1921) qui publie dès 1922 Folklore Eupen–Malmedy–Saint-Vith, membre de la Société de Botanique de Belgique (1925), membre de la Commission de Toponymie et Dialectologie (dès la fondation en 1926), l’abbé Bastin publie régulièrement et un peu partout le résultat de ses enquêtes : « son œuvre est abondante et dispersée au point de défier les bibliographes les plus intrépides », souligne Maurice Piron. Élu membre de l’Académie de Langue et de Littérature françaises, le 9 avril 1938, sur la proposition de Jean Haust, il y avait été reçu solennellement le 10 juin 1939. Deux mois plus tard, cependant, la mort l’emportait, sans qu’il ait le moindre apaisement face à la montée de l’hitlérisme.
Sources
Guy LEJOLY, L’abbé Bastin. 1870-1939. Chantre de la Wallonie malmédienne. Sa vie. Son œuvre, Malmedy, éd. Malmedy-Folklore, 2014
Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 122-123
La Vie wallonne, mai 1931, CXXIX, p. 381-399 ; 15 septembre 1939, CCXXIX, p. 5-15 ; 1947, n°238, p. 188-190 ; IV, 1959, n°288, p. 265-272 ; I, 1969, n°325, p. 38-53 ; III-IV, 1970, n°331-332, p. 550
La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. III, p. 28-30 ; t. IV, p. 238

Audent Jules
Politique
Charleroi 06/06/1834, Charleroi 06/10/1910
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le bourgmestre Jules Audent trace le nouveau paysage urbanistique de Charleroi. Transformant la petite cité embastillée en une ville moderne du XXe siècle, il la dote de tous les instruments indispensables à son développement industriel.
Après le Collège de Charleroi, l’Athénée de Bruxelles et l’Université de Liège, Jules Audent entre au barreau de Charleroi bardé d’un doctorat en Droit (1857), comme son père, avocat et par ailleurs ardent animateur des Journées de Septembre 1830 à Charleroi. Le jeune juriste s’y forge progressivement un nom, notamment dans les affaires civiles et, à huit reprises, entre 1871 et 1908, il sera appelé à la fonction de bâtonnier.
Attiré par la politique, en particulier par le programme du parti libéral, Jules Audent est élu conseiller communal de Charleroi, selon le suffrage censitaire (1863), avant d’accéder à un échevinat important, celui des Beaux-Arts et de l’Instruction publique (1873). Six ans plus tard, en 1879, ce libéral pragmatique et rassembleur au niveau local, succède à Charles Dupret comme bourgmestre de Charleroi, ville industrielle de 17.500 habitants, dont le développement est resté longtemps entravé par le carcan des remparts militaires. La désignation d’Audent met aussi un terme à une situation politique locale un peu compliquée, Charleroi naviguant dans le provisoire depuis quelques années.
Très tôt, Jules Audent a pris la responsabilité d’engager une réflexion sur la transformation profonde de sa ville. Concours, jury, négociations, élaboration de plans d’ensemble, recherche de moyens financiers mobilisent le jeune mandataire communal qui va devenir le principal artisan de l’urbanisation nouvelle de Charleroi. La destruction des vieux remparts ouvre de nouvelles perspectives et, tout au long de son quart de siècle de maïorat (1879-1903), le « leader carolorégien » fixe le cap et façonne la cité industrielle du XXe siècle, la dotant d’infrastructures à la mesure d’une métropole : boulevards, parcs publics, distribution d’eau, système d’égout, abattoir, palais de justice (1880), bourse de commerce (1892), sans oublier les implantations scolaires – du primaire au secondaire, voire en passant par le « maternel », le technique et le professionnel – qu’il avait lancées lorsqu’il était échevin. Le 1er juin 1889, le boulevard Central – construit dans la ville haute – est baptisé boulevard Audent pour le 25e anniversaire de son entrée dans l’administration. Fin 1903, « le vieux mayeur » fait ses adieux à la vie communale et aux près de 30.000 habitants que compte désormais la métropole (soit 23.000 de plus que quand il entra au conseil communal).
Cofondateur de la Gazette de Charleroi (1878), Jules Audent exerce encore son mandat de sénateur, où l’avait poussé l’Association libérale de Charleroi. Fin 1891, il avait en effet accepté d’achever le mandat d’Émile Balisaux, décédé, et il siègera à la Haute Assemblée jusqu’en 1908, étant élu selon le nouveau suffrage universel tempéré par le vote plural. Libéral doctrinaire, disciple de Frère-Orban et de Jules Bara, hostile aux idées socialistes, il acceptera et encouragera l’idée d’un cartel anticlérical pour les élections de 1908, scrutin où il n’est plus candidat.
Dans son arrondissement, qu’il s’agisse de Charleroi, ou de Charleroi-Thuin, il jouit d’une popularité considérable, emportant par exemple, plus de 60 % des suffrages en 1894. Devant ses pairs, il n’aura de cesse de réclamer l’instauration du service militaire personnel et obligatoire. En attendant cette réforme, cet ardent défenseur de l’ordre public s’appuyait sur une garde civique locale qu’il voulait efficace. Il y eut recours lors des émeutes du printemps wallon de 1886 et plusieurs commentateurs de l’époque soulignent que les décisions du bourgmestre évitèrent que les débordements ne soient plus graves encore que ce qu’ils n’ont été.
Parallèlement à ses activités d’avocat et de mandataire public, Jules Audent était aussi administrateur de sociétés ; président de la Fabrique de Fer de Marchienne (1876, 1878) et du Charbonnage d’Ormont (1890-1892), il était administrateur des Forges de la Providence, des Charbonnages du Petit-Try à Lambusart et de la Banque de Bruxelles (1899-1909), et membre du conseil général de la Caisse d’Épargne et de Retraite (1894-1900).
Sources
Gazette de Charleroi, 7 octobre 1910
Joseph HARDY, Chroniques carolorégiennes inspirées des écrits de Clément Lyon, Charleroi, éditions Collins, (circa 1944), p. 133-139
http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=85 (s.v. mai 2016)
Jean-Pierre HENDRICKX, dans Biographie nationale, t. 39, col. 48-60
Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p 10-11
Mandats politiques
Conseiller communal de Charleroi (1863-1903)
Échevin (1873-1879)
Bourgmestre (1879-1903)
Sénateur (1891-1908)
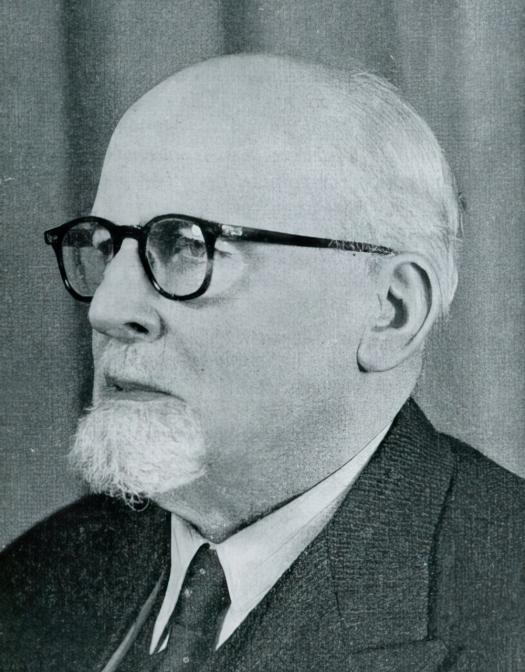
André Joseph
Culture, Architecture
Marbais 21/01/1885, Charleroi 21/01/1969
Depuis sa création en tant que place-forte en 1666, Charleroi connaît des transformations urbanistiques aussi considérables que régulières. Ainsi, au XIXe siècle, tout ce que les « Hollandais » ont construit entre 1816 et 1821 est démoli cinquante ans plus tard. Sous le maïorat de Jules Audent, à la place des remparts démembrés et des ravins comblés, un plan d’ensemble ambitieux fusionne Ville-Haute et Ville-Basse. Après la Grande Guerre, une nouvelle étape est franchie quand les liens avec le « Faubourg » (Charleroi Nord) confèrent à la cité un statut de métropole industrielle : sous les maïorats de Joseph Tirou et Octave Pinkers, souvent qualifiés de bâtisseur, un architecte imprime alors sa marque pour le restant du XXe siècle : Joseph André.
Au lendemain de l’Armistice, il faut d’abord reconstruire. Joseph André s’y emploie en respectant les styles souhaités par ses commanditaires. Trois bâtiments spectaculaires – le cinéma Coliseum (1923), la Maison des Corporations (inaugurée en 1925 et détruite en 1960) et le nouvel immeuble du Grand Bazar (1933, détruit en 2014) – témoignent de la capacité de l’architecte à réaliser des édifices d’importance. Après le retrait de l’architecte Jules Cézar, les autorités locales autorisent André à achever seul la construction du nouvel l’hôtel de ville, sur la place Charles II (1936), vaste complexe dominé par un beffroi ; l’aménagement de la Ville-Basse, avec son boulevard recouvrant un bras de la Sambre et ses « Nouvelles Galeries » place Albert Ier, modèle ensuite le centre-ville, pour quelques années (de 1954 à 2015). Du côté de la Ville-Haute, posé sur plusieurs centaines de pieux Franki, le Palais des Expositions émerge sur les terrains vagues d’un terril, en 1954, et accueille d’emblée une brève Exposition internationale technique et industrielle ; trois ans plus tard, non loin de là, Joseph André achève le Palais des Beaux-Arts, où il a confié la décoration intérieure à des artistes principalement wallons : Pierre Paulus, René Magritte, Georges Grard, Olivier Strebelle et René Harvent, ainsi qu’à Ossip Zadkine. En 1957, encore, l’église Saint-Christophe vient compléter la place Charles II, avec des vitraux réalisés d’après des cartons de Jean Ransy. En 1960, le Conservatoire de Musique, puis un complexe sportif constituent les dernières signatures principales à Charleroi d’un architecte fort sollicité aussi dans la périphérie (maisons particulières, immeubles industriels et administratifs, églises, etc.). Son style fluctue en fonction des époques et des commandes ; s’il se plie aux principes de l’Art Déco ou du Moderniste, il le fait en modérant l’ostentation, en restant classique dans une certaine mesure.
Une contribution aussi spectaculaire à l’aménagement de la ville de Charleroi valut à Joseph André un hommage officiel des autorités (1958). Ce fut l’occasion de rappeler que le jeune Joseph André avait pris le goût du métier aux côtés de son père, maçon de profession, avant de se former à l’architecture à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1905-1908). Son mentor à l’Académie, le professeur Ernest Acker l’avait accueilli dans son bureau technique (1908-1910) et c’est là que Joseph André s’était penché sur les plans de l’exposition de Bruxelles. À partir de 1912, Charleroi devient son principal territoire d’activités. Maisons particulières et reconstruction précèdent l’occasion de son existence : Jules Cézar abandonne le chantier de l’hôtel de ville à Joseph André et donne ainsi une impulsion définitive à sa carrière.
Sources
Joseph HARDY, dans La Vie wallonne, I, 1960, n°289, p. 32-46
La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. III, p. 372
Anne-Catherine BIOUL, dans Anne VAN LOO (dir.), Dictionnaire de l’architecture en Belgique, de 1830 à nos jours, Bruxelles, Fonds Mercator, 2003, p. 121-122
http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=388 (s.v. mai 2016)
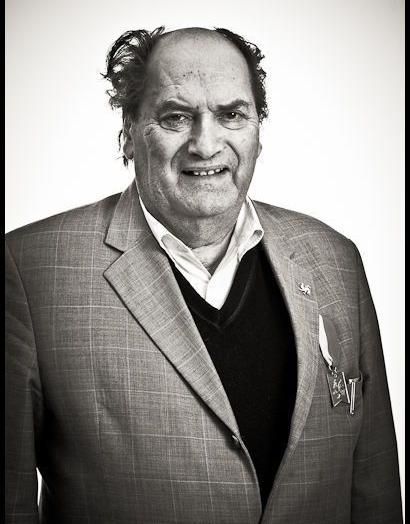
Louvet Jean
Culture, Théâtre, Militantisme wallon
Moustier-sur-Sambre 28/09/1934, La Louvière, 30/09/15
Écrivain, dramaturge du quotidien qui bouscule le « ronron » intellectuel, Jean Louvet puise la matière de ses écrits dans l’histoire et le vécu social de son pays wallon (grèves de 1932, drame de Courcelles, Congrès national wallon de 1945, Julien Lahaut, grèves wallonnes de l’hiver ’60-’61, etc.). Constamment, celui qui est professeur de français à l’Athénée de Morlanwelz (1958-1999) entend défendre, valoriser et faire reconnaître la culture en Wallonie.
Afin de donner un prolongement à la Grève contre la Loi unique, Louvet contribue à la création de la troupe du Théâtre prolétarien qui s’établit à La Louvière et se transforme en Studio-Théâtre, en 1980. Auteur dramatique engagé, il est l’un des promoteurs du Manifeste pour la Culture wallonne (1983) dont il soutient les principes dans la durée. En 2003, en effet, il contribue à la rédaction et signe le second Manifeste pour une Wallonie maîtresse de sa culture, de son éducation et de sa recherche et, depuis 2007, il préside le Mouvement du Manifeste wallon. Prix Bologne-Lemaire du Wallon de l’Année 2002, Jean Louvet reçoit en 2011 le titre d’Officier du Mérite wallon.
Sources
Paul DELFORGE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, 2001, t. II, p. 1047-1048
La Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 2005
La Wallonie à l’aube du XXIe siècle, Namur, Institut Destrée, Institut pour un développement durable, 2005
La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), Bruxelles, t. III
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de presse
Paul Delforge

Morreale Christie
Politique, Député wallon, Ministre wallon
Ougrée (Seraing) 14/06/1977
Députée wallonne : *2013-2014 ; 2014-2019 ; 2019* ; 2024-
Ministre wallonne : 2019-2024
En devenant à 26 ans la vice-présidente du PS, Christie Morreale fait une entrée remarquée sur la scène politique belge, d’autant que, dans la foulée, elle se voit décerner le titre de « Liégeoise de l’Année » par un tabloïd de la place de Liège. Symbolisant à la fois la volonté du président Elio Di Rupo de rajeunir son parti et de l’ouvrir davantage aux femmes, elle reste vice-présidente du PS d’octobre 2003 à 2011. Assurément, c’est une militante fervente qui exerce la fonction. Militante socialiste depuis 1993, membre des Jeunes socialistes, elle est la secrétaire de la section d’Ougrée. Chargée de présider le groupe de travail PS sur l’égalité hommes-femmes, elle prend position, à diverses reprises, dans des dossiers aussi sensibles que l’amélioration de l’encadrement de la prostitution, ou la place des homosexuels dans la société.
Diplômée de l’Athénée Air Pur à Seraing (1995), licenciée en Criminologie de l’Université de Liège (2000), Christie Morreale effectue des stages à la brigade des mœurs de la BSR de Seraing et participe à quelques préparations de l’émission « Au nom de la Loi », produite par la RTBf. Elle entre ensuite au Cabinet de Laurette Onkelinx, la vice-Première ministre en charge de la Justice, des Affaires sociales, du Travail et de l’égalité des Chances, au moment où est lancé le « Plan Rosetta » (2001). Elle planche alors sur le premier plan national de lutte contre les violences faites aux femmes, et sur la création d’un tribunal d’application des peines. Elle devient ensuite conseillère au sein de la cellule « pénitentiaire » (2003-2004), puis conseillère (2004-2009) auprès de Philippe Courard, ministre wallon en charge des Affaires intérieures et de la Fonction publique. Elle le suit comme chef de Cabinet adjoint (2009-2011) quand Philippe Courard devient Secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté dans les gouvernements fédéraux d’Herman Van Rompuy et d’Yves Leterme.
Sa première participation à une élection se déroule au scrutin régional wallon du 13 juin 2004. Sixième candidate, elle totalise 10.217 vp dans la circonscription de Liège : le PS y réalise un score historique (41,8%) et décroche 6 sièges. Avec le 6e score personnel, elle fait mieux que Patrick Avril, mais ce dernier, en tant que 4e effectif, bénéficie de l’effet dévolutif de la case de tête ; elle rate ainsi de peu son élection, Isabelle Simonis étant la seule femme élue (sur 6). Deux ans plus tard, à Esneux, lors des élections communales d’octobre 2006, elle pousse la liste emmenée par Jenny Levêque (627 vp) et rassemble 443 voix sur son nom (3e score PS), obtient le droit de siéger au Conseil communal (le PS est en recul, 25,5%, -1,4%), avant de siéger dans le Collège comme échevine. Ayant déménagé d’Ougrée à Esneux en octobre 2005 pour assurer la succession de Jenny Levêque, Ch. Morreale prend aussi les rênes du PS local à la veille d’un scrutin qui voit s’affronter quatre femmes pour le maïorat : J. Levêque et Ch. Morreale pour le PS, Marie-Dominique Simonet pour le cdH et Laura Iker pour le MR. Cette dernière met un terme à la coalition PS-cdH-Écolo et signe le nouveau pacte de majorité avec le PS (octobre 2006). Six ans plus tard, tête de liste socialiste, Ch. Morreale (1.398 vp) contribue à la remontée du PS (7 s., 29,4%, + 3,9%) et devient Première échevine. La coalition avec le MR (8 s., 31,1%, + 0,8%) de Laura Iker (1.390 vp) est en effet poursuivie, les deux formations politiques désirant conserver une collaboration soutenue par le vote des électeurs et dans « l’ordre mathématique » choisi par ceux-ci. Le sort des Prés de Tilff et celui du pont de Tilff constituent les dossiers les plus emblématiques de la législature locale.
Administratrice de la Sofico (2004-2009), de Solidaris (2007-2013), de la scrl SITEL (2009-2012) et d’Intradel (2007-2009, 2011-2012), Christie Morreale préside à ce moment l’intercommunale liégeoise de gestion des déchets (2009-2011), ainsi qu’UVELIA (2011-2012) et la SOFIE (2008-2019). Membre du comité de direction de la SPI (juin-octobre 2013), elle est aussi administratrice de l’Union des Villes et des Communes de Wallonie (2013-2017).
Vice-présidente du PS, elle est logiquement candidate à l’échelle du collège électoral francophone, occupant la onzième place des effectifs PS au Sénat, le 10 juin 2007 (25.405 vp), la 2e place des suppléants lors des toutes dernières élections directes du Sénat, le 13 juin 2010 (28.435 vp). Elle bénéficie alors de la désignation de Paul Magnette comme ministre au gouvernement fédéral pour occuper son siège au Sénat, à partir de décembre 2011, quand se forme le gouvernement Di Rupo, après 541 jours de négociations. Elle siège à la Haute Assemblée jusqu’en janvier 2013, moment où Paul Magnette quitte le gouvernement fédéral d’Elio Di Rupo pour exercer le maïorat à Charleroi. Candidate dans la circonscription de Liège au scrutin régional du 7 juin 2009, elle occupe alors l’avant-dernière et 12e place des suppléants et parvient à réaliser un score personnel (6.916 vp) qui la place en 5e position en cas de désistement des députés effectifs. Or, pour diverses raisons, Willy Demeyer, Julie Fernandez-Fernandez, Michel Daerden et finalement Maggy Yerna renoncent à leur mandat wallon et, comme Déborah Géradon préfère officiellement passer son tour, Christie Morreale fait finalement son entrée au Parlement wallon en octobre 2013, à quelques mois de la fin de la législature.
Lors du scrutin wallon du 25 mai 2014, cinquième effective sur la liste PS emmenée par Jean-Claude Marcourt, elle occupe une place de combat dans la circonscription de Liège. Avec 9.242 vp (4e résultat sur la liste du PS et 8e tous partis confondus), elle conquiert le dernier siège attribué au PS liégeois au Parlement wallon. Le 3 juillet, elle retrouve aussi le Sénat réformé, quand elle est désignée par le PS comme sénatrice représentant la Fédération Wallonie-Bruxelles ; par ailleurs, la Commission de vérification des pouvoirs du Sénat accepte son statut d’échevine en titre.
En mars 2015, avec Valérie De Bue, elle représente le Sénat lors de la 59e session des Nations Unies et présente à New York la synthèse d’un rapport sur l’égalité hommes-femmes en Belgique. En 2016, avec Valérie De Bue et Hélène Ryckmans, elle rédige un rapport de suivi sur la mise en œuvre de la Plateforme d’action de la quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes (Pékin). À Namur, la députée wallonne est membre de la Commission Affaires générales-Relations internationales (2014-2017), de la sous-Commission de Contrôle des licences d’armes (2014-2017), de la Commission économie-Innovations (2014-2017) et de la Commission pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (2015-2017). Elle siège aussi au sein de la Commission de Coopération avec la Communauté germanophone créée en mai 2015. Après le renversement de la majorité PS-cdH par le MR et le cdH à l’été 2017, elle devient membre de la Commission économie-Emploi-Formation (2017-décembre 2018), avant d’accéder à la présidence de la Commission Action sociale-Santé-Fonction publique (décembre 2018-2019). Outre ses très nombreuses questions écrites, la députée Morreale porte plusieurs textes de résolution dont l’un, avec Dimitri Legasse, qui vise à modifier les couleurs des écharpes scabinales dans les communes de Wallonie ; à partir du scrutin d’octobre 2018, les échevins portent désormais des écharpes aux couleurs rouge et jaune de la Wallonie (printemps 2016). Se mobilisant à diverses reprises pour favoriser la mobilité ferroviaire des zones rurales, elle ne parvient pas, par ailleurs, à empêcher la fin du Thalys wallon, en dépit d’une résolution adoptée par le Parlement wallon en mars 2016 et d’une autre visant à établir une stratégie ferroviaire wallonne. Affirmant son attachement à la construction européenne, elle préconise une politique économique européenne qui s’inspirerait du modèle portugais et elle fait partie des opposants au CETA, votant avec 58 autres députés wallons, en faveur du projet de motion qui valide le compromis par lequel l’Europe s’engage à prendre en considération les doléances wallonnes de manière contraignante lors de la signature et dans l’application du CETA, ainsi que dans tous les autres traités de nouvelle génération à venir (28 octobre 2016).
Très tôt dans la législature, la députée wallonne porte une proposition de résolution visant à condamner l’utilisation de tous les pesticides contenant des néo-nicotinoïdes, tueurs d’abeilles ; le texte « glyphosate » sera finalement adopté à l’unanimité, à l’automne 2017. Il s’agit là d’une partie du travail que mène Christie Morreale pour supprimer définitivement une série de produits dangereux et polluants (confettis et couverts en plastique, glyphosates, plastiques, etc.), pour favoriser la biodiversité et pour développer une politique ambitieuse en matière de qualité de l’air. Les aides à l’emploi sont un autre combat qu’elle porte avec insistance au Parlement de Wallonie, à l’instar du développement de l’économie circulaire, de la lutte contre les inégalités, de la défense de la parité et du droit des femmes. Bien avant l’affaire Weinstein et la mobilisation qui s’en est suivie, elle s’attèle à renforcer la législation pour lutter contre toutes formes de harcèlement, notamment sexuel dans les TEC, et contre toutes formes de violences conjugales et intrafamiliales. Avec Hélène Ryckmans, Véronique Bonni et Véronique Salvi, elle dépose une motion qui vise à « soutenir les centres de planning dans la distribution des contraceptifs d’urgence, même en l’absence d’un médecin ». Sensible à la question de l’intégration du handicap dans la société, elle promeut notamment l’accessibilité des chiens d’assistance dans les établissements et installations destinés au public. Durant la législature, elle adopte d’ailleurs une série de dispositions en matière de bien-être animal, compétence nouvellement transférée aux régions à la suite de la 6e réforme de l’État : avec le décret interdisant tout abattage animal sans étourdissement préalable (18 mai 2017) et le Code wallon du bien-être animal, projet porté par le ministre Di Antonio (3 octobre 2018), le législateur quasi unanime (67 sur 69) fait de la Wallonie une région pionnière.
Membre de la « Commission spéciale relative au Renouveau démocratique » dès sa création (mai 2015-2019), elle mène une réflexion sur les mesures de bonne gouvernance à mettre en œuvre au niveau régional ou local, visant notamment à améliorer tant la démocratie représentative que la démocratie participative. Elle suggère par exemple la prise en compte des votes blancs et nuls par l’envoi au Parlement d’un certain nombre de citoyens tirés au sort. à la suite des travaux de cette Commission spéciale, la Wallonie vote notamment deux décrets qui en font la première entité du pays à adopter le principe d’une consultation d’initiative citoyenne (2019). Cette consultation peut être organisée si une majorité simple des députés le décide ou si sont réunies au moins 60.000 signatures de citoyens belges et étrangers résidant en Wallonie.
En décembre 2017, la députée wallonne s’applique les mesures qu’elle préconise : elle renonce à son mandat d’échevine empêchée, annonce « choisir la Wallonie » et ne pas être candidate bourgmestre aux communales d’octobre 2018. Cela ne l’empêche pas de faire campagne. Elle lance d’ailleurs sur Esneux une grande « consultation citoyenne Esneux-Tilff 2018 » afin de composer rapidement la liste et d’en définir les objectifs, « en réinventant la politique ». Poussant la liste PS emmenée par Bernard Marlier, elle réunit 512 vp sur son nom, soit le deuxième meilleur résultat de sa liste. Bien que le PS perde 2 sièges et près de 9%, la coalition entre le PS (5) et le MR (8) de Laura Iker est reconduite, Christie Morreale siégeant comme conseillère communale.
Dauphine de Jean-Claude Marcourt sur la liste PS au scrutin régional wallon du 26 mai 2019, Christie Morreale réalise le 3e score de la circonscription de Liège, tous partis confondus (13.287 vp). Elle retrouve le Parlement de Wallonie, tout en étant à nouveau choisie comme sénatrice représentant la Wallonie. Cependant, elle ne va pas siéger longtemps comme parlementaire. Dès septembre, un accord de majorité est signé par le PS, le MR et écolo. Dans le gouvernement arc-en-ciel présidé par Elio Di Rupo, Christie Morreale devient l’une des vice-Présidentes, ministre en charge de l’Emploi, de l’Action sociale, de la Santé et de l’égalité des chances, ses matières de prédilection. Elle est entourée d’Anne Poutrain et Laurent Lévêque, ses chefs de Cabinet. Au Parlement de Wallonie, elle est remplacée par Laurent Léonard et au Sénat par Philippe Courard.
Présentée en septembre 2019, la Déclaration de politique régionale fixe des objectifs précis à la majorité arc-en-ciel, tout en accordant une égale importance aux préoccupations prioritaires des trois partis de la coalition : des réformes sociales pour le PS, économiques pour le MR et climatiques pour Écolo. La législature wallonne réserve cependant des événements inattendus : la crise sanitaire de la Covid-19, les inondations de juillet 2021, la guerre en Ukraine et la crise énergétique, sous oublier la mobilisation des agriculteurs et le remue-ménage autour des Pfas.
Alors que les premiers projets de la ministre Morreale se mettent en place et qu’elle planche sur une refonte majeure de l’action du Forem, la Covid-19 s’invite brutalement, forçant la responsable wallonne de la Santé à prendre une multitude de décisions de crise, dans l’urgence absolue, face à un phénomène pandémique inconnu. Alors que l’AViQ nouvellement créée ne parvient pas à répondre à toutes les sollicitations, un nombre considérable de circulaires partent sous la signature de la ministre, mesures de prévention et de sécurité, commande de masques, actions pour les maisons de repos, les hôpitaux, les titres-services, encadrement des personnels de soins, statut des APE en stand-by obligé, mise en place d’un traçage numérique, aides aux plus précarisés et aux indépendants en détresse, sans oublier le développement de l’application Coronalert. Au quotidien, pendant des mois, depuis son Cabinet ministériel, des directives sont données, des coordinations assurées, des budgets libérés, une communication assurée dans un souci de transparence et de pédagogie. Au sein du Comité de Concertation, Christie Morreale partage utilement ses retours de terrain avec Franck Vandenbroucke, le ministre fédéral. En juillet 2020, après la longue période de confinement, une Commission spéciale du Parlement de Wallonie est mise en place pour évaluer la gestion de la crise sanitaire par les autorités wallonnes ; et alors que la canicule impacte la mortalité de la Wallonie (août), l’occasion est ainsi donnée à la ministre de présenter son travail et de retirer des enseignements des 250 recommandations que propose le rapport final de la Commission (27 novembre 2020). D’ailleurs, le Plan Rebond est déjà d’application (automne 2020) quand survient la deuxième vague de la pandémie, accompagnée de nouvelles mesures restrictives et de reconfinement partiel, tandis que se profile un autre challenge important : l’organisation et la mise en place de la stratégie de vaccination. Dès le 29 décembre 2020, les premiers vaccins disponibles sont injectés, signes avant-coureurs d’une planification graduée, avec ouverture d’une cinquantaine de sites décentralisés, destinés à couvrir le plus rapidement possible toute la population (printemps 2021). Ces opérations menées promptement par la Wallonie se réalisent en collaboration avec l’Union européenne, ainsi qu’avec les autres entités fédérées et le niveau fédéral, via le Comité de concertation.
En mai 2021, après consultation des organisations syndicales et des responsables des secteurs du non-marchand liés à la santé et à l’action sociale, le gouvernement wallon décide d’un accord-cadre post-covid, dégageant 260 millions € par an pour améliorer les rémunérations et les conditions de travail des milliers de personnes travaillant dans les maisons de repos, l’aide à domicile, les établissements de travail adapté, le handicap, la santé mentale, l’accueil des sans-abri, etc. à la mi-juin 2021, une première dose de vaccin a été administrée à 70% de Wallons de plus de 18 ans, et 40% ont reçu la deuxième. Si la période estivale permet aux citoyens de sortir des mesures restrictives, la ministre prépare déjà la période automnale, une nouvelle vague de la Covid-19 se manifestant rapidement et sous une autre forme (omicron). Nommée à la présidence de la Conférence interministérielle des ministres de la Santé (septembre 2021-2022), la ministre wallonne organise les modalités d’administration de la 3e dose de vaccin, la réouverture de centres selon d’autres dispositions, et la mise en place du Covid Safe Ticket. Au quotidien, selon l’évolution de multiples paramètres, la ministre maintient son cap, tout en adaptant les moyens pour les atteindre. à partir de mars 2022, le Covid Safe Ticket est levé et, progressivement, les centres de vaccination ferment leurs portes. Affectés à d’autres missions ou retournant à leur métier d’avant pandémie, certains agents voient leur expérience professionnelle reconnue par des attestations de valorisation. La page de la crise de la covid-19 ne se referme pas totalement à l’aube des vacances d’été 2022 ; la surveillance épidémiologique est renforcée, les modalités d’une campagne de vaccination à l’automne 2022 et 2023 sont programmées et mises en place, tandis que la ministre ne cache pas souhaiter une vaccination obligatoire. Jusqu’à la fin de la législature, des dispositions sont prises pour prévenir tout retour pandémique.
En matière d’emploi, la ministre Morreale est chargée d’un objectif ambitieux, fixé par la DPR : atteindre un taux d’emploi de 68,7 % à la fin de la législature (+ 5 %). Dès 2019, le dispositif des aides à l’emploi APE – décidé par son prédécesseur P-Y. Jeholet – est reconduit pour deux ans, le temps de préparer, en concertation, une réforme plus profonde de ce dispositif qui finance 60.000 emplois dans le secteur non marchand et les pouvoirs locaux. Dès septembre 2020, elle présente sa réforme du dispositif APE ; le texte définitif est approuvé par le gouvernement wallon fin mars 2021. à partir du 1er janvier 2022, le système des points est supprimé, et un subside forfaitaire unique (mêlant rémunérations et aspects fiscaux) est désormais attribué à la trésorerie de plus de 4.000 employeurs concernés, dans tous les secteurs (crèches, écoles, action sociale, monde associatif, soins à domicile, sport, culture, ainsi que dans des projets à vocation sociale ou environnementale) où la Wallonie intervient, les APE relevant toujours de la politique wallonne de l’Emploi. Les secteurs d’affectation des APE sont définis en concertation avec les partenaires sociaux. Dès le printemps 2022, les contrats APE permettent à la Wallonie, dans le cadre du Plan de relance et de résilience européen et du Plan wallon de Relance, de soutenir la politique d’accueil de la Fédération Wallonie-Bruxelles : plus de 3.000 nouvelles places seront ainsi ouvertes dans les crèches à l’horizon 2026, via le Plan équilibre porté par les ministres wallonnes Christie Morreale et Valérie De Bue.
Fin juin 2020, la ministre de l’Emploi lance son projet de décret réformant le Forem. Il vise à améliorer et à personnaliser davantage l’accompagnement des demandeurs d’emploi, soit plus de 200.000 personnes en Wallonie. Avec un budget de près de 25 millions €, le plan TIM – Talents, Impulsion, Mobilisation – est le fil conducteur d’une réforme du FOREM qui doit prendre trois ans et accroître rapidement le taux d’emploi. Des augmentations sont décidées pour les aides familiales et les travailleurs du secteur des titres-services. Entre 2019 et 2023 se mettent en place trois Cités des Métiers, à Namur, Liège et Charleroi, autant de portes d’entrée unique pour l’orientation métiers et la formation. D’autres mesures – gratuité de la formation au permis de conduire pour certains demandeurs d’emploi ; Tremplin 24 mois+ ; organisation de « La Semaine de l’Emploi et de la Formation » ; programmes pour les NEETS, « Coup de Poing Pénurie », soit un incitant financier aux personnes se formant aux métiers en pénurie, etc. – sont décidées par la ministre wallonne de l’Emploi ; elles complètent un dispositif où le forem, sans majuscule et avec un nouveau logo, revoit ses méthodes d’accompagnement des demandeurs d’emploi, pour insister davantage sur le coaching personnalisé. Fin novembre 2023, Raymonde Yerna devient la nouvelle administratrice générale du forem, où elle succède à Marie-Kristine Vanbockestal.
Fortement mobilisée par la crise sanitaire de la Covid-19 pendant plus de deux ans, la ministre n’est pas épargnée par les deux autres grandes crises qui s’abattent sur la Wallonie. Résidant à Esneux, elle est aux premières loges pour constater les dégâts calamiteux provoqués par les inondations de la mi-juillet 2021. Après l’offensive russe contre l’Ukraine, c’est la flambée du prix de l’énergie qui déstabilise les résolutions du Plan wallon de Relance et les projets inscrits dans la Déclaration de politique régionale. En charge de l’Action sociale, Christie Morreale vient au secours des CPAS, déjà submergés par la crise sanitaire, et qui affrontent celle de l’énergie, l’accueil des réfugiés ukrainiens, puis la flambée de l’inflation. La ministre mène encore la réforme des entreprises de titres-services (automne 2023) ; elle contribue à la création d’une vingtaine de « territoires zéro chômeurs » (sur le modèle français) pour réduire les sans-emploi de longue durée (avril 2022) et lance un appel à projet pour des « territoires zéro SDF » (juillet 2023), dix expériences étant menées dès novembre 2023. Elle augmente la capacité d’accueil des abris de nuit ; elle soutient la création de trois hubs logistiques alimentaires, à Charleroi, Liège et Namur (juin 2022), ainsi que les projets de ceinture alimentaire ; elle lance la numérisation des carnets de santé (janvier 2023) ; elle s’attaque à la précarité menstruelle par la distribution gratuite de protections hygiéniques (mars) ; elle soutient la création des 120 premiers logements wallons équipés d’une assistance digitale 2.0, destinés à favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie (juin) ; elle fait adopter un accord de coopération entre la Wallonie, la Cocof et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour rendre obligatoire et effective « l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle » (EVRAS, lancé en septembre 2023). Depuis 2020, elle soutient aussi un projet pilote de distribution de collations gratuites, saines et équilibrées, dans certaines écoles de Wallonie situées dans des zones touchées par la pauvreté.
Avec ses collègues Bénédicte Linard (écolo, Fédération Wallonie-Bruxelles) et Nawal Ben Hamou (PS, Région Bruxelles-Capitale), Christie Morreale lance, dès novembre 2019, l’idée de créer une Conférence interministérielle (CIM, où devraient aussi se trouver le fédéral et la Flandre) pour aborder de front la question des féminicides, sans se soucier des appartenances partisanes et des obstacles institutionnels. Sans attendre, la ministre wallonne double le budget consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes et s’engage à sensibiliser ses collègues du gouvernement wallon à la lecture de genre dans la gestion de toutes les compétences. En décembre, le Comité de concertation valide le projet de Conférence interministérielle « droits des femmes » et, en janvier 2020, se tient sa première réunion. En tant que ministre wallonne, elle adopte une série de mesures visant à améliorer les conditions de travail des femmes, à les amener dans des secteurs stratégiques (les sciences et les technologies) où elles demeurent sous-représentées et à booster l’entrepreneuriat féminin (Saace). Durant toute la législature, elle reste attentive à développer une politique active du genre ; après le Plan Genre transversal 2020-2024 et des mesures prioritairement destinées aux femmes (consolidation des moyens de la ligne d’appel pour les violences conjugales, sauvegarde des aides à l’emploi APE, consolidation du système des titres-services, évolution du statut des aides à domicile), le plan « Get Up Wallonia ! » puis le Plan wallon de Relance sont traversés par des mesures concrètes de lutte pour l’égalité hommes-femmes.
Ayant pris du retard en raison de la crise sanitaire, c’est en avril 2022 que la ministre Morreale entame la réforme des soins de santé de première ligne, le projet participatif « Proxisanté ». Il s’agit d’améliorer les conditions de travail et de mieux organiser les soins de santé de proximité, et d’offrir des soins personnalisés de grande qualité. En matière de soins aux personnes âgées, la ministre engage un important budget pour convertir plus de 2.250 lits de maisons de repos (MR) en lits médicalisés (MRS), réformant un secteur où plus aucune requalification n’avait eu lieu depuis 2013. Quant aux nouveaux réseaux hospitaliers wallons, ils se mettent progressivement en place avec les agréments de l’AViQ.
En toute fin de législature, avec ses collègues Philippe Henry et Christophe Collignon, elle parvient à boucler un montage financier assurant au tram liégeois ses deux extensions, vers Herstal et vers Seraing (février 2024) ; initiatrice du Conseil régional wallon de lutte contre le racisme (mars 2024), elle s’inspire des succès rencontrés par les cellules de reconversion quand elle fait aussi voter par le Parlement de Wallonie la pérennisation du dispositif « Coup de Boost », visant à (re)mobiliser, accompagner et proposer un vrai projet d’avenir aux jeunes très éloignés de l’emploi.
Lors du scrutin wallon du 9 juin 2024, elle est l’une des rares femmes désignées par la direction de son parti pour emmener une liste PS. D’ailleurs, dans la circonscription de Liège, depuis la première élection directe des députés wallons le 21 mai 1995, elle est la toute première femme tête de liste pour le parti socialiste. Avant elle, Christine Defraigne (MR, 2009 et 2014), Alice Bernard (PTB, 2014), Veronica Cremasco (écolo, 2014) et Marie-Dominique Simonet (cdH, 2009 et 2014) avaient été les pionnières liégeoises dans leur parti respectif. Au soir du scrutin, Christie Morreale réalise un score personnel (29.768 vp) bien supérieur à celui de tous les candidats liégeois, tous partis confondus. En recul de 2,2%, le PS (26,25%) réalise cependant son moins bon résultat depuis le 21 mai 1995 et s’il reste la première force politique sur la place de Liège, il perd deux sièges, l’apparentement jouant en sa défaveur.
Mandats politiques
Conseillère communale à Esneux (2006-)
Échevine (2006-06/2014)
Sénatrice (10/2011-01/2013)
Députée wallonne (10/2013-2014, 2014-09/2019)
Échevine en titre (2014-10/2017)
Sénatrice désignée par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (2014-2019)
Sénatrice de la Wallonie (juin-septembre 2019)
Ministre wallonne (2019-2024)
Députée wallonne (2024-)
Sources
Centre de Recherche & Archives de Wallonie, Institut Destrée, Revue de presse (-11/2023), dont L’Avenir, 26 octobre 2017 ; Le Soir, 30 septembre 2019, 29 décembre 2019, 21 mai 2020, 25 juin 2020, 1er et 4 avril 2022, 22 juillet 2022, 27 avril 2024
Classement des députés, dans Le Vif, 07 avril 2017, p. 22-23
Cumuleo (-2023)
Parlement de Wallonie, Rapports d’activités, de 2009 à 2023, https://www.parlement-wallonie.be/rapports-brochures
Rapport de la Commission spéciale chargée d’évaluer la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 par la Wallonie, Rapport présenté au nom de la Commission spéciale par M. Léonard, Mme Nikolic et M. Mugemangango, 27 novembre 2020, https://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/RAPPORT/359_1.pdf
Parlementaires et ministres de Wallonie (+ 2024) |
|
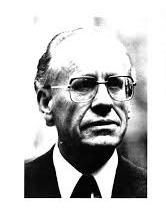
Goossens Charles
Politique, Député wallon
Chênée 28/09/1918, Chênée 23/10/2008
Député wallon : *1977 ; 1980-1981
Étudiant en Droit à l’Université de Liège, Charles Goossens voit ses études perturbées par la Seconde Guerre mondiale. Engagé dans les brigades d’Irlande (1944-1945), il achève néanmoins ses études en 1945 et entame une carrière universitaire. Assistant à l’Université de Liège (1946), chargé de cours (1967), il devient professeur ordinaire de Droit public et en Sciences politiques à l’Université de Liège.
Parallèlement, il milite dans les rangs du PSB. Conseiller communal de Chênée élu en 1958, il devient échevin dix ans plus tard, rejoignant l’équipe que préside Maurice Delbouille depuis 1940. Quand son collègue (à l’Université de Liège et au Collège) décide de renoncer à se présenter en octobre 1970, c’est Charles Goossens qui lui succède comme bourgmestre (1971-1976), ayant ainsi l’honneur d’être le dernier maire de Chênée avant la fusion avec Liège. Avant la fusion, il concrétise un projet qui lui tient à cœur, celui de créer le Centre culturel de Chênée, lieu polyvalent de rassemblement populaire, s’inscrivant dans une dynamique d’ouverture, de rencontre et de mélange de publics différents (1974). Dans le grand Liège, Ch. Goossens achève sa carrière politique comme conseiller communal (1977-1984).
À différentes reprises, son nom figure également sur les listes du PSB lors des élections législatives. Il n’est cependant pas en ordre utile. Et lorsqu’il est désigné sénateur provincial en février 1977, c’est à un concours de circonstances très particulier qu’il le doit. En effet, après le décès du sénateur direct Edmond Cathenis, le PSB fait appel à Servais Thomas pour le remplacer. Le mandat de sénateur provincial détenu jusque-là par Thomas est attribué à Henri Schlitz (mars 1976). Or, ce dernier est désigné comme échevin dans le grand Liège en janvier 1977 et démissionne du Sénat. C’est alors que Charles Goossens hérite de ce mandat volant (février 1977), pour peu de temps puisque Leo Tindemans remet la démission de son gouvernement début mars... Il n’a donc guère le temps de boycotter les séances du Conseil régional wallon provisoire (février-mars 1977), par solidarité avec le PSB, car Charles Goossens est un partisan affirmé de la mise en place définitive d’un réel Conseil régional wallon, en application de l’article 107 quater de la Constitution. Désigné comme sénateur provincial (avril 1977-décembre 1978), il est ensuite coopté à partir de janvier 1979.
Au moment de la régionalisation définitive de l’État, il joue un rôle majeur en tant que président de la Commission de la Révision de la Constitution qui examine le projet 261 avec minutie et sérieux (octobre 1979-mars 1980) : ses conclusions (définition de la répartition des compétences, reconnaissance des Conseils régionaux comme assemblées politiques, etc.) constituent la base des réformes à venir, en dépit de l’opposition du CVP. Durant l’été 1980, Charles Goossens figure parmi les sénateurs qui votent les lois de régionalisation. Dès le 15 octobre, il siège au sein du nouveau Conseil régional wallon, établi provisoirement à Wépion. À nouveau, son expérience au Parlement wallon ne dure que quelques mois (1980-1981), car sa reconduction au Sénat se fait encore par cooptation entre 1981 et 1985.
Tout au long de son mandat sénatorial (1977-1985), ce spécialiste en droit public et en sciences politiques, collègue de François Perin à l’Université de Liège, n’a pas manqué de conseiller le PS(B) sur les subtilités et les enjeux des mécanismes institutionnels, proposant notamment un nouveau statut pour le Sénat.
Sources
cfr Encyclopédie du Mouvement wallon, Parlementaires et ministres de la Wallonie (1974-2009), t. IV, Namur, Institut Destrée, 2010, p. 275
Mandats politiques
Conseiller communal de Chênée (1959-1976)
Echevin (1968-1970)
Bourgmestre (1971-1976)
Conseiller communal de Liège (1977-1984)
Sénateur provincial de Liège (1977, 1977-1978)
Membre du Conseil régional wallon provisoire (1977)
Sénateur coopté (1979-1985)
Membre du Conseil régional wallon (1980-1981)

Yans Raymond
Politique
Liège 24/06/1948
Dans l’Europe des années 1970 et 1980, un nouveau courant politique s’inscrit dans le débat public. Qu’il s’appelle « les Verts », Écolo, ou « Combat pour l’Ecologie et l’Autogestion », il influence la réflexion des « partis traditionnels » et obtient ses premiers élus. C’est en Wallonie qu’est désigné le tout premier mandataire écologiste membre d’un exécutif en Europe : le 3 janvier 1983, Raymond Yans entre comme échevin dans le collège de la ville de Liège, dans une coalition rassemblant Parti socialiste, Rassemblement wallon et Écolo. Chargé de l’Urbanisme, il fait notamment adopter le « Plan directeur de la métropole liégeoise » (1988). Après cette brève carrière politique, Raymond Yans s’oriente vers la diplomatie et joue un rôle important dans la lutte contre les trafics de drougue. En 2012, il accède à la présidence de l’Organe international de Contrôle des Stupéfiants (OICS).
Pionnier de la section liégeoise des Amis de la Terre (1977), membre de la Friends of Earth International, Raymond Yans contribue fortement au développement du mouvement écologique à Liège, mais aussi en pays wallon, puisqu’en 1986 il est l’un des membres fondateurs de Wallonie-Région d’Europe. Le fait qu’il détienne un échevinat dans une ville aussi importante que celle de Liège a été sans conteste un signal politique fort. Au sein du collège, ils sont en fait trois Écolo ; à côté de Raymond Yans qui est Premier échevin, on trouve aussi Brigitte Ernst et Théo Bruyère. Abandonnés par le PS en 1989, les Ecolos siègeront désormais dans l’opposition. Candidat malheureux aux communales de 1994, Raymond Yans restera un membre affilié et actif d’Écolo jusqu’en février 1996, malgré des occupations professionnelles qui l’éloignent de ses terres.
Avant son mandat politique, Raymond Yans – diplômé en Philologie germanique et en Philosophie de l’Université de Liège – avait déjà entamé une carrière dans la diplomatie. De 1978 à 1981, il avait été affecté comme attaché à l’ambassade belge de Jakarta par les Affaires étrangères. De 1989 à 1994, il est envoyé en poste à Tokyo, comme consul de Belgique, avant d’être désigné à Luxembourg (1999-2003). À son retour en Europe, en 1995, il est nommé comme responsable du service des stupéfiants du ministère belge des Affaires étrangères (1995-1999, 2003-2007). Président du Groupe de Dublin (2002-2006), il œuvre très activement à la mise en place des outils nécessaires à la lutte contre les drogues, au niveau belge, européen et international. Membre de l’OICS en 2007, il est élu à la présidence – mandat non rémunéré – du Conseil de cet organisme chargé de contrôler l’application des législations et conventions internationales en matière de trafic de drogue (2012 et 2013).
Sources
Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse
https://www.incb.org/incb/en/about/members/raymond_yans.html (s.v. novembre 2014)
Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995
Pascal DELWIT, Jean-Michel DE WAELE, Les Verts en politique, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996, coll. Pol-His, p. 35 et 47
Paul Delforge

Wincqz Grégoire Arnould
Socio-économique, Entreprise
Soignies 03/08/1847, Soignies 21/08/1915
Descendant d’une longue série de maîtres-carriers – qui furent d’abord commerçants et tailleurs de pierre, avant de s’imposer en directeurs d’exploitation et en patrons d’industrie –, Grégoire-Arnould Wincqz est le sixième des quatorze enfants de Pierre-Joseph Wincqz et de son épouse, la hutoise Marie-Antoinette Van Mierlo. Bénéficiant de l’importante fortune familiale, Grégoire Arnould entreprend des études et sort avec le diplôme d’ingénieur civil de l’École centrale des arts et manufactures de Paris (1874).
Contrairement à tous ses prédécesseurs qui avaient fait leur classe dans les carrières de Soignies, c’est en tant que diplômé d’une haute école que Grégoire Ar. est désigné, au décès du père, comme administrateur des affaires familiales désormais structurées sous la forme d’une société en commandite. En 1890, les carrières Wincqz deviennent Société anonyme, avant d’être cotées en bourse (1892). Ce sont 600 ouvriers qui réalisent les commandes pour les ascenseurs du canal du Centre, divers ponts et routes, voire la façade de la Maison du roi sur la Grand Place ou les Arcades du Cinquantenaire (1905), mais surtout le chantier du Palais de Justice. Comme l’avait souhaité Pierre-Joseph Wincqz, la pierre bleue de Soignies s’exporte en Europe, voire en Amérique et en Egypte (palais à Alexandrie et au Caire). Mais les années fastes sont derrière Grégoire Arnould Wincqz qui doit faire face tant à des choix stratégiques peu pertinents qu’à des revendications sociales importantes. La voilure de la SA Wincqz doit être abaissée ; ainsi la diversification lancée dans la production sucrière est abandonnée (1907). La famille Wincqz continue de détenir la majorité des parts de la « SA des Carrières P-J. Wincqz » à la veille de la Grande Guerre. En 1935, la société fusionnera avec les carrières Gauthier et deviendra la SA des carrières Gauthier et Wincqz ».
Comme son père, membre de la Loge des Amis philanthropes de Bruxelles (il démissionne en 1889), Grégoire Arnould Wincqz s’est également lancé en politique. Il entre d’abord au conseil communal de Soignies, en 1877, où il remplace Pierre-Joseph. Un an plus tard, le roi le désigne comme bourgmestre de l’entité et il est élu conseiller provincial du Hainaut. En 1880, il n’exerce plus ces mandats, lorsqu’il entre à la Chambre des représentants, où il remplace Ernest Boucqueau décédé. Lors du scrutin de 1882, les libéraux de Soignies perdent un siège (au profit des catholiques), mais Wincqz conserve son siège. En 1886, par contre, les libéraux récupèrent les trois mandats de l’arrondissement électoral, mais Grégoire Wincqz n’est plus député. Le parcours politique du libéral Wincqz est quelque peu chaotique aussi au niveau communal. Conseiller communal entre 1881 et 1883, il devient échevin (1884-1885) avant de retrouver les bancs des conseillers communaux (1886-1890), puis de faire fonction de bourgmestre de 1891 à 1894. Échevin en 1895, il achève sa carrière politique comme conseiller communal (1896-1915).
Sources
Jean-Louis VAN BELLE, Une dynastie de bâtisseurs. Les Wincqz. Feluy-Soignies XVIe-XXe siècle, Bruxelles, ciaco, 1990, p. 82-87 notamment
Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 624
Jean-Louis VAN BELLE, dans Nouvelle Biographie nationale, t. III, p. 353
Cfr La Vie wallonne, IV, 1982, n°380, p. 270-271 (Jean Wincqz)
Conseiller communal de Soignies (1877-1915)
Bourgmestre (1878-1880)
Conseiller provincial du Hainaut (1878-1880)
Député (1880-1886)
Echevin (1884-1885)
Bourgmestre ff (1891-1894)
Echevin (1895)
Paul Delforge